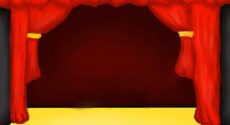FRANCOPHONIE…
Une simple recherche de ce mot dans les archives du Délit suffit à mettre en évidence la place primordiale de ce thème dans nos lignes éditoriales. Quoi de plus normal pour un journal dont le cheval de bataille est la représentation des voix francophones dans une université québécoise où l’enseignement se fait en anglais ? Pourtant, cette volonté d’offrir une plateforme d’expression à la francophonie mcgilloise semble souvent indissociée d’une approche revendicatrice du français : celui-ci est une langue dont les locuteur·rice·s doivent être fier·ère·s, mettant tout en œuvre pour la préserver. En-dehors même du cadre de notre journal, cette considération semble largement répandue et constitue l’essentiel du discours public sur la langue française, notamment dans notre contexte québécois où la francophonie a longtemps constitué une identité menacée par une présence anglo-américaine particulièrement pénétrante. Si, dans d’autres régions francophones, telles qu’en France hexagonale, certain·e·s diront ne pas avoir un rapport identitaire au français mais plutôt une conception neutre de la langue, l’on peut raisonnablement se permettre de remettre en question leur vision apolitique de la francophonie. En effet, si près de trois cents millions de personnes s’expriment aujourd’hui dans la langue de Molière, ce n’est pas tant le résultat d’une attirance particulière envers sa grammaire complexe ou ses infinies « exceptions qui confirment la règle », mais plutôt la conséquence d’une lourde histoire de colonisation ayant fait de nombreuses victimes. Conséquemment, avoir un rapport soi-disant neutre à la langue française ou en faire un objet de louanges irréfléchies sont toutes les deux des positions de non-considération de la portée coloniale intrinsèque à la francophonie. Pour de nombreuses personnes francophones issues de communautés victimes de la colonisation française, ce manque de nuance contraste fortement avec leur rapport moins aisé et direct à la langue française et représente une violence de plus à leur encontre. Cette enquête tentera de caractériser ces rapports singuliers au parler français.
Avant toute chose, il est important de reconnaître l’absence de certaines voix dans les récits d’expériences qui suivent, notamment celles issues de communautés autochtones. D’autre part, la taille limitée du groupe de personnes interrogées ne permet pas de prétendre à une exhaustivité des témoignages. Toutefois, cette enquête a pour objectif principal de provoquer une prise de conscience chez le lectorat francophone du Délit.
Jérémie-Clément Pallud & Juliette de Lamberterie
Un français dur à vivre
« Aux yeux du gouvernement [québécois], le français est une valeur ajoutée et je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais, pour moi, le fait que je parle français et que mon nom soit francophone est témoignage de génocide et de violences faites à mes ancêtres. » C’est en ces termes qu’Andréa, 22 ans, d’origine haïtienne mais étant née et ayant grandi à Montréal, exprime son malaise face au français. Elle décrit son rapport à cette langue comme étant de plus en plus informé, au fur et à mesure qu’elle en apprend sur les liens entre langue française, colonisation et esclavage.
Effectivement, au cours des plus de quatre siècles d’existence de l’empire colonial français, la langue française a largement été utilisée comme moyen d’oppression et de soumission des peuples. L’imposition de l’idiome national dans ses colonies était, pour la France, un dispositif très efficace d’imprégnation de ses idéaux coloniaux et d’assise de sa domination sur ces territoires et leurs populations. C’est la réalisation de ce violent passé porté par le français qui est à l’origine du malaise d’Andréa face à la langue qu’elle a toujours parlée. « Aujourd’hui, dit-elle, [cela me fait] bizarre d’avoir du ressentiment envers ma langue maternelle. »
Andréa admet aussi trouver que sa maîtrise accrue du français semble parfois représenter une barrière l’empêchant d’accéder entièrement à sa culture d’origine, puisqu’elle est définitivement plus à l’aise en français qu’en créole haïtien. Le constat est le même pour Mysslie, 18 ans et d’origine djiboutienne, qui, lorsque ses parents lui parlent somali, répond quasi-systématiquement en français : « D’un côté, j’aime beaucoup parler le français, mais, d’un autre côté j’ai toujours eu l’impression que ça m’avait enlevé quelque chose ».
Ce type de témoignage semble revenir sans cesse, de Marouane, 21 ans, qui regrette un « lien affaibli à [sa] culture » par la francisation de son arabe marocain, à Kelly qui déplore en Martinique une marginalisation notoire du créole au profit de la langue française et au détriment des traditions martiniquaises.
Pour moi, le fait que je parle français et que mon nom soit francophone est témoignage de génocide et de violences faites à mes ancêtres
Ainsi, le sentiment d’être tiraillé·e entre la réalité quotidienne d’une francophonie prégnante et l’aspiration à une plus grande communion avec sa culture d’origine semble également constituer une expérience partagée par les personnes francophones issues de territoires et communautés victimes de la colonisation française.
De toute évidence, l’impérialisme linguistique francophone établi durant la colonisation n’a pas miraculeusement pris fin lors des différentes prises d’indépendance des anciennes colonies françaises : la plupart de ces pays comptent toujours le français parmi leurs langues officielles ou secondes. Cette très forte rémanence du français peut alors devenir, à des échelles variables d’incidence, une barrière à la persistance ou à l’affirmation de cultures régionales portées par leurs langues propres.
En outre, dans ces sociétés postcoloniales, la francophonie s’impose d’autant plus facilement qu’elle est bien souvent indissociable de forts mécanismes de classes. À l’époque de l’imposition du français dans les colonies, ce dernier a souvent été prioritairement enseigné à la jeunesse de l’élite locale, devenant par la même occasion un symbole de distinction sociale. Comme nous le dépeint Marouane : « Être francisé au Maroc, ça passe plutôt bien généralement, c’est signe que tu es cultivé. […] Certaines personnes de classe aisée, une minorité qui a le pouvoir et l’argent, ne parlent que français et délaissent la culture marocaine. » Dans un grand nombre de ces communautés postcoloniales, la bonne maîtrise de la langue française est jusqu’à présent considérée comme un indicateur d’accomplissement social, poussant de nombreuses personnes à s’approprier le français au détriment de leurs langues régionales.
Francophonie(s) privilégiée(s)?
En plus de se sentir limité dans l’appropriation totale de leur culture, un autre point soulevé par les personnes ayant témoigné est que la francophonie s’accompagne souvent d’une injonction à une certaine façon de parler français. Cela constitue donc une double peine pour les victimes de la colonisation française en ajoutant des obstacles à leur intégration au sein de milieux francophones occidentaux. Pour ces personnes, la socialisation dans ces sphères passe très souvent par un alignement forcé de leur francophonie postcoloniale aux attentes d’uniformisation linguistique ordonnées par les francophonies occidentales. Cela passe autant par l’interdiction d’utiliser des expressions familières de leur francophonie d’origine que par la nécessité d’adapter son accent. Cette pression, Kelly l’a bien ressentie en arrivant à Paris pour ses études supérieures : plusieurs épisodes de moqueries lorsqu’elle prenait la parole en cours l’ont poussée à délaisser son accent martiniquais au profit de ce qu’elle appelle un « accent normé ». Ce mécanisme de défense forgé dans la douleur a pris tant de place dans son expression quotidienne qu’elle affirme aujourd’hui devoir se faire violence pour retrouver son accent d’origine.

Au Québec, cette incitation à adapter sa façon de parler français peut aussi exister. C’est l’expérience commune vécue par Maha, d’origine algérienne, et Christelle, d’origine haïtienne, ayant toutes deux immigré à Montréal à un jeune âge après avoir appris le français dans des contextes différents. Elles se souviennent que leur intégration en milieu scolaire québécois a été marquée par la contrainte d’aligner leurs façons de parler français à la francophonie québécoise.
Cette injonction à se conformer à un soi-disant modèle du bien-parler français est souvent vécue par les personnes provenant de communautés victimes de la colonisation française comme une incitation d’annulation supplémentaire des aspects de leur identité liés à leur origine socioculturelle, afin de se conformer à un moule francophone lisse, prétendument neutre mais culturellement situé. Ainsi, la francophonie, telle qu’elle est aujourd’hui pensée, ne semble tendre qu’à une uniformisation de toutes les façons de s’exprimer en français vers une francophonie occidentale et blanche.
La littérature est également un bon milieu d’observation de ce phénomène de hiérarchisation dont témoigne la distinction opérée de façon systématique entre littérature française et littérature francophone. Le dernier terme renvoie à toutes les littératures de langue française mais dont les auteur·ice·s sont originaires d’anciennes colonies françaises, tandis que la littérature québécoise semble osciller entre ces deux pôles.
Une discussion plus approfondie des mécanismes de cette hiérarchisation est à retrouver dans l’entrevue du docteur Diouf, en page 10.
Vivre avec ce conflit
De toute évidence, la francophonie des personnes issues de communautés victimes de la colonisation française est singulière en ce qu’elle est empreinte d’expériences douloureuses et entre souvent en conflit avec d’autres aspects de leur identité. Pour cela, leur rapport à la langue française a tendance à être beaucoup plus nuancé et informé que celui du discours dominant sur la francophonie faisant inconsciemment et allègrement l’apologie d’un ancien outil colonial aux conséquences encore bien réelles. Cette glorification aveugle du français constitue d’ailleurs une violence de plus à supporter au quotidien, comme le déplore Maha : « Il y a un de manque de sensibilité par rapport au fait que, justement, beaucoup de gens n’ont pas la même histoire par rapport au français, n’ont pas la même relation à la langue. […] Pour beaucoup d’entre nous qui sommes immigrants, l’on est venu au Québec parce que l’on parle français mais l’on parle français parce que nous avons été soumis à la colonisation. » Elle ajoute d’ailleurs que c’est « ce refus de reconnaître la dimension politico-historique [et] les relations de pouvoirs qui existent sur le territoire par rapport à la langue [qui l’a poussée à] faire [son] cégep et [son] université en anglais ».
Pour celles et ceux qui ont la francophonie en blessure, il faut alors faire preuve de résilience et trouver un moyen de vivre avec cette douleur quotidienne. Pour Kelly, cela passe par l’effort de se réapproprier son créole martiniquais, d’en améliorer sa maîtrise pour lui donner une plus grande place dans son expression orale comme écrite. Christelle, quant à elle, se refuse tout rapport identitaire à la langue française et choisit de l’utiliser comme simple outil de navigation du monde et du contexte québécois dans lequel elle évolue. Cette approche n’est pas la même pour Marouane qui remarque que « la langue, c’est ce qu’on a de plus intime, ce qui nous rend humains ». Iel fait donc le choix de « [s’]approprier le français et [de] l’approfondir pour exprimer des idées et combattre le véritable ennemi […], l’idéologie [coloniale] souvent véhiculée par cette langue ». « Parce que la langue française s’est imposée à moi, je ne veux pas [la rejeter et] être en conflit avec moi-même », explique-t-iel, avant d’ajouter que, dans le contexte mondial actuel, écarter le français reviendrait à devoir tout de même employer une autre langue coloniale – telle que l’anglais – pour se faire comprendre du plus grand nombre.
Parce que la langue française s’est imposée à moi, je ne veux pas [la rejeter et] être en conflit avec moi-même
En définitive, les témoignages recueillis prouvent l’existence de rapports particulièrement nuancés et délicats à la langue française. En continuant d’ignorer ces vécus, le discours dominant se rend complice de l’entreprise coloniale française par perpétuation des souffrances qu’elle a initiées. Par égard pour des communautés historiquement meurtries, il est du devoir de tout francophone de questionner la portée coloniale actuelle de la langue qui pend à ses lèvres. En attendant, le fait est que les communautés affectées par la colonisation française vivent en français d’une manière qui leur est propre et qui ne doit pas être considérée comme moindre.
L’entrevue du docteur Diouf, professeur dans le département de Littératures en langue française de McGill, s’attachera à mettre en lumière les mécanismes de hiérarchisation des francophonies en milieu académique.
S’ensuivra une présentation de certains problèmes structurels qui renforcent ces hiérarchies dans le contexte montréalais.