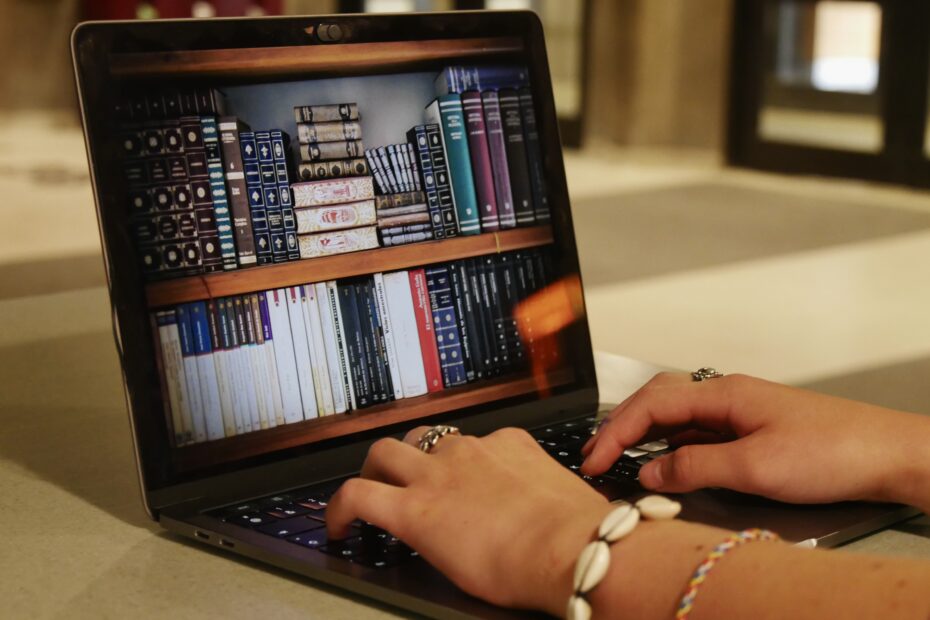Qu’est-ce que la culture ? C’est ce trésor commun dans lequel tous puisent et auquel chacun peut contribuer. C’est ce chemin de désir qui se trace sous les doigts des lecteurs, qui élisent les classiques en tournant les pages. Une lecture – un visionnement – est à bien des égards un vote dans cette instance démocratique que l’on appelle la culture.
La culture a ses jalons que nous appelons des référents ; ces référents, qui étaient jadis des histoires contées, chantées, écrites, se retrouvent aujourd’hui propagés et déterminés par l’intermédiaire des écrans. Une histoire qui aurait mis des semaines à faire le tour du village peut en quelques jours faire le tour du monde.
La promesse d’Internet était celle d’une grande démocratisation ; à l’ère des géants du Web, nous savons aujourd’hui qu’il n’en sera rien.
Le commerce de l’attention
Depuis longtemps, le lectorat renie les succès dits « commerciaux », qu’il oppose à un succès plus franc, plus profond, et de plus longue durée. Si la critique et l’édition peuvent se tromper sur le court terme, un lectorat plus large finit souvent par corriger leurs erreurs de jugement.
La technologie avance ; la société augmente sa production de toutes choses, y compris de culture. Le tronc commun de la culture se divise, les référents se multiplient. Une culture qui se fragmente peut-elle encore nous rassembler ?
L’algorithme de recommandation des plateformes numériques maximise le temps d’écran en se faisant la plus précise idée de nos goûts personnels. Ces algorithmes deviennent des conseillers omniprésents, dirigeant notre attention vers telle ou telle information qui risque de piquer notre intérêt.
Ce faisant, ils réunissent au même endroit les internautes, au-delà des frontières, en fonction de leurs goûts, de leurs opinions et préférences. L’ère du numérique est cependant aussi celle d’un présent continu, d’une amnésie collective, de la relativité culturelle. Puisque pour l’algorithme, tout contenu se vaut, pourquoi les plateformes feraient-elles la promotion de contenu qui fait réfléchir ? Promouvoir un livre où un artiste pousse les internautes hors de la portée toujours grandissante des plateformes. Pour Meta, bannir les médias d’information au Canada était tout autant une affaire de responsabilité fiscale que d’attention. Bien que les contenus médiatiques vérifiés ne soient plus disponibles sur les plateformes, peu sont ceux qui ont fait le saut entre leur fil d’actualité et la presse numérique.
Pourquoi lire les classiques ?
Lire est un acte tout autant culturel que politique. Choisir de donner son attention à une œuvre particulière, c’est la pousser un peu plus près du panthéon de la culture commune.
Pourquoi lire les classiques ? Dans son recueil d’essais éponyme, Italo Calvino nous laisse cet indice : « Principe numéro 13) Est classique ce qui tend à reléguer l’actualité au rang de rumeur de fond, sans pour autant prétendre éteindre cette rumeur. » Je rajoute à ceux de Calvino un 15e principe : les classiques forment ce tronc commun qui nous arrache au présent pour nous rappeler que nous ne sommes, comme dirait Joyce, « ni premier ni dernier ni seul ni unique dans une série ayant son origine dans l’infinité et se répétant à l’infini » (Ulysse, p.1 120).
Ce qui se produit aujourd’hui sera un jour classique, cela ne fait aucun doute. Il faudra cependant accorder à ces œuvres contemporaines un délai de maturation, le temps que les idées cheminent dans l’inconscient collectif. Il faut laisser au présent le temps d’acquérir son caractère nostalgique.
Ces futurs classiques sont, à beaucoup d’égards, à la merci de notre attention collective.