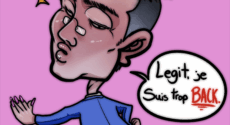Le 15 août, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, à Anchorage, en Alaska. Puis, le 18 août, Volodymyr Zelensky s’est entretenu, accompagné d’une délégation européenne, avec le président américain à la Maison-Blanche. Ces deux évènements avaient comme objectif affiché d’œuvrer en faveur de la paix.
Un sommet plein de zones d’ombre
Scrutée par le monde entier, la rencontre entre le président américain et le président russe n’a pas abouti à un accord de cessez-le-feu avec Moscou, malgré les « importants progrès (tdlr) » évoqués par le républicain. De plus, le sommet ne se serait pas déroulé comme prévu. En effet, huit pages « produites par le bureau du chef du protocole » des États-Unis ont été retrouvées peu après le sommet par hasard dans une imprimante de l’hôtel Captain Cook, à Anchorage. Elles décrivaient, heure par heure, le déroulé initialement prévu pour ce sommet. Elles font notamment état d’un cadeau du président Trump destiné à Vladimir Poutine, sans qu’il soit possible de confirmer si celui-ci a effectivement été offert. Un déjeuner commun, inscrit au programme, n’a finalement pas eu lieu, ainsi qu’une conférence de presse prévue pour durer une heure, a finalement duré une quinzaine de minutes.
Ces zones d’ombre laissent planer de nombreuses questions quant à la portée réelle de cette rencontre. Pour mieux en saisir les enjeux, Le Délit s’est entretenu avec le professeur Frédéric Mérand, directeur du Département de science politique de l’Université de Montréal – et collaborateur au Délit il y a 30 ans !
Un succès symbolique pour Moscou
Le professeur Mérand estime qu’il est nécessaire, avant tout, de prendre du recul sur ce sommet avant de le qualifier « d’historique », car rien n’a été signé. Une rencontre entre deux dirigeants de puissance mondiale n’est pas forcément synonyme de réussite. Il tient à rappeler que « la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018 n’a abouti à rien ». Selon lui, il faut donc attendre avant d’évaluer si cet évènement constituera un point de bascule dans la quête d’une paix durable en Ukraine. Le professeur Mérand ajoute également que « la simple tenue de ce sommet constitue une victoire diplomatique pour la Russie », qui s’est fait accueillir sur le sol américain. Ce geste s’inscrit dans la logique d’une réconciliation entre ces deux grandes puissances, conformément au narratif russe.
Interrogé sur la sincérité de l’objectif de paix poursuivi par ce sommet et sur le risque qu’il ne soit qu’un moyen pour gagner du temps, le professeur Mérand répond que la vérité se situe probablement « entre les deux ». Les deux parties souhaitent avancer, mais leurs intérêts divergent. Du côté russe, l’objectif est de s’affirmer à la table des grandes puissances, ainsi que d’ajouter à leur territoire quatre oblasts : Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Toutefois, le statu quo sert également les intérêts de Vladimir Poutine dans la mesure où les forces russes effectuent des avancées record. Quant aux États-Unis, « Trump a fait de la résolution de cette guerre une priorité dès sa campagne présidentielle et garde en tête le prix Nobel de la paix », une récompense très convoitée par le président américain, qui sera décernée le 10 octobre prochain.
Washington : Zelensky et son escorte européenne
Le caractère exclusivement bilatéral de cette rencontre a eu pour effet d’écarter de facto le président ukrainien et les Européens de la table des négociations. Un second sommet a donc eu lieu à la Maison-Blanche le 18 août en présence des autres parties prenantes, telles que le président ukrainien, le secrétaire général de l’OTAN, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen et d’autres dirigeants européens. Selon Frédéric Mérand, il serait trompeur de parler ici de « véritable coordination transatlantique ». Pour Donald Trump, la coordination signifie surtout que « les Européens paieront et constitueront la première ligne de défense ». La question de fond reste celle du degré d’implication américaine : jusqu’où Washington est-il prêt à aller alors que les Européens financent déjà une large partie de l’effort ? De leur côté, les capitales européennes souhaitent régler le problème ukrainien selon leur conception, alignée sur Kiev, mais elles ne disposent pas des moyens suffisants pour y parvenir seules. Leur objectif est donc de pousser les États-Unis à partager le fardeau, qu’il soit économique, diplomatique ou militaire.
« Leur objectif est donc de pousser les États-Unis à partager le fardeau, qu’il soit économique, diplomatique ou militaire »
La présence de cette « escorte européenne » à Washington s’explique aussi par la volonté de ne pas laisser seul le président ukrainien, pris dans un guet-apens en février dernier, dont les images avaient fait le tour du monde. Cette délégation visait autant à protéger le président ukrainien qu’à affirmer sa place dans le grand échiquier diplomatique.
Le rôle limité du Canada
Le Canada, de son côté, ne dispose pas d’une marge de manœuvre autonome. Pour le professeur Mérand, « Ottawa s’alignera, quoi qu’il arrive, sur les positions européennes ». Le pays partage les positions de Paris, de Berlin, de Londres et de Varsovie : soutenir le gouvernement ukrainien et la souveraineté de l’Ukraine. Malgré un effort remarquable envers Kiev, proportionnellement à son PIB, le Canada ne détient pas la solution : « Celle-ci réside entre les mains des États-Unis et des grandes puissances européennes », affirme le professeur.
Enfin, le professeur Mérand met en garde contre le risque d’usure médiatique. « Les conflits qui n’offrent pas de solution rapide finissent par lasser les médias et leurs publics », explique-t-il. Ce phénomène ne concerne pas seulement l’Ukraine, mais aussi la guerre à Gaza et d’autres conflits de même nature. Les médias et leurs auditoires préfèrent les crises claires, aux solutions rapides, alors qu’ici, aucun règlement n’est envisageable à court terme. « Il n’y aura pas de paix dans la région avant des années », prévient-il. Il conclut en affirmant que « maintenir l’attention sur ces conflits représente notre principal défi, et notre faiblesse à tous ».