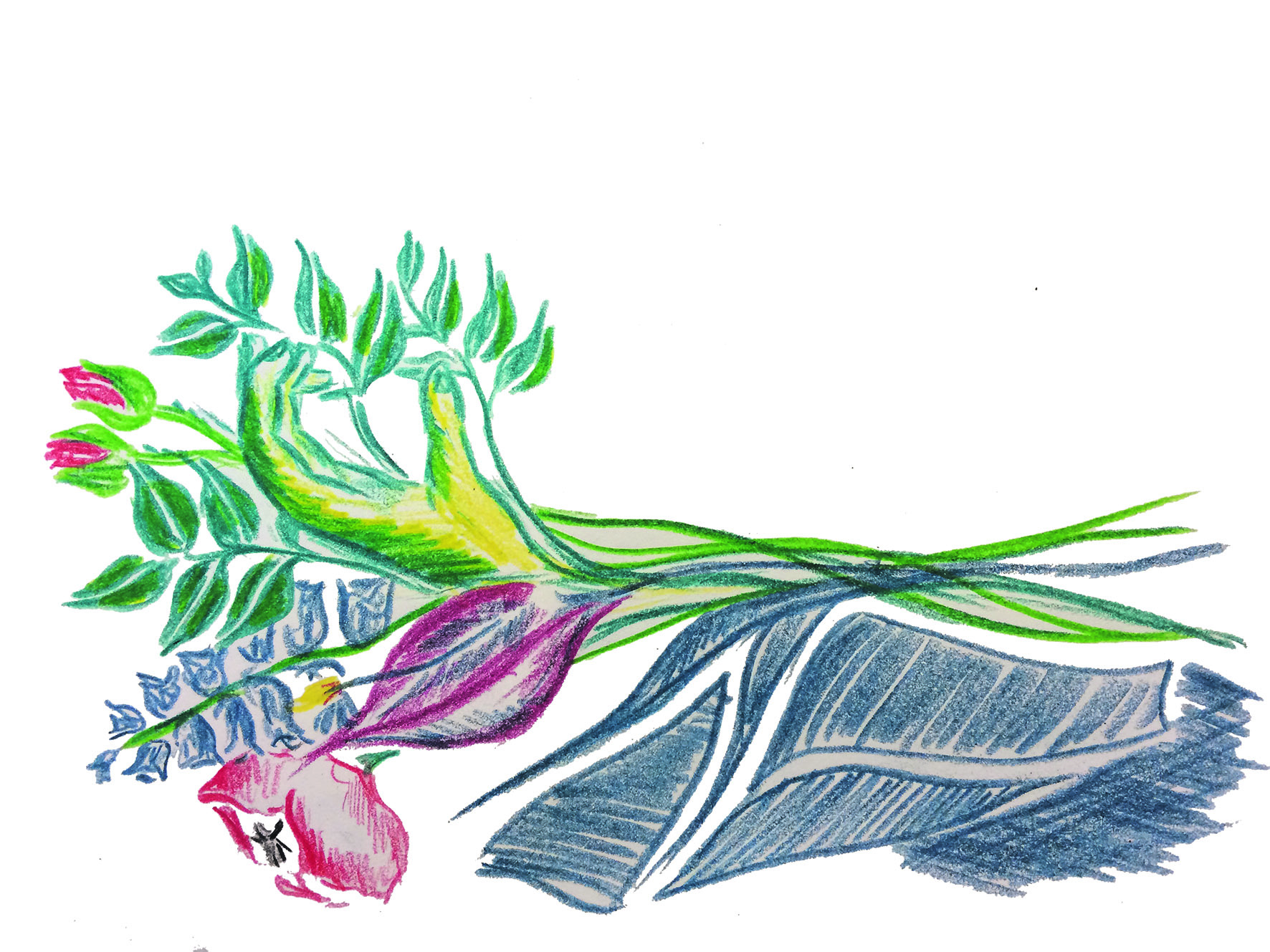Mise en garde : cet article aborde le sujet du suicide.
En octobre dernier, sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, Hubert Lenoir, jeune auteur-compositeur-interprète, lâchait après avoir confié que sa célébrité croissante lui rendait la vie difficile dernièrement : « J’ai un peu le goût de me crisser en feu ces temps-ci ». S’est ensuivi un moment de malaise si intense que le jeune homme s’est visiblement senti obligé de rajouter tout de suite qu’il « disait ça de même. » « On dit pas des affaires de même ! » a répondu Dany Turcotte, un des animateurs de l’émission. Lenoir a tout de même essayé de soutenir la discussion, en répliquant de manière plus légère : « T’as pas le goût toi des fois, de…?» « Non. », ont répondu abruptement deux des animateurs. Bien que ces « non » puissent avoir été tout à fait honnêtes, les réactions des deux hommes étaient si tranchantes et réprobatrices que l’artiste s’est peu à peu refermé sur lui-même. L’animateur a brusquement changé de sujet et a donc coupé court à la conversation.
Cet échange n’est pas resté sans écho. Dany Turcotte a ensuite commenté : « Pour Hubert Lenoir, j’hésite entre l’écorché vif ou le gars maladivement en manque d’attention… ». Sur les réseaux sociaux, tout le monde a eu son mot à dire, et tout est parti dans tous les sens. Un moment gênant, donc, mais qui a tout de même illustré à quel point le suicide met mal à l’aise, même pour deux individus dont le métier consiste à faire la discussion. Cet évènement, mais aussi d’innombrables autres, ont ainsi ressassé une question qui me préoccupait déjà beaucoup : pourquoi sommes-nous incapables de parler de suicide ?
Dans Le Devoir, la professeure de philosophie Marie-France Lanoue a heureusement ajouté une pointe de bon sens à la discussion autour de l’incident. Elle écrit : « dans la société du bien paraître et de la performance à tout prix, ce n’est pas toujours évident de se montrer vulnérable et de dire des affaires de même… Pourtant il va bien falloir qu’on apprenne à le faire ». Dans son texte, elle met en lumière un fait que l’on ne peut contester : le suicide est peu, et mal introduit dans les conversations. On trouve le sujet indécent, trop violent et toujours déplacé. Une personne qui aborde la perspective de se tuer montrerait une vulnérabilité si forte que l’encourager à se confier serait impensable.
Deux extrêmes
J’ai rencontré peu de textes qui déconstruisent nos discours se rapportant au suicide et n’étant pas directement issus d’associations de prévention. Ceux-ci expliquent souvent l’importance de parler à ceux et celles qu’on pense susceptibles de se mettre en danger, et d’être à leur écoute. Ces recommandations sont primordiales. Toutefois, elles n’abordent souvent pas nos façons plus communes et quotidiennes de parler de suicide. J’ai personnellement eu mon lot d’expériences gênantes par rapport à cela ; mon père s’est suicidé il y a trois ans. Je fais donc malgré moi particulièrement attention aux façons dont le sujet est abordé, et ce qui m’est le plus évident, c’est bien sûr à quel point les gens en parlent peu, mais aussi comment nos façons d’en parler semblent osciller entre deux extrêmes.
D’un côté, je suis constamment autour de gens qui évoquent le suicide dans leurs blagues. « Si j’ai moins que B à mon devoir, je me jette par la fenêtre ». Ces façons de parler qui me choquent parfois, auxquelles je souris de temps en temps, je les entends partout : dans la rue, dans un groupe d’ami·e·s, en classe dans la bouche de mes professeur·e·s. Lorsque l’on parle de mauvaises nouvelles ou de l’effondrement climatique, par exemple, il y en a souvent un·e pour dire « et ben, on a qu’à tous se suicider, alors ». Et évidemment, le monde va mal, mais lorsque j’entends cela, je ne peux m’empêcher de penser à celles et ceux qui l’ont vraiment fait.
Dès que l’on décide de ne plus faire de blagues, les propos basculent soudain vers un autre extrême ; c’est de gens que l’on connaît dont on parle désormais, et tout devient trop lourd. Les mots sont tellement graves que c’en est presque insoutenable. Ils ne sortent bientôt plus et il n’y a plus rien à dire. Le terme me semble si pesant qu’il me reste parfois coincé dans la gorge. Lorsque, quelques semaines après la mort de mon père, mon dentiste m’avait demandé pourquoi il ne retournait pas ses appels, j’avais simplement répondu, en tremblant : « il n’est pas disponible ». Je suis encore aujourd’hui bien incapable de raconter spontanément ce qui s’est passé. On pense aussi souvent que l’on se doit de comprendre une chose avant d’être capable d’en parler, d’y trouver un fil conducteur. Mais une mort de la sorte survient sans avertissement, elle assomme complètement, et peu importe les comptes-rendus psychiatriques ou les lettres d’adieux, c’est l’incompréhension qui prend toute la place. Reste alors une énigme que l’on doit accepter de ne jamais arriver à résoudre, et l’on sait qu’on ne pourra jamais donner sens à cette fin.

Un silence injuste
Mais outre les émotions qui bloquent la parole, l’on refuse d’aborder le suicide puisqu’il s’agit de quelque chose dont on ne doit pas parler. La mort est grave et triste, le suicide sinistre. Après tout, la Bible le considère comme un meurtre, et y a donc, depuis des siècles, attribué une infamie qu’on n’arrive toujours pas à lui détacher. Le suicide n’est pas une mort comme les autres ; il ne survient pas, mais consiste en l’ultime acte de violence porté vers soi-même. C’est, d’une certaine façon, l’acte d’égoïsme et d’abandon le plus extrême ; les autres composantes d’une vie, les proches, le monde, les valeurs s’estompent pour ne laisser place qu’à un malheur si grand que la mort s’impose comme seule solution. Un acte qui, finalement, est à la portée de tou·te·s. On refuse souvent d’en parler aux enfants ; je me souviens d’une scène du film Little Miss Sunshine que j’ai d’abord vu petite, où Olive, sept ans, assise à table avec son père et son oncle ayant récemment tenté de s’enlever la vie, demande à celui-ci : « Pourquoi as-tu voulu te tuer ? ». Et du père qui répond à sa place : « Non, ne répond pas Frank. […] C’est un homme très malade dans sa tête. […] Je suis désolé, je ne crois pas que ce soit une conversation appropriée pour une fille de sept ans ! ». L’on ne veut pas que les jeunes voient le suicide comme une possibilité, ou leur donner l’impression qu’une mort par suicide est acceptable, puisque cela signifierait qu’il·elle·s ont le droit de tout abandonner. J’en savais moi-même très peu sur la maladie de mon père, qui durait depuis des années. L’on m’a caché toutes ses tentatives et le mot suicide a à peine été prononcé dans les mois, et les années suivant sa mort. J’ai donc moi aussi été habituée, et conditionnée, à ce silence.
Je pense qu’il réside une vraie injustice dans le silence imposé autour du suicide ; celle qui consiste à laisser la violence de l’acte recouvrir tout le reste. Qu’une personne soit morte en se suicidant fait que tout devient soudain réduit à cette violence, et il semble alors indécent, ou interdit, de parler d’elle de quelque autre façon. La complexité d’une existence est soudain complètement mise de côté pour ne laisser de place qu’à la façon dont celle-ci s’est terminée. Le choc et la violence de l’acte recouvrent tout ; la mort et la vie. Je n’ai aucune expertise psychologique en ce qui concerne le deuil ou les réactions « saines » à avoir face à quelqu’un qui disparaît. Je me moque assez des supposées « étapes du deuil » dans lesquelles je ne reconnais pas du tout mon expérience. Mais je perçois clairement la brutalité de ne plus jamais parler d’une personne, du moins dans la sphère privée, du fait qu’elle se soit suicidée. Un caractère joyeux, ou intelligent, ou sensible devrait être célébré, peu importe la façon dont celui-ci s’est arrêté de perdurer. Mais encore une fois, il semblerait qu’aux yeux des autres, ces qualités soient tâchées par la nature du geste final.
Il réside une vraie injustice dans le silence imposé autour du suicide ; celle qui consiste à laisser la violence de l’acte recouvrir tout le reste.
Un silence dangereux
Cette incapacité à parler de suicide ne fait pas de mal qu’aux mort·e·s. Elle est aussi grave pour ceux et celles qui le contemplent, ou qui survivent malgré les tentatives. Comment peut-on s’attendre à ce que quelqu’un nous confie son mal-être si celui ou celle-ci sait déjà que nous serons complètement désarmé·e·s face à leurs propos, et inaptes à soutenir la conversation ? Heureusement, il semble que nous soyons tou·te·s plus conscient·e·s de l’importance de libérer le discours sur la maladie mentale et de déstigmatiser les demandes à l’aide. Mais ces initiatives n’accomplissent pas leur objectif si les espaces dans lesquels demander de l’aide sont prédéterminés et rares. L’on ne devrait pas avoir à s’exprimer dans un contexte particulier, à des personnes en particulier. La parole devrait se libérer partout. Savoir quoi répondre ? Pas forcément. Mais donner son écoute et son soutien, et montrer que l’on préfère s’engager dans une conversation qui nous fait peur plutôt que de repousser l’effort de l’autre en changeant de sujet.
Il est difficile de parler de choses graves, évidemment. Mais je pense aussi qu’inversement, on tente parfois de préserver un silence pour conserver les choses telles quelles, dans toute leur lourdeur, en ne voulant pas les banaliser ou les rendre plus légères. Le suicide reste une mort, que l’on n’a pas forcément envie d’aborder tout le temps. Mais sentir que l’on a la possibilité d’en parler si l’on en a l’envie ou le besoin est impératif. La difficulté semble être de trouver un équilibre dans nos discours lorsqu’on parle de suicide ; ne pas chercher à réduire la gravité du geste tout en ne se laissant pas impressionner par elle. Ne plus se faire taire par la brutalité du suicide, c’est donc pour arriver à se souvenir et à parler de ceux·celles qui se sont donné·e·s la mort, mais aussi pour envoyer le message à ceux·celles qui le contemplent que leurs ressentis sont légitimes et que l’on saura se montrer sensible lorsqu’ils nous feront part de leur malheur.