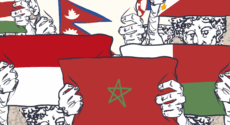Le mardi 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une date ayant pour but de commémorer « l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats [autochtones, ndlr] et de leurs séquelles durables », selon le site officiel du gouvernement canadien. La faculté de médecine de McGill a publié pour l’occasion un communiqué rendant hommage « aux victimes et aux survivants du système des pensionnats », et rappelant par la même occasion ses engagements « dans la voie de la réconciliation », notamment en « développant les effectifs autochtones dans les professions de la santé ».
Pourtant, au moment où étaient publiés ces mots, se tenait de l’autre côté du campus un rassemblement portant un tout autre discours. Devant l’Institut Allan Memorial, à quelques pas du chantier du projet « Nouveau Vic » cogéré par McGill et la Société québécoise des infrastructures (SQI), les Mères mohawks (ou Kanien’kehá : ka Kahnistensera), avaient alors appelé à un rassemblement de la presse et des militants dans le cadre de leur lutte contre l’excavation des terres environnant l’hôpital. Pour l’occasion, une cinquantaine de militants étaient réunis vêtus d’un chandail orange, symbole de commémoration des victimes et survivants des pensionnats.
La bataille juridique se poursuit
Durant le rassemblement, les Mères mohawks ont notamment annoncé le dépôt d’une motion à l’encontre de la SQI, visant à la protection juridique de trois zones « où des preuves de restes humains ont été trouvées », nous explique Philippe Blouin, doctorant en anthropologie à McGill affilié au collectif. La motion repose sur différentes preuves de la présence de restes humains autour de l’Institut Allan Memorial. Dans une fiche distribuée aux médias, le collectif cite un rapport d’Askîhk Research Services, une société autochtone de conseil en archéologie employée par McGill et la SQI dans le cadre du projet. Le rapport, non public, mais cité dans la fiche, conclurait que « la combinaison de trois lignes de preuves séparées [chiens renifleurs, géoradar et plus récemment une sonde spécialisée] soutenait la présence de restes humains (tdlr) ».
Ce combat juridique n’est pas nouveau : les Mères mohawks cherchent à ralentir l’expansion de McGill sur le terrain de l’ancien hôpital Royal Victoria depuis 2022. Elles affirment que ces « restes humains » appartiennent probablement à des corps d’enfants autochtones issus des pensionnats et victimes des expérimentations du projet MK-Ultra. Dans les années 1950 et 1960, l’hôpital, déjà affilié à McGill, s’est en effet rendu coupable d’expérimentations psychiatriques illégales, notamment sur des enfants, dans le cadre de recherches militaires.
En quête de vérité
Pour les Mères mohawks, il s’agit là d’un combat pour la vérité historique sur les pratiques du gouvernement canadien. « Sans vérité, il ne peut pas y avoir de réconciliation », a expliqué Kahentinetha, l’une des Mères présentes. « La terre a déjà été maltraitée il y a deux ans, nous ne pouvons pas les laisser le refaire ». Elle fait ici référence aux méthodes employées par la SQI, que Blouin a détaillées au Délit : « Ils viennent avec des machines, détruisent tout – des tombes non protégées par des cercueils, des os en décomposition – c’est extrêmement fragile, seuls des professionnels du domaine devraient gérer ces éléments. » Il précise : « La SQI n’a pas de plan de construction précis [dans les zones concernées par la motion], mais affirme qu’elle reviendra excaver dès qu’ils recevront les prochains rapports des sondes. »
Malgré la difficulté de leur lutte juridique, les représentantes autochtones restent déterminées : « La SQI et McGill cherchent à nous épuiser avec la paperasse, mais nous sommes déterminées à découvrir la vérité », affirme Kwetiio, autre porte-parole du collectif. Kahentinetha, encore pleinement engagée dans ce combat à l’âge de 86 ans, le démontre par sa résilience : « Nous ne cesserons jamais de lutter. S’ils pensent que nous nous lasserons, ils ne connaissent pas les femmes mohawks. »