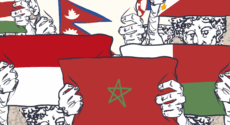Après près de dix ans au Sénat du Canada, la sénatrice Marie-Françoise Mégie, première femme d’origine haïtienne à y siéger, a pris sa retraite le 21 septembre 2025. Engagée sur des dossiers tels que l’aide médicale à mourir ou les langues officielles, elle revient sur son parcours et sur les valeurs qui ont guidé son engagement dans une entrevue avec Le Délit.
Le Délit (LD) : Qu’est-ce qui vous a poussée à devenir sénatrice ? Qu’est- ce que vous espériez accomplir ?
Marie-Françoise Mégie (MM) : Je ne savais même pas que je pouvais devenir sénatrice – c’est quelque chose qui ne m’avait jamais, jamais effleuré l’esprit. En 2016, je sortais de ma vie médicale, je prenais ma retraite, et je comptais désormais me concentrer sur ma vie communautaire. Mais un ami m’a entendue parler de mon plan pour la retraite, et il m’a dit que les jeunes de la communauté noire avaient besoin de se sentir représentés dans les hauts espaces décisionnels. C’est cet argument qui m’a convaincue d’envoyer mon curriculum vitæ au comité décisionnel du Sénat. J’étais très contente d’être choisie.
« En ayant peur de « la politique », on ne fait que se freiner »
LD : Vous êtes la première sénatrice d’origine haïtienne – qu’est-ce que cela représente pour vous, personnellement et politiquement ?
MM : On me demande souvent si je trouve ça lourd, d’être la première sénatrice d’origine haïtienne, si j’ai le sentiment d’avoir une redevance à la population. Mais j’étais déjà très impliquée au sein de la communauté haïtienne avant de devenir sénatrice. J’ai vu mon rôle au Sénat comme un cadeau pour poursuivre mon travail à plus grande échelle. Je sentais que j’avais la responsabilité de continuer d’aider les jeunes, de combattre la discrimination – mais ce n’est pas une responsabilité qui me pèse, pas du tout. Cette année, je prends ma retraite, et il faut que d’autres prennent la relève. Et quand on a défriché un terrain, c’est plus facile pour les plus jeunes de marcher sur nos traces.
LD : Quand vous regardez en arrière et que vous pensez à votre carrière au Sénat, de quoi êtes-vous le plus fière ?
MM : J’ai déposé un projet de loi pour la commémoration du jour de la pandémie de COVID-19, qui a été adopté. Chaque année, le 11 mars, on se souvient désormais des personnes décédées dans des conditions effrayantes et des professionnels de la santé qui ont donné des soins aux malades et qui ont diminué la catastrophe. En plus de se souvenir, on se prépare à l’éventualité d’une nouvelle pandémie, pour mieux y réagir si ça devait se reproduire. Une autre initiative dont je suis fière est celle de l’exposition annuelle du Mois de l’histoire des Noirs au Sénat. Avec un groupe de sénateurs noirs, nous avons organisé des expositions sur les artistes noirs, les innovateurs noirs, les athlètes noirs… L’idée étant de mieux faire connaître aux sénateurs, mais aussi aux visiteurs du Sénat, l’histoire des Noirs. C’était la première fois qu’une telle initiative était organisée, et cela a inspiré d’autres sénateurs à organiser des expositions similaires.
LD : Que diriez-vous à un jeune qui hésite à s’engager politiquement, parce qu’il sent que la politique, ce n’est pas pour lui ?
MM : Je lui dirais d’abord que, moi aussi, je pensais que la politique n’était pas pour moi. Mais tous les gestes sont politiques, même si on ne s’en rend pas toujours compte. En ayant peur de « la politique », on ne fait que se freiner. Je recommande à tous les jeunes de commencer à s’engager le plus près d’eux, au niveau municipal par exemple, pour comprendre comment fonctionne la machine électorale. On a besoin de la jeunesse, vous êtes les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Le même conseil s’applique évidemment aux jeunes issus de communautés marginalisées – vous êtes chez vous, vous êtes nés au Canada Vous avez votre place, prenez-la !