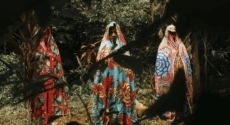Alors que l’effervescence étudiante de McGill a repris son cours en cette rentrée 2025, certains étudiants internationaux n’ont pas pu assister à leurs premiers cours de l’année. Pour cause : de plus en plus de retards, voire de refus, dans l’obtention de leurs permis d’études. Ainsi, tandis que de nombreux élèves restent actuellement bloqués dans leurs pays d’origine, les universités canadiennes, telles que McGill, doivent, quant à elles, faire face à la baisse des arrivées d’étudiants internationaux provoquée par le virage politique du gouvernement canadien en octobre 2024. Depuis bientôt un an, le gouvernement libéral cherche à réduire le nombre de résidents permanents et temporaires dans le pays, y compris les étudiants étrangers ; des changements qui vont probablement redessiner le visage d’universités multiculturelles, telles que McGill, au cours des prochaines années.
Un plan de limitation d’ici 2027
En octobre 2024, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, annonçait dans un communiqué la mise en place du Plan des niveaux d’immigration 2025–2027. Ce dernier prévoyait de réduire la croissance démographique à court terme durant les trois prochaines années, avec une baisse marginale de la population de 0,2% en 2025 et 2026. Cela se traduirait par la réduction de résidents permanents de 500 000 à 395 000 en 2025, et de 500 000 à 380 000 en 2026, pour finalement atteindre un seuil de 365 000 résidents permanents en 2027.
Les personnes cherchant à obtenir la résidence permanente ne sont pas les seules concernées par ces changements ; les résidents temporaires, tels que les étudiants internationaux, sont pour la première fois également la cible de ce plan annoncé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). D’ici la fin de 2026, l’IRCC veut tenter de réduire à 5% de la population canadienne le nombre de résidents temporaires, contre près de 7% actuellement. Il est ainsi prévu que la population temporaire du Canada diminue d’environ 445 000 personnes par an en 2025 et 2026. Pour les étudiants, cela se traduit par un nombre plus élevé de permis d’études refusés : depuis janvier 2024, le gouvernement a établi un plafond d’approbation de permis d’études sur deux ans pour les étudiants étrangers.
À l’époque, l’ancien premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que ce plan visait principalement à donner aux gouvernements provinciaux le temps de rattraper le retard en matière de logement, soins de santé et services sociaux. Réduire le nombre de permis de travail ou d’études permettrait ainsi d’alléger les pressions sur les demandes de logement et autres services.
Le rôle de la francophonie
Si la plupart des immigrants vont sans doute voir leur quota être réduit dans les prochaines années, un groupe échappe toutefois à ces restrictions : les arrivants francophones s’installant dans les provinces canadiennes hors Québec. En effet, durant sa campagne électorale, le premier ministre Mark Carney avait promis aux Canadiens d’augmenter l’immigration francophone pour atteindre le seuil de 12% des résidents permanents hors Québec d’ici 2029.
« La baisse d’entrée d’étudiants internationaux dans les universités canadiennes risque par ailleurs d’enfoncer les dettes que présentent déjà certains établissements »
Cette démarche s’inscrit plus globalement dans la volonté du gouvernement de privilégier le développement de la francophonie à travers le pays. Depuis 2003, ce dernier s’est engagé dans des efforts, plus ou moins marqués, pour maintenir la langue française dans la culture canadienne. Il a d’ailleurs fallu 19 ans, de 2003 à 2022, pour atteindre la cible des 4,4% de francophones hors Québec. Celle-ci va probablement continuer d’augmenter au cours des prochaines années, mais ne concerne néanmoins pas les francophones souhaitant immigrer au Québec.
Quelles implications pour McGill ?
Près d’un an après l’annonce de ces réformes, les secousses se font déjà ressentir sur les campus. Aisling, étudiante de première année, a fait face à de multiples problèmes avec IRCC avant même sa rentrée à McGill : « Tout était en ordre dans mes documents, j’avais prévu mon arrivée à Montréal le 19 août, puis j’ai reçu un refus, car je n’avais pas fait un examen médical – qui n’était pas nécessaire dans mon cas. J’ai alors dû reporter de nombreuses fois mon vol pour Montréal et passer cet examen médical, ce qui avait un coût financier important. » Comme beaucoup d’autres étudiants de première année, elle s’est retrouvée dans la détresse de ne pas pouvoir commencer ses études à temps : « C’était de réelles montagnes russes : j’étais tout d’abord très étonnée, puis rapidement je suis devenue anxieuse. » Elle explique qu’à cause de ces retards, de nombreux étudiants ont d’ailleurs été dans l’obligation de reporter leur rentrée à janvier 2026.
Ces changements au sein d’IRCC semblent également avoir des conséquences sur les demandes administratives des résidents temporaires déjà sur le territoire. Les personnes possédant un permis d’études, mais nécessitant une extension – telles que Julie, étudiante française de quatrième année à McGill – voient déjà les effets dans leurs propres démarches. Elle explique : « J’ai envoyé ma demande de renouvellement fin avril, et je n’ai toujours pas de réponse d’Immigration Canada. Cela est frustrant, car, si je ne reçois pas mon permis d’étude d’ici le 1er décembre, je serai dans l’obligation de payer les frais de scolarité d’un étudiant international. Je vais obtenir mon diplôme à la fin de l’année 2025, et cela rend mon avenir à Montréal assez incertain. » Pour rappel, à McGill, les étudiants français et belges disposent d’une exemption de frais de scolarité internationaux, et paient ainsi le même montant que les Canadiens non québécois.
L’impact des étudiants internationaux
La baisse d’entrée d’étudiants internationaux dans les universités canadiennes risque par ailleurs d’enfoncer les dettes que présentent déjà certains établissements. Les étudiants internationaux paient généralement des taux de scolarité bien plus élevés – jusqu’à cinq fois plus – que les étudiants provinciaux et nationaux. À McGill, les revenus générés par ces frais servent à financer non seulement les cours, mais aussi des services, la recherche et les infrastructures des différents campus. Il se pourrait donc que différents départements se voient dans l’obligation de réduire l’offre de cours sur les prochaines années scolaires, et que certains services aux élèves soient réduits sur le campus. Les étudiants internationaux forgent le caractère de McGill ; la baisse du nombre de ces arrivées pourrait avoir un impact culturel sur la vie étudiante de l’Université. Avec des centaines de clubs et associations en tout genre, réduire l’immigration étudiante étrangère risque d’impacter la diversité et les expériences interculturelles dont s’est toujours vantée McGill.
Si des universités canadiennes comme la nôtre ont bâti leur réputation sur la richesse de leur diversité étudiante et l’accueil d’un grand nombre d’élèves internationaux, les prochaines années pourraient marquer un tournant. La diminution de ces arrivées menace non seulement l’équilibre des campus et les ressources qui en dépendent, mais aussi l’image d’un pays longtemps perçu comme une destination privilégiée pour s’établir en tant qu’étudiant ou travailleur.