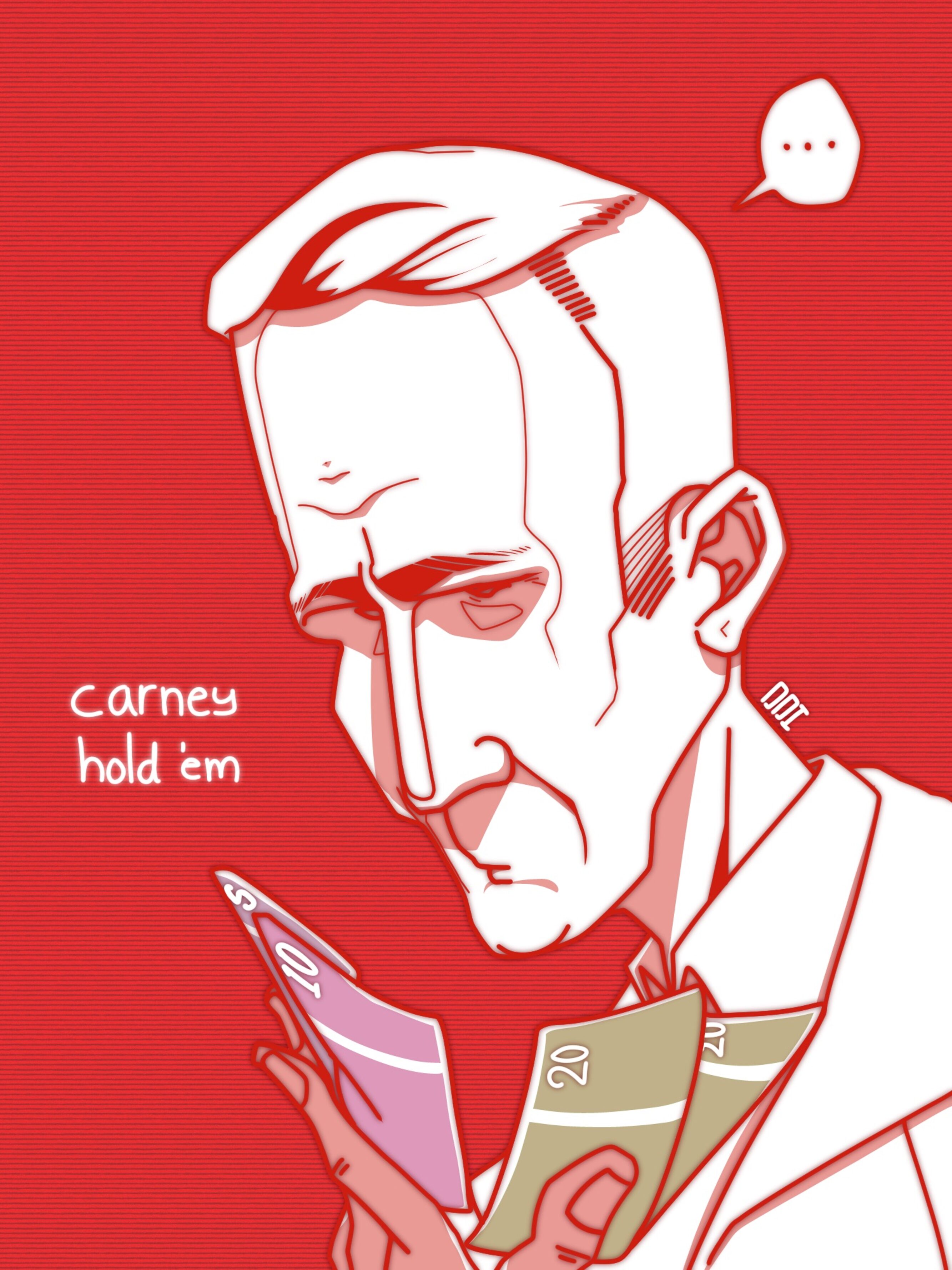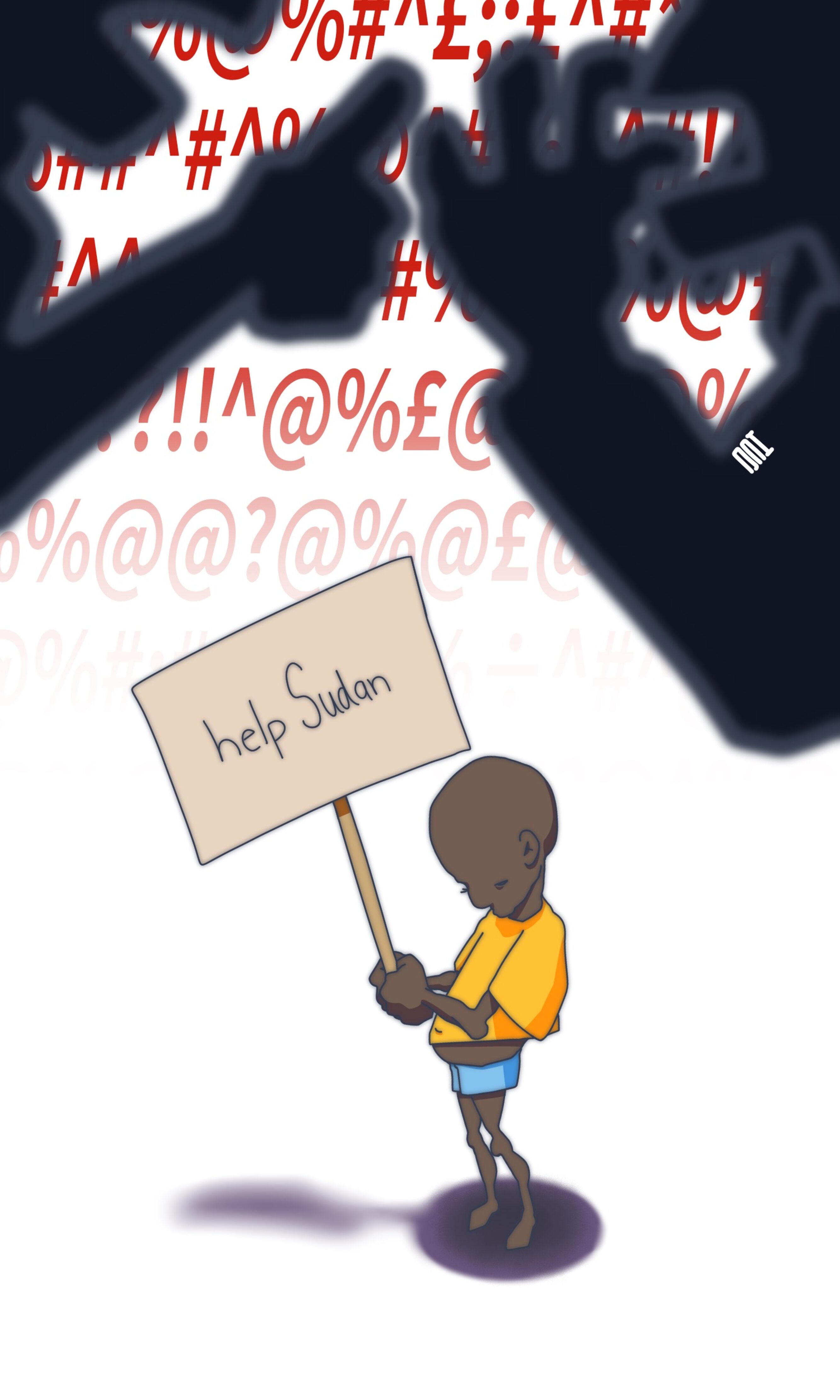« Bâtir un Canada fort » : c’est le titre du projet de budget déposé par le premier ministre fédéral Mark Carney au Parlement mardi 4 novembre. Le titre est évocateur : bien que les États-Unis – premier partenaire commercial du Canada – soient rarement cités dans le texte, on comprend qu’il s’agit ici d’un budget de réaction au durcissement majeur de la politique douanière américaine sous la présidence de Donald Trump. Afin de mieux comprendre comment ce budget répond aux défis politiques, mais aussi écologiques auxquels fait face le Canada, Le Délit s’est entretenu avec Julian Karaguesian, conférencier en économie à McGill et ancien conseiller du ministère fédéral des Finances, et Amy Janzwood, professeure de science politique à McGill, spécialisée en politique environnementale.
Un durcissement attendu de la frontière
D’après Karaguesian, ce budget survient certes en réaction à la politique trumpiste – tarifs sur les automobiles (25 %), l’aluminium, l’acier et certains produits en cuivre (50 %), ainsi que le bois et certains meubles – mais également dans un contexte plus large d’« isolationnisme » étasunien : « Nous vivons actuellement une accélération du durcissement de la frontière étasunienne sous la présidence de Trump, mais c’est une tendance qui a commencé dès le lendemain du 11 septembre (tdlr). » Il explique : « Il y a évidemment des raisons sécuritaires, mais également économiques [derrière ce durcissement, ndlr]. Les États-Unis ont le sentiment de ne plus être compétitifs. Ils doivent également financer leur immense armée, et ne peuvent politiquement pas augmenter les impôts, donc ils utilisent les tarifs. »
En réaction, Carney propose des investissements majeurs pour renforcer les exportations du Canada dans le reste du monde. Le budget prévoit notamment une dépense de 115 milliards de dollars dans la productivité, notamment dans les secteurs de l’énergie propre, de la manufacture et des « minéraux critiques » définis comme les minéraux sur lesquels « repose la technologie moderne », comme le lithium ou le nickel. Le premier ministre souhaite également stimuler l’économie interne du Canada, notamment par une dépense de 115 milliards de dollars dans les infrastructures canadiennes – hôpitaux, universités, routes, logements, systèmes d’approvisionnement en eau, et d’autres. Ces choix soulignent la « vision » de Carney, d’après Karaguesian : « Ce budget change la nature de notre modèle économique – historiquement basé sur le libre-échange avec les États-Unis – et l’oriente vers plus de croissance interne, et vers de nouveaux marchés étrangers, notamment l’Europe et l’Asie. »
Des dépenses, mais aussi des coupures
Il s’agit donc d’un budget dépensier : le premier ministre annonce un déficit de 78 milliards de dollars, soit 116 % de plus que l’année dernière. Selon Karaguesian, ce chiffre ne devrait pas inquiéter : « Beaucoup d’économistes s’intéressent au montant du déficit, mais il ne représente que 2,5 % du PIB. En périodes de crise comme en 2008 ou lors de la pandémie de la COVID-19 – le déficit des États-Unis, par exemple, pouvait dépasser les 10 %. » Il pointe, à l’inverse, les risques liés au manque d’investissement : « Prenons l’Argentine, qui était l’un des pays les plus riches dans les années 1930, et qui est maintenant chroniquement en crise, car elle n’a pas investi. Le Canada est encore riche, et il a la capacité de faire des investissements ; s’il attend trop longtemps, il finira comme l’Argentine. »
Pour pallier ses dépenses majeures, le budget prévoit néanmoins des coupures. Une de ses mesures principales prévoit la réduction du nombre d’employés de la fonction publique de 358 000 à 330 000 d’ici mars 2029, soit une réduction totale de 28 000 emplois à partir de l’année prochaine. Cette annonce a provoqué la colère des syndicats : Sharon DeSousa, présidente de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, a prévenu que la suppression de postes mènerait à « des délais d’attente plus longs pour obtenir son passeport, l’assurance-emploi, les prestations pour la garde d’enfants et les pensions, davantage d’appels sans réponse à l’Agence du revenu du Canada, ainsi que des programmes de santé publique et de sécurité alimentaire affaiblis ». Elle avertit le gouvernement : « Nous savons comment riposter. Le premier ministre Carney parle beaucoup de sacrifices, mais qui les fait réellement ? Ce ne sont ni les méga-entreprises ni les PDG. Non, une fois de plus, ce sont les gens ordinaires, les travailleurs, qui en paient le prix. »
Karaguesian est plus optimiste quant au coût social de la mesure : « Sur la dernière année, la fonction publique a déjà été réduite de 13 000 postes rien qu’avec les démissions et départs en retraite. Les 28 000 suppressions peuvent ainsi probablement être atteintes de la même manière, même si nous devrons également continuer à embaucher les nouvelles générations. »
Un volet climatique qui interroge
Les mesures climatiques du budget font également réagir. D’un côté, le gouvernement libéral mise sur sa « compétitivité climatique » et compte mettre de l’avant certaines industries liées à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il prévoit, par exemple, des crédits d’impôt pour les entreprises pratiquant le captage de carbone. Le budget propose également un investissement de 2 milliards de dollars dans un « fonds souverain pour les minéraux critiques », parmi lesquels certains sont essentiels au développement des énergies dites « propres ».
De l’autre, Carney ouvre la possibilité d’abandon du projet de plafonds sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l’extraction du pétrole et du gaz naturel, si les autres mesures de sobriété du gouvernement s’avéraient efficaces. Dre Janzwood, spécialisée en politique environnementale, regrette ce retrait : « Les plafonds sur les émissions offrent beaucoup de certitudes et de clarté. En opposition, les technologies, comme le captage de carbone, en plus d’être très coûteuses en subventions, ont une efficacité très discutable d’après la littérature scientifique. »
Plus généralement, Dre Janzwood se montre inquiète face au volet climatique du budget : « De nombreux éléments du budget étaient sur la liste de vœux de l’industrie du pétrole et du gaz. » Elle cite notamment la proposition de réouverture du débat autour de l’écoblanchiment (greenwashing), soit des déclarations floues ou malhonnêtes en matière d’engagements environnementaux des entreprises. La loi C‑59 de 2024, qui limitait très fortement cette pratique, est en effet jugée créatrice d’« incertitude à l’égard des investissements », et remise en cause par le budget.
La transformation de l’économie canadienne prévue par le budget semble ainsi passer par des sacrifices en matière environnementale. « Nous sommes dans un contexte économique difficile, mais ces reculs en matière environnementale ne sont pas nécessaires », déplore Dre Janzwood.