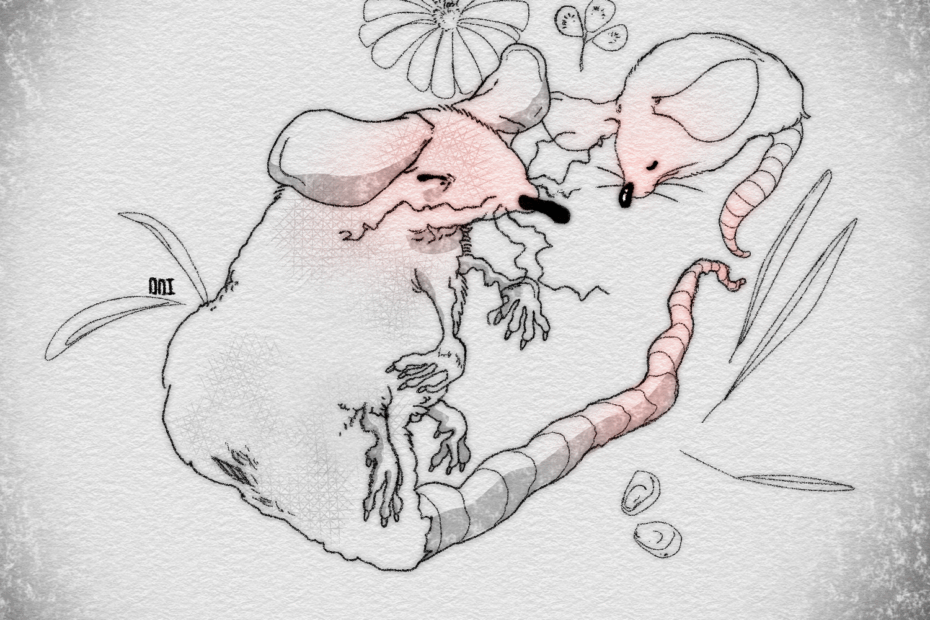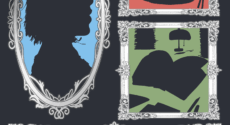Être un enfant, c’est avoir le droit à une merveilleuse désinvolture quant aux réalités de sa propre existence. Avec un peu de chance, l’enfance est pour un instant une existence dictée, dirigée et ordonnée. Vient ensuite une certaine conscience par rapport à soi-même, un regard interne qui résulte de la socialisation imposée par le milieu scolaire, terreau fertile de la comparaison.
Tout le monde se met à parler de sa fin de semaine, de ses vacances à Disney et d’autres anecdotes plus ou moins pertinentes… jusqu’ici, rien de plus anodin, me direz-vous. Mais derrière toutes ces péripéties puériles, un élément commun : les parents. Ils ont beau remplir à peu près tous la même fonction, ils sont loin de former un bloc social homogène. Au fil des années, l’enfant se lance immanquablement dans une comparaison quelque peu malsaine entre les parents qu’il a et ceux qu’il côtoie par l’intermédiaire de ses relations sociales. L’enfant devient critique du manque de laxisme de ses propres parents ou bien des différences pécuniaires qu’il remarquera inévitablement… Il construit ses parents idéaux en amalgamant toutes sortes de traits tirés d’une multitude de personnes.
Je ne prétends pas avoir énoncé ici une vérité universelle, mais c’est du moins la mienne et celle de bon nombre de personnes dans mon entourage. Nous sommes peut-être tous névrosés, remarque. Mais la comparaison que j’infligeais à mes parents n’était pas strictement fondée sur ce que mon esprit adolescent immature percevait comme une attaque à mes libertés individuelles. Je m’adonnais bien souvent à des divagations morbides, déprimantes. Voyez-vous, j’ai de vieux parents. Un vieux père surtout : il vient d’avoir 69 ans.
Je me suis récemment plongé dans mes archives prépandémiques pour constater que l’image que j’ai de mon père n’a presque pas changé en plus de 20 ans. Il est pour moi pris dans le temps, figé dans son rôle de père, sans jamais voir s’abattre sur lui le poids des années. Et pourtant, il est loin d’avoir été épargné par la vie. Il a vieilli, mais je me refuse à l’accepter. Il n’est plus aussi fringant qu’autrefois, lui qui a toujours été un féru des sports en tous genres, mais je peine à le laisser perdre de ses réflexes, de sa souplesse… Heureusement que le temps n’a eu aucun effet sur son intelligence acérée et son humour un peu déjanté. Je pense mettre le doigt sur un phénomène qui ne m’est pas exclusif : le déni. Le déni face aux cheveux gris et aux maux de dos, le déni face à la fatigue qui les consume lentement.
Je ne suis certainement pas le seul à avoir des parents plus âgés que la moyenne, mais je n’ai comme réelle expérience que mon enfance à vous partager. Que de tristes calculs, peinant à trouver le sommeil, pour voir combien de temps il me restait avec mon père. Je me disais que s’il se gardait en bonne santé, il pourrait bien me voir graduer, m’épanouir, peut-être fonder une famille comme la sienne… C’est pénible, toutes ces réflexions délétères.
Le lien parental a beau souffrir périodiquement des affres de la vie, il demeure bien souvent l’ancrage le plus solide de notre existence. Contrairement aux désaccords sur l’application des règles familiales internes, cette angoisse existentielle précoce se révèle bien plus difficile à vocaliser. Comment exprimer toutes ces peurs qui se mettront à gouverner chacun de nos choix ? Comment diriger sa frustration, son mal-être face à l’injustice forcée de notre venue au monde plus tardivement orchestrée ?
Vous me direz que je ne suis pas très bon dans la gestion de mes émotions. Si j’ai peur de la mort et de la menace qu’elle pose pour mon père, pourquoi ne pas lui en parler ? Sauf que la solution n’est pas aussi binaire. Même si son âge constitue un avantage indéniable quand vient le temps de m’initier à la musique de toutes les époques ou bien quand il se fait le raconteur de son enfance sur une ferme laitière, il distancie nos réalités et notre rapport à la vie. Il y a une sorte de fossé générationnel creusé d’avance, un lien non pas moins fort, mais différent. Mon lien avec lui tient davantage de la déférence, d’un certain respect pour cette expérience de vie si riche dont j’ai la chance d’être le bénéficiaire, qui complique cependant l’expression d’une certaine fragilité.
Pour moi, il est un personnage plus grand que nature, invincible, un modèle de résilience que je serais chanceux de pouvoir pâlement imiter. Plutôt que de lui partager mes craintes par rapport à l’avancée inexorable du temps, je lui lance des boutades. Des conneries de coin de table. On s’échange les moqueries les plus ridicules, et il m’arrive parfois d’y glisser un petit commentaire sur son âge. Maladroitement. Un grand classique des tourments psychologiques, cette obsession de faire de nos plus grandes peurs la risée de notre discours.
Maintenant que je n’habite plus chez mes parents, je dois avouer que ça me manque. La familiarité de la vie. La banalité d’un souper de famille. Et puis, tous ces moments contribuaient à rendre mon père plus proche de moi, non pas purement relationnellement parlant, mais simplement plus proche de ma vie. De mon quotidien. Essayer de lui expliquer comment fonctionne son téléphone, comment connecter son ordinateur à l’imprimante ou bien le mettre au fait des dernières tendances linguistiques… Toutes ces choses ont parfois été une source d’exaspération pour moi, et je m’en veux de ne pas avoir su en profiter quand je le pouvais. J’aurais voulu, j’aurais dû, j’aurais pu. À quoi bon dire ça maintenant, à part pour les effets cathartiques que ça pourrait me prodiguer.
Loin de moi l’idée de faire de cet article une sorte de journal intime de mes émotions refoulées. Sauf que le thème de notre édition, l’enfance, est de manière inhérente un sujet introspectif, surtout pour un banal journaliste d’opinion tel que moi. Quand je vous parle de fossé et d’angoisse, je ne peux donc que me fier à mon vécu, mais j’ai un espoir quelque peu sadique de ne pas être tout seul à me morfondre.
Les ravages de la vieillesse sont décuplés par le fait que nous la percevons trop tard. On ne réalise pas que l’on a de vieux parents un peu fragiles lorsqu’on est enfant ; on l’apprend, brutalement, quand commencent à poindre des signes de leur faiblesse. Mais surtout, quand on est assez vieux pour comprendre ce que ces signes impliquent. Ce qu’ils prophétisent.
Chaque famille vit des tragédies, mais nulle n’est plus communément terrifiante que celle de la souffrance anticipée. De la certitude presque mathématique que l’on sera le premier à perdre ceux qui ont façonné notre existence. Une douleur étirée dans le temps, étalée sur les années, une marque indélébile sur le quotidien fragile d’un enfant en plein développement. Les accidents, eux, tout aussi injustes qu’ils soient, ont au moins la décence de nous surprendre, de ne pas trop nous faire languir. Leur caractère imprévu est presque souhaitable devant l’agonie pernicieuse à laquelle nous condamnent les effets des années.
Quand on a de vieux parents, on doit longuement se faire à l’idée qu’on ne les aura pas pour longtemps.