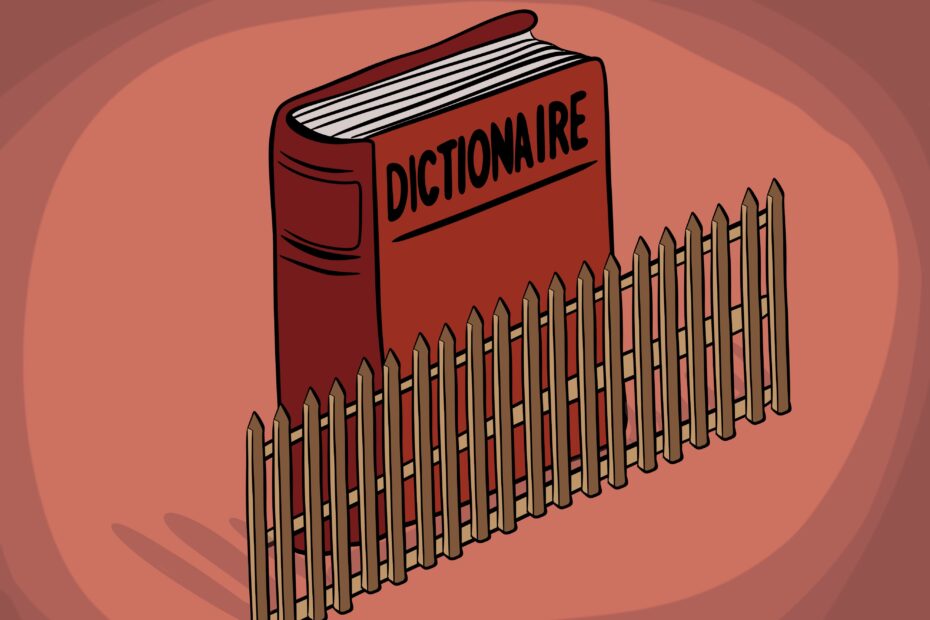Les élections municipales québécoises ont finalement pris fin après des mois de campagne. Qui dit élections dit forcément droit de vote. Ce dernier, au Québec, est réservé aux citoyens de plus de 18 ans. Et si les enfants avaient un mot à dire ? Dans son essai intitulé Pour le droit de vote dès la naissance, paru en septembre 2024, l’autrice et chercheuse Clémentine Beauvais nous invite à reconsidérer notre conception de l’enfance à travers un plaidoyer pour le droit de vote des enfants.
Dé-hiérarchiser la langue
L’un des arguments érigés contre l’inclusion des enfants dans la vie politique est la barrière de la compréhension. La langue y joue un rôle indéniable. Pour Clémentine Beauvais, ce n’est toutefois pas un obstacle incontournable : elle propose alors une simplification des communiqués. Elle mentionne le facile à lire et à comprendre (FALC), une traduction conçue pour un public vivant avec une déficience intellectuelle, ou encore les personnes en processus d’apprentissage de la langue, notamment les enfants. « Il faudrait apprendre à voir la simplicité comme une valeur, et non un échec de la pensée », écrit-elle. « Si trop de gens ne comprennent pas […], il faut faire différemment ».
En 2022, 22 % de la population québécoise présentait un niveau de littératie entre ‑1 et 1 (sur une échelle allant jusqu’à 5, où –1 correspond à la lecture de textes très simples et 5 à la compréhension de textes complexes et argumentatifs). Ainsi, une telle traduction alternative s’avère nécessaire pour éviter d’exclure ces personnes non seulement de la vie politique, mais aussi de la vie culturelle. En Europe, c’est l’association Inclusion Europe qui assure la diffusion de l’outil, tandis qu’au Canada, une norme semblable – dite du « langage clair » – a été publiée en octobre dernier par Normes d’accessibilité Canada (NAC) sur le site officiel du gouvernement canadien. Même si ce système de traduction cible les personnes en situation de handicap, sa mise en œuvre bénéficie à tout le monde, y compris les enfants, grâce à sa simplicité.
Clara, étudiante en linguistique à McGill, y voit un potentiel pour l’enrichissement de la société. Plurilingue, elle est d’accord que « l’exercice consistant à décomposer des textes complexes est essentiel dans le processus d’apprentissage et dans le développement de l’esprit critique et des capacités d’analyse et de compréhension (tdlr) ». Certes, sur le plan littéraire, certaines formulations risquent de perdre en partie leur richesse artistique dans cette simplification. Clara croit ainsi qu’il convient de « promouvoir l’équilibre et de présenter à la fois la version originale et simplifiée du texte ». Toutefois, l’implantation du FALC n’a pas pour but de remplacer le français (ou d’autres langues) standard, mais vise plutôt à encourager l’inclusion d’un plus grand public au sein de la société.
Culture : droit ou privilège ?
La question du langage dépasse cependant largement celle de la compréhension : elle touche également à la légitimité. Clémentine Beauvais aborde une « exclusion universelle » des enfants dans la sphère politique par le langage. Cette exclusion, par ailleurs, ne touche pas uniquement les enfants. En tant qu’immigrante de première génération, je l’ai concrètement vécue dès mon arrivée à Montréal. Si la langue détermine qui peut comprendre un discours politique, elle détermine aussi qui peut accéder à une chanson, un poème ou une pièce de théâtre.
On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Bien que certaines formes d’art ne nécessitent pas la langue pour passer leur message, cette dernière reste souvent l’intermédiaire entre une œuvre et son public. Je me souviens avoir regardé, avec mes parents, notre premier film de Noël. Les scènes étaient belles, mais l’intrigue tout à fait inintéressante. Nous avons passé 30 minutes devant la télévision sans comprendre ni les dialogues ni les sous-titres, à l’exception de quelques « bonjour » et « merci ». Ce moment m’a appris que la culture n’est pas universelle par essence ; elle le devient seulement quand tout le monde peut y accéder et comprendre ses codes.
En bref, l’idée d’accorder le droit de vote aux enfants n’est pas à prendre au pied de la lettre. C’est une expérience de pensée nous permettant de forger une meilleure démocratie. Si tel devenait la norme, nous serions poussés à rendre le langage – et, par extension, la culture – plus accessibles. Beauvais conclut qu’avec « le droit de vote dès la naissance, nous ne pourrions plus ignorer [les inégalités causées par l’incompréhension, ndlr] ». Après tout, être ici, « c’est déjà une forme d’expertise sur le monde ». Comprendre, c’est déjà participer.