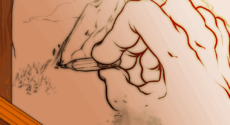Le Festival international de Films de Montréal (FIFM) célébrait sa troisième édition du 22 au 24 août au Vieux-Port de Montréal. Pendant trois jours, 28 films venus de 25 pays différents ont été projetés dans une ambiance conviviale, où cinéastes, étudiants et curieux se croisaient au détour des projections et des discussions publiques. Fidèle à sa mission, le festival présente le cinéma comme outil de transformation sociale et de mémoire collective. Cette année, deux courts métrages en particulier ont attiré l’attention du public : Ne sois pas en retard, Myra (Don’t be late, Myra) (2024) de la réalisatrice pakistano-américaine Afia Nathaniel, et Au-delà du silence (Beyond Silence) (2024) de l’actrice et scénariste néerlandaise Marnie Blok. Deux œuvres très différentes, mais unies par la même volonté : mettre en lumière la violence faite aux femmes et la difficulté d’en parler.
Entre innocence et ombre
Avec Ne sois pas en retard, Myra, Afia Nathaniel livre un film à suspense glaçant. Le film suit Myra, jeune fille de dix ans, qui rentre seule de l’école à travers les rues de Lahore, au Pakistan. La réalisatrice ne s’arrête pas à cette tension de surface. Le vrai choc surgit au moment où l’on comprend que le danger ne se trouve pas seulement à l’extérieur. L’agressivité masculine qu’elle croise sur son chemin n’est que l’avant-goût d’un secret bien plus lourd, tapi dans le silence de sa maison. Sans dévoiler l’intrigue, disons simplement que la maison, censée être son refuge, se révèle tout aussi étouffante. L’horreur y prend racine dans le silence, un silence d’autant plus cruel qu’il est familial.
Visuellement, le film est marqué par un motif récurrent : des ballons colorés qui échappent aux petites mains de la jeune fille. Ces ballons, simples objets d’enfance, deviennent symbole d’une innocence toujours menacée. Nathaniel ne filme pas la violence de manière frontale, mais à travers ces indices subtils qui frappent l’imaginaire collectif. Plusieurs spectateurs, à la sortie de la projection, ont souligné à quel point cette image des ballons s’envolant restait imprimée dans leur mémoire, comme une blessure à la fois belle et tragique, une métaphore simple, mais partagée par tous.
La voix donnée au silence
Si Ne sois pas en retard, Myra explore la peur et le traumatisme dans l’enfance, Au-delà du silence de Marnie Blok aborde le même thème à travers la parole adulte. Situé aux Pays-Bas, le court-métrage suit Eva, doctorante sourde, victime d’une agression sexuelle de la part d’un professeur. Elle tente de briser le silence auprès de son aide pédagogique, Sandrine, mais se heurte à une forme de scepticisme désabusé. Au fil de leur dialogue, on comprend que la conseillère elle même a vécu une histoire similaire, choisissant autrefois de la taire.
Le court-métrage repose sur la confrontation de ces deux trajectoires. Là où Eva incarne une génération qui refuse l’omerta malgré le risque de compromettre son avenir universitaire, Sandrine porte le poids du silence comme une seconde peau. Le spectateur est invité à réfléchir : qu’est-ce qui a changé en vingt ou trente ans ? Sommes-nous réellement dans une société plus à l’écoute des victimes, ou seulement dans une époque où le silence est devenu plus difficile à tenir ?
La mise en scène est minimaliste, presque théâtrale. Le miroir dans lequel la protagoniste se regarde traduit la culpabilité intériorisée partant de victimes. Le plan final, une fenêtre traversée de lumière, évoque au contraire la possibilité d’un futur plus juste. Ces symboles pourraient sembler appuyés, mais la réalisatrice les traite avec une sobriété qui laisse respirer le récit.
Quand le cinéma devient mémoire
Présentés au FIFM, ces deux films ne se contentent pas de raconter des histoires individuelles : ils rappellent qu’un système entier contribue à étouffer la voix des victimes d’abus. Dans les rues de Lahore ou dans les couloirs feutrés d’une université européenne, le mécanisme est le même : la peur, le doute, le silence imposé. En choisissant d’afficher ces œuvres, le FIFM s’affirme non seulement comme un espace de diffusion cinématographique, mais aussi comme un lieu de mémoire et de résistance. Cette fin de semaine-là, le cinéma n’a pas seulement projeté des images : il a donné une voix aux silences trop longtemps ensevelis.