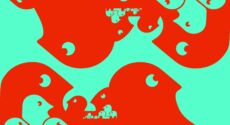L’Institut d’études sur le Canada a tenu le 15 février dernier une conférence bilingue d’Émilie Nicolas, chroniqueuse chez Le Devoir et The Gazette, universitaire et activiste connue pour sa collaboration et ses publications dans divers médias en français et en anglais. Elle affirmait qu’il y aurait un clivage entre les médias francophones et anglophones lorsque surviennent des conversations au sujet du racisme et de la réalité coloniale. Selon elle, ces discours tendent vers une compétition du meilleur colonisateur entre les groupes linguistiques et au rejet du blâme de la colonisation. Elle a également discuté des particularités de la lutte décoloniale et antiraciste résultant du bilinguisme canadien.
La conférencière a introduit le sujet en lien avec son expérience dans une campagne pour que le gouvernement du Québec reconnaisse l’existence du racisme systémique en 2016. Elle a expliqué que la notion de racisme systémique était alors moins utilisée en français. Elle dénonce que les discours gouvernementaux favorisent plutôt la promotion du vivre-ensemble : « C’est plutôt vague, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire », a‑t-elle dit. Cette campagne avait reçu davantage d’attention de médias anglophones même si la majorité des porte-paroles étaient francophones. C’était alors à titre de commentatrice de la couverture des manifestations Black Lives Matter (Les vies Noir·e·s comptes, ndlr) aux États-Unis qui lui avait permis, ainsi qu’à ses collègues, de rappeler que ces enjeux existent encore au Québec. Des politiciens comme Jean-François Lisée avaient alors soutenu que le racisme systémique serait un concept « anglais » qui n’existerait pas au Québec. Le débat s’était polarisé le long des lignes linguistiques, a résumé Émilie Nicolas. Elle dénonce que « beaucoup de temps et d’énergie ont dû être dépensés pour déterminer ce qu’il était acceptable de dire comme Québécois racisés, en français et en anglais ».
Voir aussi : Les langues collaborent aux quotidiens
La conférencière a notamment expliqué que les francophones du Québec sont mieux outillés pour discuter des enjeux linguistiques en détail, alors que les anglophones du Canada et d’ailleurs ne partagent pas cette sensibilité. Ce clivage poserait aussi obstacle aux discussions et aux échanges entre les groupes linguistiques. Elle a soutenu qu’il en résulte une différence entre les discours acceptés en français et en anglais, ce qui complique le travail des militants décoloniaux et antiracistes. « Ça nous donne une hyper-conscience par rapport aux mots, au vocabulaire que nous employons, mais aussi dans quelle langue nous tenons ces propos. C’est vraiment spécifique au Canada comme enjeu dans la militance », a‑t-elle dit.
Émilie Nicolas a défini le racisme et le colonialisme comme des discours servant à « légitimer l’accumulation inégale des capitaux entre les mains d’une élite blanche par la déshumanisation et l’exploitation du travail d’autres personnes ». Ils prendraient ainsi différentes formes à travers le temps et l’espace comme tout discours : « Tous ces régimes ont des façons particulières d’opérer. Ils ont des discours qui sont spécifiques même si la logique est commune », a‑t-elle soutenu. Elle a ajouté que « partout en Occident où il est question de colonialisme, il est question de suprématie blanche ». Elle a donné l’exemple de la France où la doctrine du républicanisme a amené l’État à être « aveugle » à la race en ignorant les inégalités raciales. Un autre exemple serait l’Amérique du Sud, où la prévalence du métissage a permis de masquer les violences structurelles associées à la race. « Le réflexe du déni ou de légitimer la hiérarchie [raciale], la distribution des capitaux dans une société, la façon dont le pouvoir est distribué dans une société, c’est partagé. Ceci dit, dans chaque société, il y a des spécificités dans la manière dont ça s’articule », a‑t-elle expliqué. Toutefois, la particularité du Canada repose sur la manière dont ces discours racistes s’entremêlent au bilinguisme du pays.
Selon Émilie Nicolas, le Canada serait « la meilleure campagne de marketing », puisqu’il a réussi à créer un univers de symboles comme l’érable du drapeau du Canada. Cela donnerait l’image d’un pays libéral, bienveillant et courtois en comparaison aux États-Unis. Cette apparence servirait à dévier l’attention des injustices et des systèmes de violence perpétrés contre les peuples autochtones et la population racisée.
Au Québec et au Canada, Émilie Nicolas a donné comme exemple le débat entre l’interculturalisme et le multiculturalisme. Les adeptes du premier reprochent au multiculturalisme de réduire le fait français et la culture francophone à une minorité parmi les autres dans le contexte de la culture dominante anglophone. Elle a toutefois soulevé que malgré cette critique, l’interculturalisme tombe lui aussi dans le même piège car il accorde une place centrale à « la culture québécoise ». Cependant, ces deux discours – le multiculturalisme et l’interculturalisme – relègueraient à l’arrière-plan la domination des groupes colonisateurs sur les peuples autochtones et les personnes racisées.
Selon la conférencière, il persiste à ce jour dans une partie du Canada anglais une volonté de ne pas reconnaître que l’inégalité entre les groupes colonisateurs contribue à la suprématie des descendants anglais. Dans cette perspective, la colonisation britannique serait constamment un projet à compléter : « Les francophones sont perçus comme “difficiles” de ne pas se laisser assimiler et d’insister sur le maintien de leur différence.» Elle a ajouté que « tellement de gens tiennent ces propos sans se rendre compte de la violence coloniale qui y est inhérente ».
Toutefois, les francophones, et en particulier les Québécois, seraient habitués à se voir comme les plus persécutés du Canada. Cette perception leur donnerait de la difficulté à concevoir leur rapport de domination par rapport aux peuples autochtones. Selon elle, les développements amenés par la Révolution tranquille et l’avènement de la classe moyenne québécoise ont contribué à intégrer les Québécois dans la blancheur contemporaine.
Ces attitudes contribuent au clivage linguistique, ce qui mènerait selon elle à des façons différentes de vivre et de comprendre les enjeux de politiques publiques. Autrement dit, il y aurait des décalages entre groupes linguistiques sur ce qui est compris comme des problématiques ou des enjeux. Ces décalages nuiraient à la productivité des échanges et discussions, a expliqué la conférencière. Par exemple, lors de la campagne électorale fédérale, c’était la formulation jugée offensante de la Loi sur la laïcité de l’État (couramment appelée Loi 21, ndlr) qui aurait retenu l’attention, et non un débat sur la légitimité et l’impact de la Loi. « C’était un moment qui était frustrant pour les personnes qui sont musulmanes évidemment, mais aussi celles qui sont racisées », a‑t-elle soutenu. « Le fait qu’on ne s’écoute pas et qu’on ne regarde pas comment les dynamiques de racisme et de colonialisme s’appliquent à l’échelle rendent plus difficiles les conversations sur cette Loi ».
Voir aussi : Réconcilier les langues
Émilie Nicolas a soulevé qu’à Toronto, le bilinguisme officiel est perçu comme une barrière d’entrée aux postes gouvernementaux pour les personnes racisées. Elle souligne que retirer l’exigence des deux langues ne règlerait pas le problème. Par exemple, elle a souligné que plusieurs personnes de Montréal-Nord n’ont pas l’opportunité d’apprendre l’anglais. « Ne pas parler français n’a jamais empêché les hommes blancs de dominer dans plusieurs départements ». L’apprentissage d’une deuxième langue est dans plusieurs endroits au pays réservé aux personnes privilégiées, peu importe leur langue maternelle.
La conférencière a conclu sa présentation en résumant la tension entre les deux approches. D’une part, le déni de la violence raciste et coloniale n’a rien d’unique au Canada ; il faudrait donc s’y opposer comme ailleurs. Toutefois, elle note que le bilinguisme empêche de reprendre les théories de justice sociale issues des grandes universités américaines ou d’ailleurs telles quelles. Il y aurait donc un travail à faire pour décortiquer les récits collectifs locaux afin de faire évoluer les mentalités.