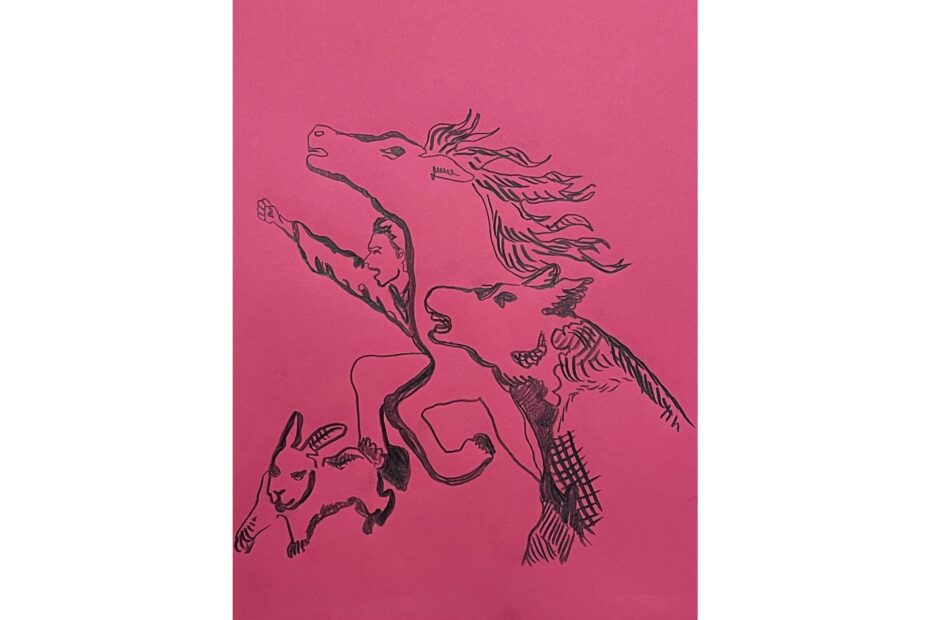Peu de livres m’ont autant marqué que La philosophie à l’abattoir : Réflexions sur le bacon, l’empathie et l’éthique animale. L’écriture vulgarisée et exempte de paternalisme, chose rare dans les sphères militantes véganes, a su me convaincre de ne plus consommer de produits animaux. Ce petit ouvrage de 94 pages écrit par Catherine Bailey, candidate au doctorat en philosophie à l’Université de Montréal, et Jean-François Labonté, professeur de philosophie au Cégep de Sherbrooke, est un chef‑d’œuvre d’introduction au véganisme. La philosophie à l’abattoir vise d’abord à informer et persuader les non-véganes, et ensuite à promouvoir la perspective intersectionnelle pour les initiés.
La métaphysique de la viande
L’histoire racontée dans le livre débute avec le philosophe français René Descartes, à l’origine du fameux « Je pense, donc je suis », qui affirme que les animaux ne seraient que des assemblages complexes de pièces dénués de toute forme de conscience. Les comportements animaux qui semblent être liés à des affects comme la souffrance ou le plaisir ne seraient en réalité que des imitations mécaniques des émotions humaines. Après tout, comment pourraient-ils réellement ressentir s’ils n’ont pas une âme pareille à celle qui confère à l’humain son statut divin ?
Après ce départ obligé au 17e siècle, le livre quitte la sphère proprement philosophique en sautant directement à la Déclaration de Cambridge sur la conscience, signée en 2012 par un groupe d’éminents scientifiques. Le texte de la déclaration stipule que de nombreuses espèces animales possèdent une circuiterie neuronale aux capacités similaires à celle des êtres humains en ce qui a trait à l’expérience consciente. L’incapacité de la philosophie à décrire l’expérience animale au cours des trois siècles qui nous séparent de Descartes a laissé un vide que la science a tenté de combler. Plutôt que de dire : les animaux sont conscients, elle déclare : les animaux sont conscients de manière similaire aux humains. À nous d’en tirer nos propres conclusions.
Le saut temporel du 17e siècle à 2012 peut sembler abrupt pour les historiens et pour les véganes assidus, mais il aide à la visée pédagogique de l’ouvrage auprès du grand public. Afin de se rapprocher encore plus du public québécois, il explore ensuite l’état de sa législation provinciale et fédérale. Lorsque l’on examine le droit des animaux domestiques – soit tous les animaux sauf les animaux sauvages – du Québec, on constate qu’il se résume à deux éléments : la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (ou loi BÊSA) et l’article 898.1 du Code civil du Québec. La loi BÊSA propose une série d’exigences que doivent suivre les propriétaires d’animaux. Elle stipule toutefois que les animaux d’élevage et de recherche sont exclus de ces protections. Le Code civil du Québec, quant à lui, accorde le statut d’« êtres doués de sensibilité » aux animaux mais ajoute que ceux-ci ne sont que des biens aux yeux de la loi. En bref, la protection des animaux québécois est pour l’instant principalement symbolique.
En laissant de côté les « trois âmes » d’Aristote, l’autonomie kantienne et les points de vue des différentes traditions religieuses et spirituelles, ce premier portrait des débats sur la question animale réduit son histoire à deux thèses : soit les animaux sont des machines, soit ils sont comme les humains. L’ambition de cet ouvrage introductif n’est pas de répertorier toutes les pensées sur la question puisqu’il doit demeurer accessible au grand public (un chapitre décrit néanmoins d’autres approches de l’histoire). Toutefois, souligner cette opposition fondamentale sert l’argumentaire des auteurs, qui voient dans cette dichotomie une raison de plus d’aborder les questions d’éthique animale à travers le prisme de l’intersectionnalité.
« L’histoire du véganisme serait en fait indissociable des autres luttes sociales »
Spécisme, sexisme, racisme et cie
Que manque-t-il à l’humain pour agir correctement envers les animaux ? De l’empathie, répondraient probablement Christiane Bailey et Jean-François Labonté. S’imaginer ce que cela ferait d’être un porc, une vache ou un poulet est une tâche impossible pour un être humain, l’être-au-monde des animaux étant radicalement différent du nôtre. Pour éviter l’impasse, les auteurs nous proposent alors de plonger dans la science-fiction. Utilisant un épisode de The Twilight Zone, une série des années 60, dans lequel des extraterrestres arrivent sur Terre pour manger l’humanité, ils introduisent le concept-clé de spécisme.
Le spécisme est l’attitude selon laquelle l’appartenance à une espèce est un critère suffisant pour traiter un individu de manière différente. Ce concept n’est pas sans rappeler les autres ‑ismes : sexisme, racisme, capacitisme, etc. De la même manière que le mépris d’un extraterrestre spéciste envers l’humanité justifie à ses yeux l’asservissement de notre espèce, celui d’un esclavagiste blanc envers les autres couleurs de peau lui permet de dormir tranquille malgré toute la souffrance qu’il inflige. Ce n’est pas simplement que les arguments racistes et spécistes se ressemblent, défendent les auteurs. L’histoire du véganisme serait en fait indissociable des autres luttes sociales. Ils soulignent par exemple que non seulement les défenseurs des droits des animaux étaient-ils péjorativement décrits comme féminins, mais que de nombreuses pionnières des droits des femmes dénonçaient également les conditions des animaux.
Une conséquence de cette influence féministe est l’émergence de l’éthique du « care », ou de la « sollicitude », comme approche de l’éthique animale. Plutôt que de se préoccuper de règles universelles comme la maximisation du bonheur ou l’autonomie, la sollicitude demande une considération au cas par cas, en prenant en compte les structures de pouvoir qui rendent inopérantes toute tentative d’universalisation des actions. Sans se contenter d’accorder des droits aux animaux, les tenants de la sollicitude soutiennent un changement de paradigme : il s’agirait de voir l’animal non pas comme un bien mais comme un être dont on doit se soucier. Une conséquence de cette doctrine, par exemple, serait qu’il ne faut pas libérer tous les animaux de ferme dans la nature sans se préoccuper de leur devenir, car des pratiques historiques ont fait de certaines espèces des membres d’une communauté humaine. C’est entre autres le cas des vaches laitières, dont le pis énorme est le résultat d’une sélection artificielle et qui seraient complètement vulnérables si elles n’étaient pas protégées des prédateurs. Les auteurs expliquent ensuite la vision proposée dans Zoopolis : une théorie politique des droits des animaux, écrit par Will Kymlicka et Sue Donaldson en 2011, qui prévoit plusieurs niveaux de citoyenneté pour les animaux en fonction de leurs relations actuelles avec les êtres humains.
Finalement, La philosophie à l’abattoir ne présente pas l’urgence climatique comme argument premier pour la défense du véganisme. Il est vrai que la consommation actuelle de viande et de produits de l’élevage est insoutenable et conduira certainement l’humanité à sa perte si elle n’est pas réduite. Cette perspective est toutefois problématique en ce qui concerne l’éthique animale, car elle réduit l’animal à un polluant, ce qui s’opposerait aux visées de l’éthique de la sollicitude. Le problème de l’élevage, comme bien d’autres, ne sera réglé que si l’on développe un réel souci pour autrui. La beauté de tout cela ? Rien n’empêche chacun d’entre nous de commencer ce projet dès aujourd’hui.