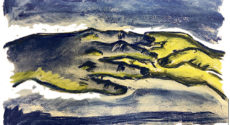Dans cette entrevue, les termes négritude et négrophobie se veulent être des traductions respectives des termes anglophones blackness et antiblackness. Si ces expressions françaises ne permettent pas, dans leurs sens premiers, de transmettre les significations exactes des concepts anglophones traduits, elles nous poussent à nous interroger sur l’imperméabilité de la langue française aux questionnements des dynamiques raciales.
Le Délit (LD) : Bonjour professeur Howard. Tout d’abord, pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours académique, ce que vous enseignez à McGill, mais aussi vos aires de recherche et d’expertise ?
Philip Howard (PH) : Ok, vaste question. Commençons par l’université. J’ai fait mon premier cycle à l’Université Cornell aux États-Unis. À l’époque, j’étais intéressé par les sciences biologiques, et j’ai donc une expérience en tant que professeur de sciences et de mathématiques en école secondaire. Mais j’ai toujours eu un intérêt pour le milieu académique et j’ai voulu l’explorer comme une façon de poursuivre le travail que je faisais. J’ai donc obtenu un diplôme en éducation — lorsque le programme s’appelait encore ainsi — à McGill. J’ai aussi fait une maîtrise à McGill, puis mon doctorat à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto. Et maintenant je suis ici (professeur au Département des études intégrées en science de l’éducation, ndlr). Concernant mes plus larges domaines de recherche, je m’intéresse à la négrophobie et à de plus larges relations sociales racialisées dans un contexte colonial ; et comment cela impacte, non seulement les écoles — les façons habituelles dont nous concevons l’éducation —, mais aussi les façons dont nous apprenons à nous connaître, à comprendre qui nous sommes, à comprendre ce qu’est la vie en communauté et aussi ce que cela signifie vraiment de vivre dans ce contexte et de résister dans ce contexte.
LD : Pourriez-vous nous partager vos réflexions sur les applications de votre recherche en contexte mcgillois, ou académique plus généralement ? Y a‑t-il des processus pédagogiques ou non-pédagogiques à travers lesquels la violence et l’injustice coloniale et/ou raciale, et particulièrement la négrophobie, sont perpétrées — consciemment ou non, comme la campagne de changement de nom — en milieu universitaire ?
PH : Oui, encore une question très vaste. Parmi mes projets, l’un d’entre eux sur lequel j’ai beaucoup travaillé ces dernières années, est la façon dont le blackface se manifeste au Canada à l’époque contemporaine. Et je suis particulièrement intéressé par le fait qu’il apparaisse dans les milieux éducatifs bien plus que n’importe où ailleurs. Et donc, quand vous entendez parler d’incidents de blackface, ils surviennent sur les campus universitaires et de plus en plus — bon, j’espère que ce n’est pas vraiment de plus en plus — mais, notamment, souvent maintenant, dans les écoles secondaires et primaires. C’est donc une inquiétude, et une grosse partie du travail que je continue à faire se penche sur ce qui, dans les milieux éducatifs, invite à ce genre de manifestation de la négrophobie, et comment nous en venons à les reconnaître comme un problème. Parce que l’une des choses qui arrive souvent c’est que les administrations universitaires ne le voient pas comme un gros problème : de « Ce n’est pas du tout un problème » il y a quelques années à « Ok, bon, nous ne voulons pas nous en occuper parce que c’est un sujet sensible pour les personnes noires », mais sans vraiment saisir les plus larges implications de ce genre d’actes.
L’éducation de l’État et les institutions éducatives traditionnelles ne servent pas à nos besoins comme ils se doivent d’être servis
Et vous avez aussi mentionné la campagne de changement de nom et c’est vrai qu’il y a des parallèles. De la même façon dont le blackface est une des plusieurs manifestations de la négrophobie dans les espaces universitaires et académiques, le problème qu’aborde la campagne de changement de nom est un exemple de racisme anti-autochtone , comment il fonctionne et comment il peut souvent être banalisé. Vous savez, on entend : « Ce n’est pas une grosse affaire, n’en faisons pas une grosse affaire » puis l’on arrive à un point où il y a au moins la reconnaissance de l’existence d’un problème. Mais c’est une inquiétude continue.
LD : Y‑a-t-il aussi des façons dont votre recherche s’articule à de plus larges échelles, par exemple aux échelles canadienne et montréalaise, et peut-être au-delà du problème du blackface ?
PH : Oui, l’un de mes autres projets, plus récent, observe les façons dont les communautés noires, à Montréal et à travers le Canada, ont toujours eu besoin de complémenter les initiatives éducatives fournies par l’État et les universités. Et donc, où que vous alliez, vous voyez des écoles noires du samedi, de la fin de semaine, des programmes après l’école, des programmes d’école d’été, parfois des écoles alternatives dans le système, parfois des écoles alternatives à l’extérieur du système. Nous sommes constamment en train de faire quelque chose pour agir face au fait que l’éducation de l’État et les institutions éducatives traditionnelles ne servent pas nos besoins comme ils se doivent d’être servis. Cette recherche récente en est à ses premières étapes et nous n’avons donc pas encore beaucoup de choses à reporter à part l’anecdotique que nous connaissons probablement déjà tous·tes. Mais elle s’intéresse à la façon dont ces besoins ont été articulés et quelles sortes d’interventions ont été entreprises et avec quels effets.
LD : Dans votre recherche vous parlez d’initiatives éducatives supplémentaires des communautés noires, est-ce à cela que vous faites référence ?
PH : Oui, tout à fait. Et mon point est que cela arrive de multiples façons, ce qui veut dire que nous ne restons pas toujours engagé·e·s dans le système [éducatif standard].

LD : Pensez-vous qu’il y ait des défis particuliers auxquels doivent faire face les communautés noires au Québec, peut-être en lien avec la langue française ?
PH : Je pense que je commencerai en disant qu’il y a une certaine façon dont le Québec se plait à formuler les problèmes, les luttes, et les oppressions des personnes noires vivant au Québec en termes linguistiques. Et donc il y a beaucoup d’attention mise, par exemple, sur les communautés noires anglophones et pourquoi elles ne réussissent pas. Et la réponse, pour autant que le discours dominant est concerné, est qu’elles ne parlent pas français. Puis on arrive aux communautés haïtiennes, mais cette fois-ci on dit : « Eh bien, ils·elles parlent kreyol, ils·elles ne parlent pas vraiment français. » Et ça devient assez troublant. Ils semblent que tous les efforts fournis conduisent à compresser ces problèmes en des termes linguistiques. Et comme le montrent les travaux récents de Délice Mugabo (doctorante en géographie à l’Université de la ville de New York, ndlr), la négrophobie ne répond pas à ces lignes linguistiques. Nos difficultés avec l’État/la province ne sont pas à propos de la langue que nous parlons. Celle-ci peut rentrer en jeu de multiples façons, mais n’est pas la source du problème. Et une partie de la recherche que je mène avec ce dernier projet [d’initiatives éducatives supplémentaires des communautés noires] est aussi pour élargir un peu cet angle. Et nous avons beaucoup de personnes qui parlent français couramment, ou des enfants qui vont à l’école ici — qu’importe leurs langues natales — et qui parlent très bien français, mais se confrontent encore à ce genre de difficultés d’exclusion, de pénurie d’emplois, et caetera, et caetera, qui sont les problématiques principales [affectant les communautés noires]. L’un de mes problèmes majeurs est que nous tendons à voir cela en termes de langage et d’immigration. Considérer [ces problématiques] en termes de langues, c’est ne pas comprendre les façons dont la négrophobie traverse les barrières du langage. Les considérer en termes d’immigration, c’est ne pas reconnaître la longue présence noire au Canada, au Québec et à Montréal, et la persistance du facteur négrophobe à travers le temps.
Considérer [ces problématiques] en termes de langues, c’est ne pas comprendre les façons dont la négrophobie traverse les barrières du langage
LD : Justement, vous parlez de la longue présence afro-descendante au Canada, et vous travaillez aussi éminemment dans le domaine des Études afro-canadiennes. Quels sont selon vous certains processus qui caractérisent l’expérience afro-canadienne et la singularisent face à d’autres expériences vécues par d’autres communautés de la diaspora africaine, qu’elle soit afro-américaine ou afro-caribéenne par exemple ?
PH : C’est une question très intéressante. Je pense qu’il faut être prudent·e·s quand on parle de négritude et de négrophobie. Prudent·e·s à propos des manières dont on pense qu’elles sont contenues à l’intérieur des frontières nationales et provinciales. La négrophobie est très multinationale, transfrontalière, très globale en ce sens. Et donc je crois encore que l’un des problèmes que nous avons est que nous avons tendance à dire « Eh bien, vous savez c’était aux États-Unis, pas ici », comme s’il y a des différences énormes entre les deux endroits et que des analogies ne peuvent pas être dessinées. Il faut que nous réfléchissions à savoir à quel point les frontières étatiques sont saillantes à la négrophobie.
Commençons ici. Toutefois, ayant dit cela, il y a certaines choses qui marquent l’expérience canadienne de façons légèrement différentes que l’expérience étasunienne par exemple. L’une de ces choses serait l’effacement de la négritude. Aux États-Unis, il y a un problème de négrophobie ; l’on comprend qu’il existe et que les populations noires existent. Ici, il est difficile de faire savoir, premièrement, que les personnes noires ont été ici depuis au moins 1629 avec Olivier Le Jeune, si ce n’est plus tôt avec Mathieu da Costa, et deuxièmement que les populations noires ont été mises en esclavage au Canada — une réalité qui est souvent effacée par les récits autour du chemin de fer clandestin (Underground railroad, ndlr). Parce que, pendant une courte période de 15 ans, entre le début du Fugitive slave Act et l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, les gens s’échappaient ici pour fuir l’esclavage, il y a une impression qu’il n’y a pas eu d’esclavage au Canada. Et bien sûr, ce n’est pas le cas. Il y a de nombreuses stratégies qui sont utilisées pour effacer la présence noire ici. Dre. Dorothy Williams (docteure en histoire, spécialiste d’histoire noire canadienne, ndlr) s’exprime sur ce sujet comme étant une mesure très délibérée de la part des historien·ne·s, de traiter la présence noire et l’histoire de l’esclavage au Canada d’une façon particulière. Ce n’est pas un oubli, c’est en fait un geste intentionnel. Et si l’on fait cela correctement, l’on peut alors formuler, particulièrement au Québec, toute présence noire comme arrivée récente. Et si toutes les personnes noires sont arrivées récemment, premièrement l’étendue de leur contribution est niée, deuxièmement nous pouvons attribuer leurs difficultés à des problématiques d’immigration, ce qui ne tient pas la route.
LD : Et trouvez-vous qu’il existe un intérêt grandissant pour les Études afro-canadiennes ? Ces problèmes dont nous parlons, d’effacement de la présence noire au Canada, sont-ils encore largement ignorés ou, au contraire de plus en plus abordés ? Quels sont les enjeux actuels de ce champ d’études ?
PH : Je pense que l’enjeu contemporain ayant trait à la présence noire au Canada a dérivé d’une problématique d’effacement total à une problématique d’effacement implicite. Les difficultés des populations noires sont souvent pensées indistinctement comme des difficultés raciales, et ceci n’accorde alors aucune compréhension à la spécificité et la différence d’expérience d’une personne noire comparée à une personne d’une autre communauté racisée. Si vous pensez en termes de présence racisée sans véritablement comprendre la présence noire comme étant différente, alors vous passez complètement à côté de la question noire et perpétuez la négrophobie. L’une des préoccupations que nous avons maintenant est, qu’en cachant nos inquiétudes, en ne les nommant pas négrophobie, mais souvent en les groupant simplement sous le parapluie du terme racisme, nous perdons la spécificité de la négritude. Parce que c’est une expérience différente qui s’est formée autour de dynamiques opérant différemment. De façon générale, la négrophobie place les personnes noires en dehors du domaine humain, tous les autres êtres humains sont définis par leur différence avec la négritude. Et vous avez alors même des membres d’autres communautés racisées qui prennent leur distance avec les communautés noires de façon à se soutenir eux·elles-mêmes.
LD : Est-ce qu’il y a beaucoup — ou de plus en plus — de recherche qui est en train d’être faite à McGill, sur la condition noire et sur les expériences des communautés noires ?
PH : Je ne peux pas vraiment dire s’il y en a de plus en plus, il faudrait que j’observe tout de près, mais une chose que je sais, c’est qu’il y a moins de professeurs noirs maintenant qu’il y en avait, disons, il y a vingt ans. Donc qu’est-ce que cela veut dire en termes de soi-disant progrès ? Mais les professeur·e·s qui sont ici depuis des années ont fait une variété de choses et continuent d’essayer — et pas qu’eux, mais aussi les étudiant·e·s noir·e·s, comme moi à mon époque en tant qu’étudiant —, ne se voyant pas représenté·e·s dans les curriculums, d’insérer du matériel nouveau sur les expériences des personnes noires dans leurs études. Quand il s’agit de travail aux second et troisième cycle, travailler sur des sujets qui parlent des expériences noires, je tire moi-même d’importantes informations de thèses qui ont été faites à McGill par des étudiant·e·s noir·e·s. Donc en tant que personnes noires, nous avons toujours essayé d’en apprendre plus sur nous-mêmes, de nous placer « sur la carte », et de combattre cette invisibilisation. Je ne peux pas dire s’il y a un progrès ou une augmentation de ces phénomènes, notre nombre a toujours été très faible, donc il est difficile de dire s’il y a une tendance, si elle est haute, ou basse, à un moment donné. Mais je sais que les personnes noires à McGill ont toujours dit : « Hey, il faut qu’on soit représenté·e·s. » Je pense au Congrès des écrivains noirs qui a eu lieu ici dans les années 1960… Je veux dire, ce sont des accomplissements assez importants, qui mettent en avant l’histoire de ce travail.
LD : Vous parlez justement du travail effectué par les étudiant·e·s noir·e·s pour se « placer sur la carte » et combattre l’invisibilisation de leurs expériences dans les programmes académiques. Pensez-vous que de ces efforts individuels puisse émerger un véritable changement en profondeur qui mènera dans le futur à une plus grande représentation des expériences noires dans les enseignements universitaires ?
PH : Eh bien, vous savez, voici une façon de voir les choses : il s’agit à la fois d’une malédiction et d’une bénédiction. C’est une malédiction parce que vous devez toujours faire une double charge de travail. Vous faites le travail qui vous a été assigné, puis vous vous dites « ok, mais il faut que j’en apprenne plus sur ces autres choses qu’on ne m’enseigne pas, il faut que je trouve ça par moi-même ». Et dans ce sens, c’est un travail difficile. Ça fait aussi de vous un·e étudiant·e pointu·e, mais le travail reste difficile. Mais de l’autre côté de cela est l’impact de ce travail, l’importance de ce travail. Et je comprends ce que vous dites et je suis totalement d’accord sur le fait que les petites interventions individuelles ne sont pas suffisantes. À quel moment voyons-nous cela intégré dans les curriculums d’une façon plus holistique ? Mais l’une des choses que nous retenons des Black Studies c’est que, à cause de l’unicité de l’expérience noire, et parce que la définition de ce que cela signifie d’être humain et d’exister en société et en communauté tend à généralement exclure la négritude, nous ne pouvons véritablement comprendre aucun de ces phénomènes sociaux sans proprement comprendre l’expérience noire.
Il faut aussi comprendre que la finalité de cela, des Black Studies, est la libération des populations noires
Et donc l’intégration de cette expérience produit vraiment du travail révolutionnaire, de pointe, qui permet aux gens, s’ils y sont ouverts, de voir le monde différemment et de le comprendre différemment. C’est donc une bénédiction dans ce sens. Je sais que le temps supplémentaire que vous mettez dans vos travaux fait véritablement une différence, je le crois. Et alors il faut aussi comprendre que la finalité de cela, des Black Studies, est la libération des populations noires. Ce n’est pas juste de s’assurer d’avoir un beau petit curriculum qui reste posé quelque part. C’est vraiment de trouver comment tout ceci travaille au service des luttes noires et de la libération noire.
LD : Quelles sont vos pensées et ressentis alors que s’amorce le Mois de l’Histoire des Noir·e·s ? Que vous évoque ce moment de l’année, sachant qu’il peut revêtir une signification différente pour chaque personne ?
PH : Franchement, je n’organise pas mon esprit, ou mes pensées, ou mon travail autour du calendrier qui intègre le mois de l’Histoire des Noir·e·s au plus court mois de l’année (rires). Mais je ne fais pas non plus partie de ceux·celles qui le rejettent. Je sais pourquoi il doit exister, je suis d’accord avec, et je participe à ce qu’il s’y passe à McGill et ailleurs. Mais je ne me demande pas moins pourquoi, pourquoi il nous faut ce mois, d’où vient cette invisibilisation que nous devons sans cesse combattre, et ce que cela prendra pour que nous continuions à faire ce travail en dehors du Mois de l’Histoire des Noir·e·s. Je me demande toujours : qu’allons-nous faire le premier premier mars ? Comment continuer ce travail après le premier mars ? Et comment faire pour que le Mois de l’Histoire des Noir·e·s ne devienne pas qu’un simple apaisement, pour la conscience de n’importe qui d’autre — puisque l’apaisement n’est pas tant pour nous, en fait —, duquel ils peuvent passer à autre chose immédiatement, alors que nous continuons à vivre la réalité qu’est celle d’être une personne noire, à McGill, au Québec et au Canada.