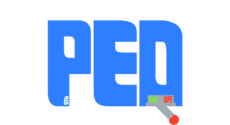Lundi 17 novembre, c’est à la librairie montréalaise Un livre à soi qu’a eu lieu le lancement du premier livre de Ruba Ghazal : Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs. À 17 h, la salle est comble avec plus d’une centaine de curieux, de passionnés et de partisans de la députée et co-porte-parole de Québec solidaire. Comme chante le refrain de l’hymne national québécois non officiel, Gens du pays de Gilles Vigneault, dont le titre a inspiré celui du livre, Ghazal raconte son amour pour le Québec à travers son parcours en tant qu’immigrante d’origine palestinienne et « enfant de la loi 101 ».
Là où tracer le début
Nombre des gens d’ici viennent d’ailleurs, c’est une réalité incontestable au Québec. Pour Ruba Ghazal, même si elle a souvent raconté son parcours depuis qu’elle est devenue députée en 2018, cette histoire lui a toujours semblé bien banale. Au lancement, elle confie que c’est difficile de ne pas parler de politique, mais la rédaction de son livre lui a permis d’aborder l’humain derrière la politicienne. Elle a notamment eu la chance de répondre à une question qu’elle se pose souvent : « Par quel coup du sort une femme comme moi, née dans une famille musulmane plutôt traditionnelle, une fille de réfugiés palestiniens […] a pu se retrouver à la tête d’un parti politique de gauche indépendantiste et féministe ? »
En effet, comme dans beaucoup de familles immigrantes, la politique n’était pas un sujet de discussion autour de la table chez les Ghazal. L’autrice affirme qu’arriver dans un nouveau pays pour y vivre, c’est se lancer dans une confrontation entre les valeurs familiales et celles de la nation. Celles et ceux qui arrivent plus jeunes ont l’avantage de mieux s’adapter à leur nouvel environnement, mais se retrouvent fréquemment avec un sentiment de culpabilité à devoir rejeter une partie de la famille pour davantage s’intégrer dans la société qui les entoure.
Si les parents et la grand-mère maternelle – la « téta » (« grand-mère » en arabe du Moyen-Orient) – de Ruba Ghazal ont immédiatement rejeté sa décision lorsque celle-ci s’est engagée dans la vie politique québécoise. Leur mépris se justifie par une peur chronique de l’instabilité qui remonte dans l’histoire de trois générations palestiniennes déracinées, marquée par une violence irréversible. Les grands-parents de l’autrice ont été victimes de la Nakba, l’exode forcé des Palestiniens au début de 1948, et figurent parmi les centaines de milliers de réfugiés qui se sont dirigés vers le Liban. Dans un récit, la crise devrait annoncer la fin. Or, cette crise se prolonge perpétuellement dans la réalité, dépassant le cadre narratif qu’on tente de lui imposer. Dans son livre, Ruba Ghazal mentionne sa téta, qui n’avait emporté qu’une petite valise avec elle le jour de son départ, convaincue qu’elle rentrerait bientôt chez elle. Mais, comme conclut l’autrice, « Téta ne remettra jamais les pieds en Palestine ».

Enfants de la loi 101
En écrivant, Ghazal n’établit pas seulement un lien avec sa famille, mais également avec d’innombrables « petites Ruba », des « enfants de la loi 101 » qui arrivent au Québec, comme elle, sans connaître un mot de français. Pour clarifier, les « enfants de la loi 101 » font référence aux jeunes dont les parents ont immigré au Québec après l’adoption de la Charte de la langue française en 1977. La petite Ruba en fait partie lorsque, âgée de dix ans, elle s’installe au Québec en 1988.
Là, alors que leurs parents commencent à fréquenter les Centres d’orientation et de francisation des immigrants (COFI), réseaux malheureusement abolis en raison de coupes budgétaires en 2000, Ruba Ghazal et ses deux petites soeurs embarquent dans la classe d’accueil de francisation. Ces lieux sont des points d’échange culturel, où chacun porte en lui une graine d’histoire qu’il sèmera dans la terre commune des Québécois. Pour immerger les élèves dans la culture québécoise de plus près, ces programmes offraient souvent des sorties scolaires qui permettaient de pratiquer la communication en français, mais surtout de « découvrir un monde nouveau ».
Double quête de la liberté
« J’ai deux nations, mais pas de pays », dit Ruba Ghazal lors d’une entrevue en 2023. Souverainiste québécoise et descendante palestinienne, Ghazal voit souvent un parallèle entre ses deux héritages : deux peuples qui cherchent à préserver leur identité et à affirmer leur existence nationale.
Pour Ghazal, ces deux horizons politiques et identitaires ne sont pas contradictoires. Au contraire, ils se superposent et s’éclairent l’un l’autre. La première fois que cette idée – que le Québec ressemble à la Palestine – lui est montée à l’esprit, c’était pendant l’année scolaire 1988–1989. À l’école Cardinal-Léger, que Ghazal fréquentait, c’était « l’année Félix Leclerc » où tout le monde chantait ses chansons. Que ce soit le carême (le « ramadan des Chrétiens ») ou la culture « enracinée dans la ruralité et la force des liens familiaux », les écrits de Félix Leclerc sur le Québec ont permis à la jeune migrante de tisser des liens avec la vie et les mœurs en Palestine, tels que sa grand-mère les lui racontait.
Ce rapport entre les deux identités est sans doute à la base de ses engagements indépendantistes. Ghazal n’a jamais mis les pieds en Palestine, mais elle ne cessera jamais de se considérer palestinienne. Bien que la Palestine soit aujourd’hui finalement reconnue comme un État, la jeune Ruba Ghazal a grandi en entendant ses parents soupirer devant le sort de celle-ci, qui « ne deviendra jamais un pays ».
C’est pourquoi l’idée de l’indépendance du Québec intrigue la Ruba Ghazal de 15 ans, au moment des débats sur l’accord de Charlottetown en 1992. « C’est encore possible de devenir un pays, en 1992 ? » Si oui, pourquoi les Palestiniens n’avaient-ils toujours pas réussi, même après quarante ans de lutte ? Si la Palestine ne le peut pas, le Québec, cette « société qui faisait place à la bonté et aux élans du coeur », dont l’hymne national a pour thème l’amour, pourrait-il ? Alors que les discussions ont à nouveau alimenté la peur d’une instabilité chez ses parents , ces questionnements ont nourri l’intérêt de Ghazal pour un Québec libre, car, pour elle, « le désir d’un pays, pour un peuple, est l’aspiration la plus légitime qui soit ». Après seulement cinq ans au Québec, elle souhaitait déjà l’épanouissement de ce peuple qui l’a accueillie sur un territoire qui leur est propre, où leur identité puisse s’affirmer pleinement.
Somme toute, si Ruba Ghazal affirme avoir écrit son essai pour faire résonner son histoire chez les enfants d’immigrants comme elle, sa mission a bel et bien été accomplie. Pour reprendre l’une de ses phrases : « Migrer, c’est aussi découvrir la possibilité de cultiver de nouveaux jardins. » Après la lecture de Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs, je me revois, à l’âge de sept ans, découvrir Montréal, apprendre le français et, peu à peu, aimer le Québec.