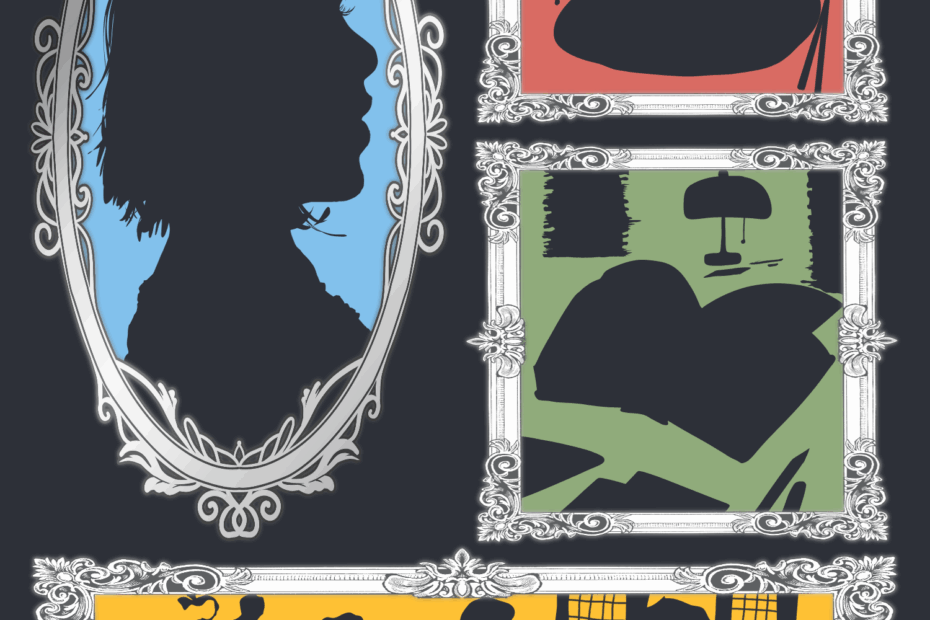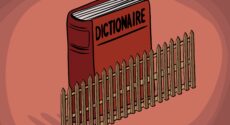Nouveau-né, à peine sorti de la maternité, on se retrouve face aux réalités d’un monde complexe et strictement ordonné. Sans préavis, on se voit attribuer prénom et nom de famille : les premiers marqueurs de notre identité. Inondé de sensations nouvelles et condamné à être un « enfant », on pleure, on crie, sans réussir à se libérer de notre prison à barreaux en bois. Heureusement, la voix angélique de notre mère est là pour nous bercer vers un sommeil profond. On ne le sait pas encore, mais cette douce chanson et ces paroles à syllabes rythmiques et codifiées nous imprègnent d’une marque communautaire et culturelle qui formera la base de notre histoire individuelle et servira de point de référence pour nous décrire au reste de la société.
L’enfance est une période complexe où l’on apprend à comprendre qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Contraints à exister dans un système de règles qui nous précède, on lutte pour trouver notre propre agencement tout en cherchant à s’identifier de manière stable par rapport aux autres. Cette tension forge notre caractère, et – par procédé dialectique – influence ceux qui nous entourent.
Les milieux sociaux et culturels qu’on fréquente durant l’enfance ont un impact profond sur notre sens d’identité. Ils façonnent la manière dont on interprète le monde, la morale et les normes et participent à la construction de notre personnalité. Pour les enfants dont les parents sont immigrants, cette réalité est d’autant plus marquée, étant donné la pluralité des contextes culturels auxquels ils doivent s’intégrer.
Chercheur à McGill en matière d’éthique de l’enfance pour l’initiative intellectuelle collaborative VOICE, Ryan Kent, nous aide à comprendre les enjeux de cette tension identitaire : « L’auto-determination des enfants est lié à la moralité. Ainsi, la manière dont les enfants issus de l’immigration naviguent à travers différents cadres normatifs, influencés par la culture, fait d’eux des agents normatifs à part entière. Ils le sont dans la façon dont ils interprètent les questions normatives en s’appuyant sur leurs propres références culturelles, et dans la manière dont ils réinterprètent la culture et la moralité, pouvant même contribuer à faire évoluer la culture selon cette dynamique (tdlr). »
Dans un contexte aussi multiculturel que celui du Québec, ce mécanisme qui combine l’assimilation et l’agencement opère de façon à produire une identité québécoise nuancée, hybride et florissante. Cette semaine, Le Délit donne la parole à trois élèves dont la famille a immigré au Québec depuis divers pays dans l’optique de mieux comprendre comment cette identité plurielle se construit et se vit au quotidien.
« La manière dont les enfants issus de l’immigration naviguent à travers différents cadres normatifs, influencés par la culture, fait d’eux des agents normatifs à part entière »
Ryan Kent, chercheur à l’initiative VOICE
Yasmine, étudiante en droit
Montréalaise et fille de parents algériens, Yasmine est fière de son héritage culturel et consciente des pressions conformistes qui pèsent sur elle et d’autres jeunes de la diaspora algérienne. Elle nous explique : « La [confusion identitaire, ndlr] est une conséquence à long terme du colonialisme [qui, par nécessité sociale et économique, produit un désir] de s’assimiler, qui se manifeste par un abandon de certains liens culturels, comme le fait d’arrêter de parler arabe à la maison. Moi, j’ai eu de la chance. Mes parents ont vécu cela dans leur famille à l’étranger et c’est devenu quelque chose qu’ils ont voulu éviter. J’ai grandi en allant chaque année en Algérie et en faisant des cours d’arabe. Pour mes parents ce n’était pas toujours économiquement viable, mais c’était un investissement dans ma culture. »
Parlant maintenant quatre langues, Yasmine est convaincue que cet investissement culturel en a valu la peine. D’un point de vue professionnel, elle reconnaît que grandir dans un milieu culturel distinct l’a « rendue plus sensible et plus empathique » face aux barrières légales auxquelles font face les personnes immigrées au Canada. D’autre part, au niveau social, entretenir un lien avec son héritage culturel lui a permis de maintenir une solidarité avec d’autres élèves maghrébins, qu’elle préserve à travers son rôle au sein de l’association des étudiants en droit nord-africains.
Billy, étudiant en sciences humaines
Même si Billy parle déjà anglais et français, il se trouve parfois frustré de ne pas encore maîtriser le créole haïtien. À l’aise avec son identité composée (haïtienne, américaine, québécoise), il reconnaît cependant que cette distance avec sa langue maternelle le mène parfois à se sentir exclu du cercle fermé des Haïtiens « de souche ».
Cela dit, Billy refuse de se laisser abattre par un côté de sa culture et affirme se sentir profondément ancré dans la culture haïtienne. Dans son constat, il confirme le rôle important que jouent les éléments culturels récurrents dans le maintien de ce lien identitaire. Par exemple, en ce qui concerne sa foi chrétienne baptiste, sa relation spirituelle avec le divin est aussi une manière d’entretenir son appartenance culturelle. Plus qu’un lieu de culte, l’Église baptiste lui offre un milieu convivial et communautaire qui lui permet d’entrer en contact avec d’autres membres de la diaspora et de célébrer ses traditions.
De même, Billy explique qu’il ressent un profond attachement à la nourriture haïtienne, car il a grandi en mangeant des plats traditionnels préparés par sa mère. Motivé par une envie de bien manger et de revivre de bon souvenir d’enfance, Billy espère apprendre à cuisiner lui-même certains plats emblématiques comme le Mayi Moulin : « C’est comme ma madeleine de Proust ! »
« Chaque matin, je me réveille en disant wow… je suis tunisienne »
Mayassa, étudiante à McGill
Mayassa, étudiante en sciences politiques et en études du Moyen-Orient
Fortement enracinée dans sa culture, Mayassa se dit « vraiment contente d’être tunisienne ». Blaguant à moitié, elle me confie que « chaque matin, [elle se] réveille en disant : “wow… je suis tunisienne!” » ; une fierté palpable qu’elle croit due au fait qu’elle a « grandi entourée d’une communauté vraiment diverse », lui permettant d’assumer pleinement son identité composée.
Cependant, malgré cette fierté, Mayassa reconnaît que certains préjugés sociaux perdurent. Les expériences qu’elle a vécues avec le racisme dans son enfance et son quotidien l’ont menée à voir d’un œil critique les politiques actuelles des gouvernements fédéral et provincial. De son point de vue, le racisme institutionnel est au centre du problème, ayant pour conséquence la marginalisation sociale des minorités raciales du Québec. S’appuyant sur des anecdotes datant de son primaire et de son secondaire, elle explique qu’elle a l’impression que « même une personne blanche qui ne vient pas du Canada a plus sa place ici qu’une personne canadienne issue de l’immigration ». Pour elle, ce phénomène discriminatoire n’est pas inné, mais est plutôt la conséquence d’une politique identitaire qui embrase les tensions sociales et mène à l’apparence d’un racisme diffus. « Je suis très consciente que, quand [les politiciens], comme Legault, parlent à la télé de Canadiens ou de Québécois, dans leur portrait idéal, je n’en fais pas partie », confie-t-elle.
Pourtant, Mayassa explique qu’elle se sent très proche de la culture montréalaise, qu’elle apprécie pour sa diversité et qu’elle considère comme un terrain d’échange où son identité multiple peut pleinement s’exprimer. En fin de compte, ce qui reste le plus difficile de son point de vue est de « devoir toujours justifier sa présence quelque part ; autant physique, que culturelle, que morale ».
Ces témoignages nous démontrent que, malgré les contrastes entre différentes cultures et identités, elles restent compatibles, reliées, et même parfois imbriquées. Maintenant, il nous reste à trouver une moralité commune fondée sur la tolérance et la réciprocité.