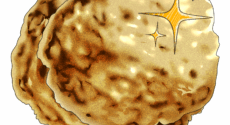Lors de ma première conférence de sciences politiques, l’assistante d’enseignement a demandé à chacun de se présenter. « Dites-nous aussi quel est votre plat préféré ! », a‑t-elle ajouté avec un grand sourire. Parmi les étudiants, beaucoup affirmaient apprécier les pâtes, les pizzas, mais aussi les sushis, le pad thaï, ou encore les shawarmas. Ces plats venus des quatre coins du monde sont aujourd’hui familiers à Montréal, même pour ceux qui n’ont jamais voyagé dans le pays duquel ces spécialités proviennent. Mais alors, comment expliquer leur popularité au Canada ?
Colonisation et migrations
Le Royaume-Uni a la réputation d’être une nation à la cuisine fade, au point où l’on entend souvent : « Pour bien manger, il faut se régaler de la nourriture d’un des pays qu’ils ont colonisés ! » L’immigration de travailleurs en provenance des colonies était un modèle économique préconisé par le système impérial. Des travailleurs venant d’Inde ou du Pakistan pouvaient venir combler à des prix compétitifs le manque de main-d’œuvre au Royaume-Uni. Cette mobilité a fortement contribué à diffuser ces traditions culinaires, et les adapter pour plaire à un public occidental. Prenons le tikka masala, par exemple : du poulet mariné dans des épices et des herbes, puis grillé à la braise jusqu’à en devenir légèrement fumé et tendre. Enfin, le tout est mijoté dans une sauce masala à base d’oignons, de tomates et de crème. C’est un plat classique, que l’on trouve dans presque tous les restaurants indiens de Montréal. C’est aussi l’exemple d’une cuisine fusion, puisque c’est en réalité un immigré pakistanais de Glasgow qui en est à l’origine. Alors qu’il servait un poulet tikka – plat traditionnel du nord de l’Inde – un client se plaint que la viande est trop sèche. Le cuisinier a alors l’idée d’ajouter une sauce à base de crème : un coup de génie – et un coup de foudre immédiat pour les Britanniques. En peu de temps, ce plat est devenu l’une des expériences phares de la gastronomie indienne en Occident, au point qu’on en oublie parfois ses origines.
À Montréal, l’immigration a donné naissance à des quartiers où les communautés se retrouvent, favorisant l’établissement de nombreux restaurants traditionnels ; en 2021, environ 33,5 % de la population de Montréal était issue de l’immigration.
Par exemple, le Quartier chinois de Montréal a été établi progressivement à partir des années 1870, lorsque des travailleurs chinois sont arrivés de Colombie-Britannique pour échapper aux mesures discriminatoires. Plus tard, pendant la guerre froide, le quartier a également accueilli un grand nombre de réfugiés vietnamiens. Il constitue aujourd’hui une enclave culturelle, où la plupart des commerces se spécialisent dans l’alimentation et la gastronomie asiatique.
La cuisine fusion à Montréal
La cuisine fusion se développe rapidement à Montréal, et valorise l’initiative et la volonté des immigrants de promouvoir la culture de leur pays d’origine à travers la nourriture. La chaîne de restaurants Thaï Express illustre parfaitement ce mélange. Créé en 1999 à Montréal par quatre sœurs venant d’Asie du Sud-Est, le projet avait pour objectif de « rendre la cuisine thaïe authentique accessible partout ». Aujourd’hui, Thaï Express connaît un succès mondial, avec plus de 300 succursales dans le monde entier. Malgré son internationalisation, il reste encore un favori des locaux : en 2021, Thaï Express était le septième restaurant de service rapide favori des Montréalais. L’enseigne doit aussi son succès à son accessibilité : selon le site officiel, Thaï Express « a révolutionné le marché canadien » en introduisant le « premier concept de restauration rapide thaïlandaise ». En plus « d’adapter ses recettes », la multinationale ajuste également sa chaîne logistique pour répondre aux attentes et au fonctionnement du marché nord-américain.
« La cuisine fusion se développe rapidement à Montréal, et valorise l’initiative et la volonté des immigrants de promouvoir la culture de leur pays d’origine à travers la nourriture »
Le restaurant Poulet Rouge s’inscrit également dans cette démarche de cuisine fusion. Il illustre comment les influences méditerranéennes, présentes à Montréal grâce à une importante population d’origine maghrébine (plus de 12 % de la population de Montréal en 2021), peuvent être adaptées aux goûts locaux. Au menu, on retrouve par exemple des marinades saveurs « BBQ sucré » ou encore le bol « Rouge poutine », des recettes d’inspiration québécoises. Cette approche contribue ainsi à sa popularité croissante à travers le Québec et le Canada.
Soft power gastronomique
Le rayonnement de certaines cuisines est souvent lié au pays concerné, parfois même par le biais du gouvernement. C’est notamment le cas de la Corée du Sud, dont l’exécutif a entamé en 2007 un programme officiel de promotion de la gastronomie coréenne, dans le but de créer une « image de marque nationale (tdlr) » et dont un des objectifs est de quadrupler le nombre de restaurants coréens à l’étranger.
Le Japon dispose d’une ambition similaire, motivée par un désir de faire oublier son rôle lors de la Seconde Guerre mondiale et de rebâtir son image à l’international. Contrairement à la Corée du Sud, le Japon n’utilise pas directement sa gastronomie comme vecteur d’influence, mais sa culture populaire – animé, manga, jeux vidéo. Cette stratégie a tout de même un impact sur la perception de la gastronomie japonaise à l’étranger, car les médias exportés suscitent la curiosité des jeunes pour la culture japonaise – et donc aussi sa cuisine. Les sushis sont l’un des premiers plats qui viennent à l’esprit, car très appréciés. Parmi les restaurants-minute préférés des Montréalais, Sushi Shop et Yuzu Sushi font tous deux le top 20.
Réseaux sociaux et influenceurs
Les réseaux sociaux transforment la nourriture en tendance mondiale. Il existe un influx massif de contenus circulant sur le Web concernant et influençant notre alimentation : presque un quart des publicités télévisées touchent le sujet. C’est sans oublier l’exposition aux influenceurs sur les réseaux sociaux, qui oriente directement les choix de consommation. Prendre une photo d’un plat pour la partager sur les réseaux est devenu un réflexe pour beaucoup. Dans un marché mondialisé, TikTok, YouTube et Instagram créent un environnement où la nourriture devient virale, transformant certains plats en tendances globales.
C’est notamment le cas du thé aux perles, ou boba, création taïwanaise qui a explosé en popularité ces dernières années. Une employée de la chaîne Kung Fu Tea en résume la raison en quelques mots : « Ce sont les réseaux sociaux. » Le thé aux perles a en effet l’avantage d’être très photogénique : grandes tasses transparentes, nuages de lait et multitude de perles flottant dans un liquide aux couleurs en dégradé.
L’évolution du magasin montréalais L2 permet une analyse pertinente de la popularité croissante du thé aux perles à l’échelle locale. Fondé en 2003 dans le quartier chinois, L2 reste pendant une décennie une petite boutique s’adressant principalement à la communauté asiatique de Montréal. En 2016, le magasin amorce son expansion et ouvre deux nouveaux magasins, et en 2018 lance son programme de franchisage. C’est aussi cette année-là que l’on remarque l’arrivée de la chaîne internationale Presotea à Montréal, suivie de Meet Fresh et The Alley l’année suivante. Les succursales de L2 continuent de s’étendre jusqu’à en compter vingt au Québec en 2023. Avec l’arrivée de concurrents, chaque magasin cherche à se démarquer et à plaire au public québécois, que ce soit en modifiant ces thés ou en promettant des produits frais et locaux.
Un succès inégalement réparti
La cuisine voyage, et devient, partout où elle s’installe, un reflet des goûts et coutumes locales. Cependant, on ne peut pas dire que toutes les cuisines bénéficient du même succès. Si beaucoup connaissent les spécialités sud et est-asiatiques, peut-on dire de même de la gastronomie ouzbèke ? Ou encore philippine ? Cela peut s’expliquer à la fois par les stéréotypes associés au pays et à sa culture qui influencent les attitudes vis-à-vis de la gastronomie, ou bien par l’absence de valorisation nationale ou de stratégie de promotion. Myke Sarthou, chef cuisinier, s’exprime au sujet de la cuisine philippine et explique : « Pour que la gastronomie rayonne à l’international, il faut qu’elle soit appuyée par un secteur agricole puissant, ce qui n’est pas le cas ici. » La restauratrice Nicole Ponseca justifie aussi cela par l’impact dévastateur de la colonisation, qui a dévalorisé la culture et cuisine locale, amenant la population à intérioriser ce sentiment de honte.
La culture culinaire montréalaise raconte l’histoire de voyages, de rencontres et d’adaptations. Mais, malgré le succès fulgurant de certains plats, beaucoup d’autres restent encore dans l’ombre, inconnus du grand public. Il ne tient qu’aux curieux et aux gourmands d’aller les découvrir.