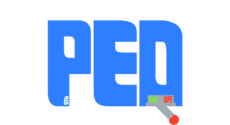Le Salon du livre de Montréal est le plus grand événement littéraire francophone du continent américain. Chaque année, ce véritable paradis pour les lecteurs rassemble des auteurs et des maisons d’édition de divers genres littéraires. Le Salon plaît aux petits comme aux grands, avec ses contes lus sous une tente et ses conférences sur plusieurs enjeux d’actualité littéraire. Des aires de lecture, meublées de fauteuils, permettent aux visiteurs de prendre une pause des activités et des files de dédicaces pour se plonger dans leurs nouveaux achats livresques. La thématique du Salon pour l’édition 2025 était le « (Ré)enchantement », visant à explorer comment les mots et l’art de raconter peuvent façonner notre vision du monde et redonner espoir en des temps incertains, et permettant à tous de retrouver l’enchantement de la lecture.
Le bonheur des choses simples
Ce samedi matin, deux auteurs se retrouvent à l’Agora, l’endroit qui accueille les conférences. Rodney Saint-Éloi, poète et écrivain fondateur de la maison d’édition Mémoire d’encrier, s’entretient avec Mathieu Bélisle, essayiste, éditeur et professeur de littérature au Collège Jean-de-Brébeuf. Tous deux ont publié cette année un livre sur l’espoir : Saint-Éloi avec Fais du feu, un recueil de poésie, et Bélisle avec l’essai Une brève histoire de l’espoir.
« C’est si simple, les choses simples », cite Mathieu Bélisle, le recueil de poésie de Rodney Saint-Éloi sous les yeux. Mais de quoi parle-t-on, lorsqu’on fait allusion aux « choses simples » ? Les deux auteurs s’attaquent à cette question, d’apparence anodine, mais pourtant si complexe. Le chant des oiseaux, le bruit d’un ruisseau, la chaleur du soleil sur notre peau… Pourtant, ce n’est pas tout. Il y a les arbres, la terre. Le feu, celui qui nous permet de faire du thé ou du café chaque matin, mais aussi le feu qui brûle en nous, le feu de la passion, de l’amour de la vie, le feu de l’espoir. Cette confiance que nous avons envers les choses qui nous semblent acquises : l’eau, la nourriture, un lendemain. Rodney Saint-Éloi se rappelle ceux qui, dans son Haïti natal, pouvaient marcher jusqu’à sept kilomètres pour un peu d’eau. « Aujourd’hui, on nous a appris à gérer la surabondance ». Le poète déplore le manque d’appréciation pour les petites choses de la vie. Il s’agit, selon lui, de la clé du bonheur : « Dans ma cosmogonie, dans ma culture, il y a toujours deux côtés. Un décès amène une naissance. C’est notre tâche en tant qu’individu de reconstruire ce qui est mort. »
L’espoir pour retrouver l’enchantement
Mathieu Bélisle renchérit que nous sommes forts d’espoir personnel, individuel, mais pauvres en espoir collectif : « Si vous allez dans le rayon “bien-être” en librairie, on vous vend des livres pour vous, pour la personne que vous êtes. On ne vend pas de livres sur le bien-être du monde. » Cet espoir, en demeurant individuel, trahit l’humanité. L’essayiste rappelle l’ironie du sort de la planète : ce sont les millionnaires qui ont le plus de pouvoir sur le futur, mais, étrangement, ils ne croient pas au futur de notre planète, de notre société. Plusieurs se construisent des bunkers en cas d’apocalypse, presque convaincus que le pire est à venir, tandis que la population est laissée à elle-même.

La désensibilisation aux horreurs de notre siècle
Dans notre quête d’espoir individuel, nous oublions aussi la compassion pour autrui. Bombardés presque continuellement de mauvaises nouvelles dès que nous ouvrons la télévision ou notre téléphone, nous sommes désensibilisés aux atrocités qui ont lieu dans le monde. « Deux cents morts dans un pays, un attentat terroriste dans un autre… Ces mots sont devenus habituels, déplore Saint-Éloi. On oublie que ce n’est pas une ville qui est bombardée, mais des humains. Des enfants, des arbres, la Terre ». Avec ces nouvelles en continu, il est difficile de voir comment la situation pourrait s’améliorer, mais le poète rappelle que les bonnes actions à une petite échelle sont les plus fortes. « Tous les jours, il faut avoir une petite bonté pour soi-même et pour les autres. Le monde est à nous ». En regagnant espoir, en ayant confiance en un lendemain, nous pouvons créer une nouvelle histoire, une histoire de compassion, de douceur, racontant la beauté du monde.
« J’écris parce que j’ai du talent »
En après-midi, l’Agora est remplie. Tous les sièges sont pris, les gradins sont pleins, cinq ou six rangées de spectateurs debout s’étirent le cou pour apercevoir l’auteur en conférence. Tout le monde attend avec impatience l’arrivée de Yasmina Khadra. L’auteur algérien, dont la dernière visite dans notre province remontait à 2019 au Salon du livre de Québec, est accueilli chaleureusement.
« En Occident, vous aimez dire que l’écriture est une thérapie, qu’elle aide à exorciser les démons. L’écriture, ce n’est pas une thérapie. J’écris parce que j’ai du talent », déclare l’auteur. Sa franchise est rafraîchissante. Sans fausse modestie, il explique que ses enseignants de français l’ont poussé à parfaire son vocabulaire, sa grammaire. Khadra explique qu’il a réédité Morituri, le roman qui a démarré son succès. « Je ne me souviens pas d’avoir écrit Morituri. Ma femme m’a dit que j’étais devenu insomniaque, que j’écrivais tout le temps. Il y avait des maladresses, des choses que je n’aimais pas ». Dominic Tardif, l’animateur de ce grand entretien, demande à Yasmina Khadra s’il est inquiet lorsqu’il publie un nouveau livre : « J’ai confiance en ce que je fais. Mais je ne sais jamais comment le public va réagir. Parfois les lecteurs adorent, parfois ils vous critiquent et vous détruisent. Pour la réédition de Morituri, ça n’a pas suscité de réactions ».
L’importance des mots
L’animateur poursuit en posant des questions à l’auteur sur son expérience dans l’armée en Algérie. Les horreurs quotidiennes, la violence, l’attentat terroriste dont il a été témoin. Tout cela façonne la perception de la vie de l’auteur. Khadra aborde L’Attentat, son roman à succès publié en 2005 et parlant du conflit israélo-palestinien. « Beaucoup de gens trouvent que L’Attentat est horrible. Tout ce qui a lieu à Gaza en ce moment est mille fois pire. C’est un génocide contre les Palestiniens ». Une vague d’applaudissements s’élève à la suite du commentaire de l’auteur. « Certains politiciens évitent d’utiliser le mot “génocide” pour parler du conflit. Pourquoi l’utilisez-vous ? » demande l’animateur. « Parce qu’il faut dire les choses comme elles sont, répond simplement Khadra. Aujourd’hui, les gens ont peur des mots. Il faut dire la vérité ». Yasmina Khadra révèle que, depuis 2018, il travaille sur un manuscrit abordant le conflit israélo-palestinien. « Je l’ai suggéré à beaucoup d’éditeurs et personne n’en a voulu. On me disait : “Pas celui-là.” Et puis quelqu’un s’y est intéressé. Une femme. Le 5 mars 2026, ce sera la sortie de ce roman. Et je vous avertis, L’Attentat, ce n’est rien à côté de ce livre ».
« Aujourd’hui, les gens ont peur des mots. Il faut dire la vérité »
Yasmina Khadra, écrivain
La magie du Salon
Après des applaudissements à tout rompre, la foule se disperse et retourne vers les kiosques des maisons d’édition et les tables de dédicace. Patrick Sénécal, dont les admirateurs font la file plus de 15 minutes à l’avance, India Desjardins avec une file d’attente spectaculaire, Dany Laferrière dans un kiosque à l’image de la réédition – illustrée de sa propre main – de son roman Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer. La centenaire Janette Bertrand est présente et signe avec amour les romans que lui tendent ses lecteurs. Tout le monde a des étoiles dans les yeux en voyant la signature de son auteur chouchou, même la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, qui demande à Alexandra Diaz de dédicacer son livre de recettes. Une fois de plus, le Salon du livre de Montréal remplit sa mission. 106 000 visiteurs sont unis par les mots, la force des récits, et le pouvoir de raconter.