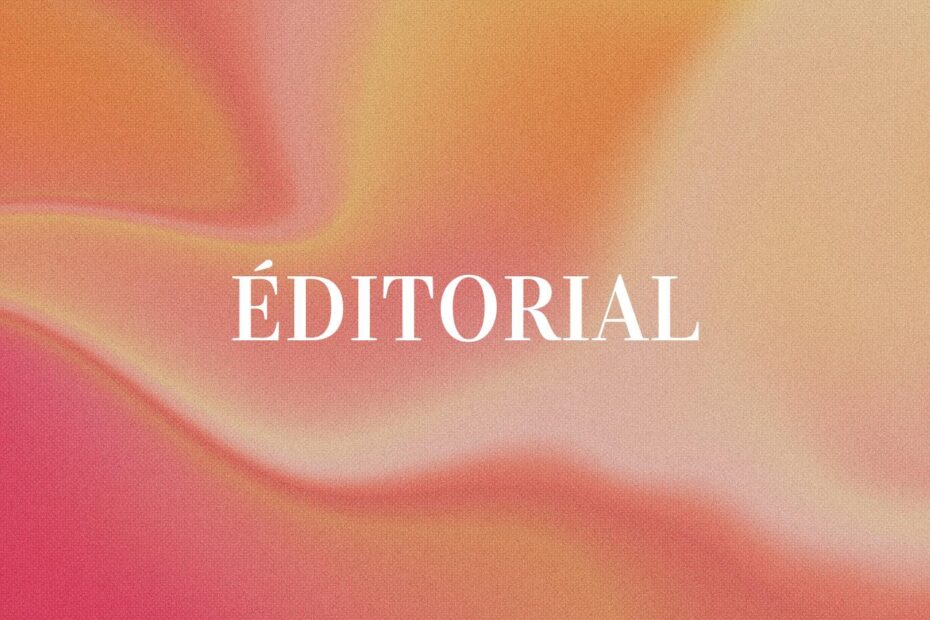Par nature, et pour sa survie même, l’humain a eu besoin de communiquer ses idées, d’informer les autres et de transmettre son expérience. Les récits, qu’ils soient oraux ou écrits, sont nés de ce besoin inné de créer des liens. Ils servent à préserver les connaissances au fil des générations, à renforcer les normes sociales et à diffuser l’expression humaine.
Avant l’avènement de l’écriture, les premiers humains laissaient des peintures rupestres pour conserver leurs souvenirs sous forme matérielle. Les civilisations, de l’Antiquité à l’ère moderne, ont connu des périodes de prospérité et de déclin en fonction de leurs mythes fondateurs, qui leur ont souvent survécu.
Pour les Premières Nations de l’île de la Tortue, les récits constituent de véritables repères. Ces communautés, dans le passé comme aujourd’hui, se sont construites autour d’histoires de résilience et de spiritualité. Les gardiens du savoir autochtone enseignent des leçons morales, des savoir-faire essentiels à la survie et racontent des histoires transmises dans les langues ancestrales, liant étroitement les nouvelles générations à celles qui les ont précédées.
Cet échange ne serait pas possible sans les valeurs communes de respect cultivées par l’art de l’écoute et de l’échange mutuel. Il faut de la patience et de la confiance non seulement pour partager son histoire, mais aussi pour écouter celles des autres sans préjugés.
Aujourd’hui, les réseaux sociaux nous permettent de raconter, écouter, et partager des histoires beaucoup plus facilement et massivement que dans le passé. Nos téléphones nous donnent accès à un monde numérique aux données infinies, où l’information est inlassablement renouvelée.
Lorsque la parole se libère, de nouveaux récits émergent. En quelques clics, on se plonge dans une nouvelle réalité, celle qui touche et conditionne la vie d’individus de l’autre côté de la planète. Les petits créateurs et les artistes indépendants peuvent dorénavant diffuser leurs œuvres et histoires sans intermédiaire. Un espace ouvert se crée : ce qui était autrefois local devient mondial.
Plus que de simples amplificateurs de voix, les réseaux sociaux défient les narratifs dominants. Il devient désormais possible de mettre des visages sur les phrases et les chiffres. Le torrent d’information et les innombrables récits personnels qui sont à notre disposition nous placent devant des responsabilités simples, mais fondamentales : s’informer et nuancer.
Cependant, il serait naïf de croire que la parole authentique a été totalement libérée. Les conteurs ont du mal à cultiver un environnement où ils peuvent s’exprimer authentiquement. La domination des médias par les grandes entreprises isole les écrivains jusqu’au point où leur créativité est minimisée. Les médias contemporains sont largement dominés par les relances (« reboots »), les écrivains et les scénaristes ne sont plus suffisamment payés, et la microgestion des maisons de disques sur leurs artistes les dessaisit de leur métier.
Ces aspects ne sont pas des éléments isolés, mais les symptômes d’une crise à plus grande échelle. Bien que la création et l’accessibilité aux récits soient plus démocratisées que jamais, l’esprit culturel est toujours sous l’emprise de l’intérêt des plus puissants. L’art du récit est oublié : l’esthétique de la consommation devient leur seule et unique valeur. Au cinéma, comme dans la littérature, toute la beauté de la fiction ne devient qu’une autre poursuite de la gratification immédiate, nos sous jetés dans le puits à souhaits du capitalisme pour un rêve vendu à prix réduit. L’intelligence artificielle est devenue l’incarnation de ce processus ; le sacrifice de la raison d’être en faveur du profit. On a dénaturé le véritable objectif des récits. Ils ne constituent plus les annales de notre existence collective, destinées à être racontées, retenues et préservées pour les générations à venir.
Qui sait ce que demain apportera ? Dans une ère où l’intelligence artificielle est omniprésente, où la polarisation politique est croissante, et où la démocratie recule, le récit peut prendre deux directions : celle de la destruction, du populisme, et de la haine ou celle de la préservation, du partage, de l’histoire et de la mémoire.
Dans un monde plus connecté que jamais, les interactions humaines semblent être au plus bas. Il en va de notre responsabilité générationnelle de reprendre les choses en main. Alors, arrêtons-nous un instant, et prenons le temps de partager, de discuter, de rire, de pleurer, de douter et d’être en désaccord.