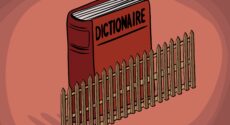Soudan, Congo, Palestine, Ukraine, Birmanie… Derrière ces conflits majeurs, un même dénominateur commun : les violences envers les civils. Et parmi eux, les enfants, qualifiés par l’ONU de « premières victimes des conflits ». Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 123 millions de personnes ont été déplacées de force en 2024, dont 40 % d’enfants. L’UNICEF sonne l’alerte : « Les besoins humanitaires augmentent plus vite que les financements », dans un contexte où les conflits se multiplient.
Des enfances volées
Le Délit s’est entretenu avec Pierre*, ancien fonctionnaire de l’UNICEF et du HCR, aujourd’hui cadre à l’ONUSIDA, qui a accepté de livrer son expérience de terrain à titre personnel sous le couvert de l’anonymat par devoir de réserve. Ayant travaillé en République du Congo auprès d’enfants réfugiés ayant fui la guerre dans le pays voisin, la République démocratique du Congo (RDC), il raconte des scènes d’une brutalité extrême : des jeunes « livrés à eux-mêmes, sans repères ni protection », ayant vu leurs villages incendiés et leurs parents tués. Leur vulnérabilité, explique-t-il, ne tient pas seulement à leur âge, mais aussi à leur incompréhension : « Ils ne comprennent pas pourquoi la guerre les frappe. »
Les conséquences de ces conflits sur les enfants sont multiples. Physiquement, les plus jeunes sont les premiers touchés par la faim et la maladie. Psychologiquement, ils subissent des traumatismes durables : anxiété, sentiment d’abandon, perte de confiance… Et lorsque la guerre éclate, les écoles sont les premières institutions à fermer, causant ainsi d’importants retards éducationnels. Le dernier rapport de l’UNICEF sur l’état de la jeunesse mondiale souligne que les conflits prolongés « brisent les structures sociales qui garantissent aux enfants stabilité et apprentissage ».
Prévenir pour guérir
Pour cet ancien humanitaire, la protection des enfants commence avant la guerre. Selon lui, il faut « enregistrer les naissances, éduquer, vacciner… Ce sont déjà des défenses contre la guerre. La solidité d’un pays protège ses enfants, même en temps de crise ». Cette réflexion rejoint les constats du HCR : 73 % des réfugiés sont aujourd’hui accueillis dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, souvent eux-mêmes fragiles. Cela souligne toute la complexité du maintien des services de base pour la population locale et les réfugiés.
Cela étant dit, des progrès ont été accomplis. L’UNICEF indique qu’en 2024, 6,2 millions d’enfants victimes de violences ont reçu un accompagnement psychosocial ou médical. L’ancien fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l’enfance souligne l’importante progression réalisée sur le volet psychologique, auparavant plus délaissé au profit de la prise en charge physique et juridique.
Un enjeu universel
Dans un monde où la guerre tend vers l’asymétrie, les bombardements et les attaques de drones étendent sans limites le nombre de victimes civiles. Certaines tragédies, comme la guerre civile au Soudan, avec 13 millions de déplacés depuis 2023, figurent pourtant parmi les urgences oubliées, où « les enfants et les adultes souffrent » dans un silence presque total. Face à cette réalité, l’ancien cadre insiste : il faudrait « commencer par appliquer le droit international de la guerre ainsi que les conventions internationales, dont la Convention relative aux droits de l’enfant, systématiquement et dans les faits ». Préserver les enfants des atrocités de la guerre constitue un enjeu universel. Assurer une éducation continue et des accès aux services essentiels, c’est donner à une génération la force de surmonter les blessures du conflit et d’en prévenir le retour.
*Nom fictif