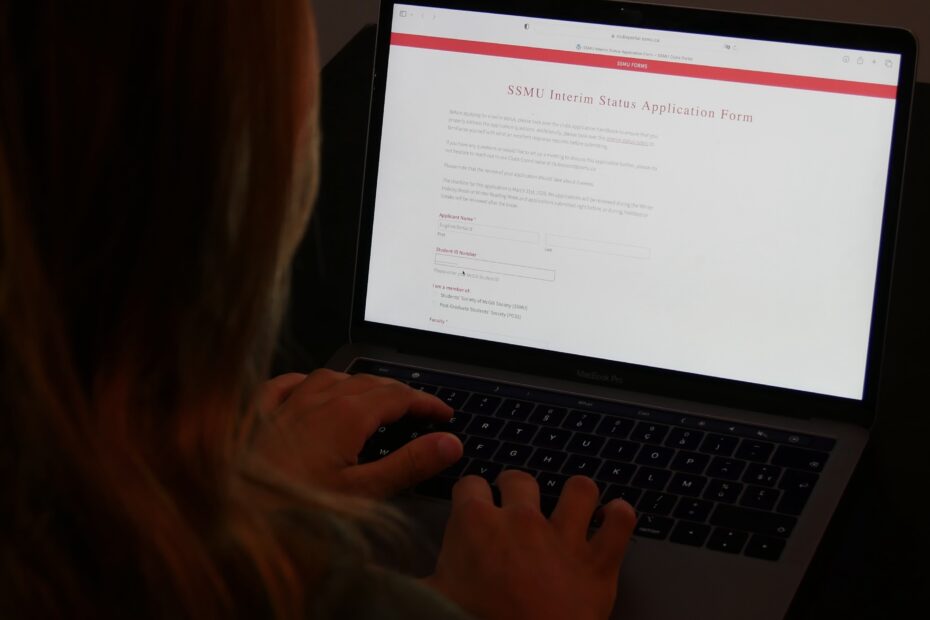Peu nombreux sont ceux qui comprennent les ramifications administratives complexes de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM). Formée d’une multitude d’assemblées démocratiques, de comités et de sous-comités, elle assure une gouvernance de quelque trois millions de dollars sur une base annuelle. Outre une simple gestion des frais qu’elle perçoit de la population étudiante, elle coordonne bien des aspects de la vie mcgilloise, notamment en ce qui a trait à la formation de comités étudiants. Mais force est d’admettre que l’AÉUM est fragile, et que la lourdeur (perçue et réelle) de ses processus administratifs complique la tâche aux universitaires entreprenants en quête de reconnaissance officielle pour leurs comités.
Cette fragilité ne tient pas de l’opinion, mais bien du fait. En effet, de nombreux scandales et conflits internes ont récemment entaché la réputation de l’AÉUM, qui a même vu son accord avec McGill être interrompu l’été dernier. Les démissions subséquentes de certains des membres de son exécutif ont mis à l’arrêt forcé bon nombre de ses opérations, si bien que Le Délit a reçu la demande formelle, de la part de certains étudiants, d’enquêter sur les irrégularités criantes des procédures de reconnaissance d’un comité étudiant.
Il est question, dans les récriminations du corps étudiant, d’un temps d’attente pour une reconnaissance (même temporaire) s’étirant sur plusieurs années – attente jugée prohibitive à la pérennisation d’initiatives étudiantes. On déplore aussi des bris de communications, un manque de continuité des procédures et l’absence d’une personne-ressource stable pour assurer le suivi des dossiers actifs.
Pour mettre toutes ces critiques au clair, Le Délit s’est entretenu avec Hamza Abu Alkhair, vice-président des comités et services aux étudiants de l’AÉUM.
Enjeux institutionnels systémiques
Depuis les nouveaux bureaux luxueux et modernes de l’AÉUM au 3501 rue Peel, M. Abu Alkhair se lance dans une explication des attentes de son organisation envers tous les aspirants-fondateurs. Pour créer un comité étudiant, il faut « amender une constitution, créer un budget temporaire, une prévision des activités qui seront organisées, recueillir des appuis (tdlr) » et remplir le formulaire prévu à cet effet sur le site de l’AÉUM. Le processus, en apparence simple, est cependant complexifié par ce que M. Abu Alkhair appelle « un dédoublement fréquent des missions des aspirants-comités » – qui se produit lorsque les étudiants souhaitent obtenir une approbation pour un club qui existe déjà ou qui ressemble fortement au leur.
Le blâme revient-il donc plutôt aux étudiants, qui n’effectuent pas de vérifications préalables ? Dans les faits, pas vraiment.
La liste des comités existants fournie par l’AÉUM par le biais de son site Internet n’est pas à jour, et ce « depuis plusieurs années ». Pire, « plusieurs des comités qui y figurent n’existent même plus », me confie M. Abu Alkhair. Ce retard dans la mise à jour des données s’explique selon lui par le fait que « le processus de mise à jour prend du temps […] il faut créer une nouvelle page pour chaque comité, et nous en avons 200 à 300 au total ». Mais au moins, « les données internes sont à jour », me dit-il, d’un ton se voulant rassurant. La réalité l’est cependant beaucoup moins. Avant même que leur candidature ne soit consultée par l’appareil bureaucratique de l’AÉUM, les aspirants-fondateurs se butent à une base de données incomplète et désuète, ankylosant des démarches déjà compliquées.
Une fois la candidature complétée, cette dernière est évaluée par le Clubs Committee – une instance « sans laquelle les comités ne pourraient être approuvés », poursuit M. Abu Alkhair. Ce sous-comité, composé d’une variété de représentants de l’AÉUM et de la population étudiante, tient deux rencontres par mois. Il prend en charge l’évaluation, la révision et la coordination des différentes candidatures, et émet « ses recommandations au Conseil législatif, qui autorise par la suite la création des comités ». M. Abu Alkhair m’assure que « la décision est basée sur une grille de critères objectifs, et tout comité qui se conforme aux règles de l’AÉUM et qui est suffisamment novateur devrait éventuellement être approuvé ». En somme, personne ne peut voir sa requête être strictement refusée, mais l’aspirant-comité peut être enjoint à « modifier sa mission ou adapter les documents fournis » par des membres du sous-comité du Conseil législatif.
Il est aussi pertinent de se questionner sur le volume des demandes qui peut être traité par le sous-comité, qui détient le monopole décisionnel initial en ce qui a trait à la fondation d’un comité. Lorsque questionné sur le nombre de candidatures actuellement en attente d’une décision, M. Abu Alkhair estime que « 50 à 60 » comités patientent toujours, sans pour autant savoir si leur dossier est recevable. Il se donne comme objectif d’avoir révisé toutes ces candidatures avant la fin de la session d’automne, une tâche qui semble herculéenne étant donné les maigres résultats du sous-comité au cours des dernières années.
« Lorsque interrogé sur le nombre de nouvelles demandes faites chaque année, M. Abu Alkhair réplique simplement : “Bomboclaat, mon vieux, je n’en ai aucune idée” »
Ce régime d’évaluation décevant est expliqué par « la démission de membres de l’exécutif et une certaine instabilité institutionnelle » – problèmes récents endémiques à l’AÉUM, répétés maintes fois au cours de notre échange. M. Abu Alkhair déplore des mois et des sessions entières sans capitaine à la barre du navire, dont la conséquence directe est ce retard qui cause la grogne populaire.
Admettons cependant que le sous-comité se mette à tourner à plein régime pour le reste de la session, tenant environ cinq à six rencontres d’une heure chacune. Ce seraient donc 10 candidatures par rencontre, à raison de six minutes par dossier, qui devraient être évaluées pour maintenir le rythme escompté. Même M. Abu Alkhair concède que « la révision de 10 dossiers par rencontre est irréaliste ». Elle est aussi très précipitée, compte tenu des efforts des étudiants dans la préparation de documents constitutifs complexes et dans la collecte d’appuis de leurs pairs.
Un simple calcul nous montre que, malgré le bon vouloir du vice-président des comités et services aux étudiants, ses objectifs sont impossibles à réaliser. Surtout si l’on ajoute aux 60 candidatures en attente les dépôts assez nombreux qui s’ajoutent continuellement. Lorsque interrogé sur le nombre de nouvelles demandes faites chaque année, M. Abu Alkhair réplique simplement : « Bomboclaat, mon vieux, je n’en ai aucune idée. »
Cette réponse parsème notre entretien : il est évident que de nombreuses incertitudes planent quant à l’avenir nébuleux des aspirants-comités. Mais le cauchemar administratif ne s’arrête pas là. L’approbation d’un comité se fait en deux étapes : en premier lieu, un statut temporaire, et ensuite, l’obtention d’un statut permanent, si certaines conditions sont respectées. La patience inébranlable exigée durant l’attente d’obtention du statut (temporaire ou permanent) a tout de même ses avantages : « Tarifs de réservation réduits, adresse courriel et site Internet fournis, accès au fonds des clubs de l’AÉUM (statut permanent seulement)… » Comme quoi le jeu en vaut peut-être la chandelle. Ce dédoublement est cependant particulièrement frustrant pour certains gestionnaires de comité, qui se voient obligés de « tout renvoyer pour mettre à jour leurs listes de membres » – les délais d’approbation s’étant étirés au-delà de la graduation de certains signataires.
Si les retards et les délais ne résultent certainement pas d’une quelconque malice de la part de l’AÉUM, n’en demeure pas moins qu’elle est coupable d’une indéniable incompétence, sinon d’une négligence, à l’égard de ses étudiants. Pour vous prouver les méfaits réels d’une telle déresponsabilisation, Le Délit s’est également entretenu avec deux organisations qui peinent à obtenir le statut tant désiré de comité de l’AÉUM.

La grogne populaire des étudiants
La frustration a atteint son paroxysme pour David Luzzatto et Héloïse Puit, respectivement président et vice-présidente aux affaires internes de l’Association des étudiants français de McGill (AÉFM). Près de trois ans maintenant que ce comité attend de recevoir son statut permanent de l’AÉUM. Idem pour Maxime Rouhan, membre fondateur de McGill Eloquence, qui n’a toujours pas réussi à obtenir un statut temporaire après deux ans d’efforts continus !
Si l’attitude adoptée par M. Abu Alkhair pour traiter de la situation borde sur la nonchalance, le ton est beaucoup plus critique chez les étudiants. Pour David, le travail de l’AÉUM est tout simplement inacceptable : « Le suivi n’est pas assuré par l’AÉUM, et tout ce processus administratif ne fait que nous mettre des bâtons dans les roues. » Réapparue après la pandémie, l’AÉFM peine depuis à faire de quelconques progrès au-delà de l’obtention d’un frêle statut temporaire. Les procédures de l’AÉUM sont si bancales, surtout à la suite des « nombreux scandales et suspensions de services », que le comité s’est fait octroyer une « prolongation de son statut temporaire bien au-delà des limites prévues par le règlement ». Une énième preuve du caractère dysfonctionnel du processus d’approbation, selon David.
« Alors que, plus que jamais, les étudiants sont victimes d’une précarité financière étouffante, voilà que l’indolence de l’AÉUM en rajoute : par son inaction, elle force les étudiants à débourser eux-mêmes les frais de leurs passions »
« Les avantages d’être un comité de l’AÉUM ? Outre ne pas payer 20 dollars d’inscription pour Activities Night, je ne saurais en donner », me rétorque David, moqueur, alors que je lui demande pourquoi quiconque voudrait souffrir au travers des tergiversations de l’AÉUM. Maxime, lui, a une réponse sidérante : en attendant l’obtention d’un statut temporaire, McGill Eloquence défraie elle-même absolument tous les coûts relatifs à son fonctionnement. Le comité paie le prix fort : 300 $, selon Maxime, pour effectuer des réservations de locaux, si bien qu’il est forcé d’utiliser quelques stratégies créatives.
« Parfois, j’attends la fin des cours et je m’infiltre dans un local, en espérant que personne ne l’aura déjà réservé », me dit-il, dépité de devoir recourir à cette solution plutôt que d’effectuer une simple réservation comme tout autre comité accrédité. Difficile selon lui de pérenniser les activités si les membres actuels savent d’emblée qu’ils devront financer eux-mêmes les opérations du comité : « Nous n’avons pas accès à un compte en banque, et chacun doit contribuer de sa poche. »
Alors que, plus que jamais, les étudiants sont victimes d’une précarité financière étouffante, voilà que l’indolence de l’AÉUM en rajoute : par son inaction, elle force les étudiants à débourser eux-mêmes les frais de leurs passions. Cette réalité va complètement à l’encontre de sa mission et des objectifs de son existence. Comme le rappelle M. Abu Alkhair, « l’AÉUM dispose d’un important Club Fund, destiné aux comités pleinement accrédités » : mais à quoi sert-il, si autant d’embûches se dressent devant ceux qui veulent enrichir la vie étudiante ?
L’enjeu n’est pas uniquement monétaire. David a l’impression d’être ignoré par les responsables du destin de l’AÉFM, et il prend les grands moyens pour qu’on lui rende des comptes. « Si le club coordinator ne me répond pas, je passe au VP comités, puis au président de l’AÉUM lui-même ! » me dit-il. Il arrive fréquemment à Héloïse « d’attendre plusieurs semaines pour obtenir une réponse », ce qui est jugé « terrible » par David. Et pour cause : les membres de l’exécutif sont sommés d’être au service de la population étudiante, et perçoivent pour ce faire un salaire de près de 40 000 $ par année. Leur silence est le symptôme d’un « manque de responsabilisation, d’une absence de comptes rendus » – il est clair que les aspirants-fondateurs pensent que l’AÉUM peut en faire plus. Qu’elle doit en faire plus. Surtout lorsque l’on apprend que sa masse salariale a triplé depuis 2017–18, passant d’1 M$ à 3,1 M$ lors de l’exercice financier de 2024. Les salaires versés aux membres de l’exécutif connaissent eux aussi une croissance systématique, basée sur des indices de performance. L’AÉUM semble disposer de davantage de ressources et de main-d’œuvre, mais, dans les faits, elle stagne. Elle place supposément la création de comités au sommet de sa liste des priorités, mais se révèle incapable de concrétiser sa volonté : les interminables listes d’attente en sont la preuve. C’est à se demander à quoi elle sert véritablement, si elle est incapable de « gérer efficacement les demandes d’approbation » – son principal secteur d’activité en ce qui a trait aux étudiants, tout en étant rémunérée à leurs frais.
Les deux aspirants-comités se plaignent aussi en long et en large de multiples échecs administratifs : disparition du formulaire de candidature, dédoublement des demandes documentaires, silence radio de la part de la personne-ressource. Notre entretien est plutôt négatif : on sent que les étudiants en ont assez, qu’ils sont frustrés d’avoir à « tout recommencer pour se plier aux échecs de l’AÉUM ». Enfin, David me présente ses récriminations face au processus lui-même : il lui paraît complètement incohérent que chaque aspirant-comité doive « soumettre les mêmes documents alors que leurs missions et leurs moyens sont drastiquement différents ». Malgré cette simplification clairement incohérente, le processus demeure alambiqué, tortueux, presque sans issue. Décidément, peu de choses semblent satisfaire les étudiants quant à l’offre de services de l’AÉUM. Compte tenu des témoignages, il semblerait que la population étudiante se doit également de s’intéresser davantage à l’organisation qui a le contrôle total sur l’approbation des comités qui la composent.
Que feront les étudiants ?
Alors, que retenir de cette enquête ? Tout d’abord, toutes les parties impliquées reconnaissent que l’AÉUM a échoué dans son devoir de vérification et d’approbation des aspirants-comités dans un délai raisonnable. Les raisons évoquées varient : du côté de l’AÉUM, on déplore des années difficiles, gangrenées par un manque de personnel et un laxisme des vice-présidents précédents. Les étudiants, eux, sont plus critiques : l’administration actuelle ne fait que « pelleter les problèmes vers l’avant » et place le blâme de ses propres échecs sur d’autres circonstances. Elle échoue dans ses devoirs de communication et de reddition de comptes, et force parfois les étudiants à subir des délais prohibitifs à la création et au maintien des comités.
Alors que l’AÉUM devrait servir d’organe permettant aux comités de s’épanouir et de se faire connaître par la population étudiante, la réalité est tout autre : McGill Eloquence, l’AÉFM et bien d’autres comités auront énormément de difficulté à pérenniser leurs activités s’ils n’obtiennent pas le statut tant espéré.
« Si les retards et les délais ne résultent certainement pas d’une quelconque malice de la part de l’AÉUM, n’en demeure pas moins qu’elle est coupable d’une indéniable incompétence, sinon d’une négligence, à l’égard de ses étudiants »
Les étudiants soumettent tous les documents demandés et se plient docilement aux exigences de l’AÉUM. Le problème : on ne leur rend pas la pareille. Les modifications des constitutions prennent « plusieurs mois » à être approuvées, malgré la simplicité des changements effectués, et leurs listes de membres souffrent du roulement inhérent qu’engendre une attente de plusieurs années. La mission première du comité devient donc l’obtention d’un statut plutôt que la planification et l’organisation d’activités, ce qui, pour David, est insensé : « Comment peut-on savoir ce qu’on va faire si l’on ne sait même pas quel genre de financement on va recevoir ? »
C’est donc à se demander si l’AÉUM accorde un quelconque avantage aux comités qui veulent l’intégrer. Avec l’avènement des rencontres en distanciel et la numérisation croissante du quotidien des étudiants, il est clair que les bienfaits d’être un comité accrédité sont en baisse, surtout s’il est de plus en plus difficile d’être reconnu. Les étudiants sont proactifs et prennent en charge leurs « propres activités de financement » – signe qu’ils se refusent à abandonner leurs projets et passions simplement parce que l’AÉUM est trop incompétente ou désintéressée pour donner suite à leurs demandes.
Le Clubs Committee aura énormément de travail dans les mois qui suivront : plus de 60 demandes en attente depuis l’année passée seront évaluées. Selon M. Abu Alkhair, tout cela sera bouclé avant décembre 2025 – espérons qu’il saura tenir parole – afin que les aspirants-comités puissent avoir accès à tous les avantages auxquels ils cotisent chaque année par le biais de leurs frais de scolarité.
Il n’est certainement pas souhaitable que, dans leur processus, les étudiants aient pour réponse à leurs interrogations cette phrase ridicule, prononcée avec désinvolture : « Bomboclaat mon vieux, je n’en ai aucune idée. »
Le Délit est ravi d’apprendre que, moins d’une semaine après son entretien avec Hamza Abu Alkhair, le comité McGill Eloquence a enfin reçu une réponse de suivi concernant l’obtention de son statut de comité temporaire de l’AÉUM. Pas encore une accréditation, mais au moins un pas dans la bonne direction. Bien qu’il ne pourrait s’agir là que d’une coïncidence, il est clair qu’un contact direct avec les entités décisionnelles responsables ne peut être que bénéfique à l’avancement des candidatures en attente.