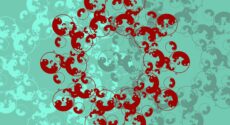« Ses dents étaient dangereusement rivées à mon gland. Et je craignais que parvenue comme elle l’était aux combles de la frénésie, des larmes et de la passion, elle ne vint le mordre à pleines dents et à me le guillotiner. J’ai dû la chatouiller pour la forcer à desserrer la mâchoire »
Henry Miller
J’ai du mal à parler, donc je vais te l’écrire. La fin de semaine dernière, je me suis mâché l’intérieur des joues jusqu’à ce que la douleur me sorte de mon obsession momentanée. Autrement dit, je me suis creusé l’intérieur des joues pour me nourrir jusqu’à la limite ; plus je m’en approchais, plus l’euphorie provoquée par ce comportement autophagique était exaltante. Cela fait déjà quelques jours, et bien que je me serais passé de mes aphtes hérités, ils m’ont quand même fait réaliser à quel point il est banal de consommer des parties de son propre corps. Peut-être es-tu toi même en train de lire cet article en te rongeant la peau autour des doigts pour savourer des morceaux d’ongle sans vraiment en prendre conscience. Si tu as de la chance, tu n’y seras confronté qu’en lisant ces lignes, sinon un panaris te le rappellera.
Le cannibalisme désigne la consommation de chair humaine dans le cadre d’un rituel, tandis que l’anthropophagie ne couvre que la consommation. Ces deux pratiques sœurs fascinent les humains tant elles attirent qu’elles repoussent. Les comportements d’autoconsommation décrits plus haut peuvent, en quelque sorte, être rapprochés de l’anthropophagie. Ce constat est déroutant parce qu’il ampute une partie du caractère fantasmé que l’on rattache habituellement à cette pratique. Quelle est donc la part de trivialité attachée à la consommation de son corps – et, a fortiori, de celui de nos congénères ? Avec une préoccupation contemporaine grandissante liée à la consommation de viande, pourrait-on même tendre vers une acceptation éthique de l’anthropophagie ?
Ambiguité : cuit, cru et pourri
L’anthropophagie relève du monstrueux sans pour autant être fantastique. La violence qu’on associe à ses adeptes est rattachée à une force mythique, voire romancée. C’est un acte spectaculaire qui affirme à la fois la bassesse de l’homme et le paroxysme de la cruauté : l’individu dévore son congénère. Toutefois, la simplicité de l’acte est animale tant elle implique, dans la culture, un instinct de survie.
Prenons Le Radeau de la Méduse, du peintre romantique Théodore Géricault. Dans cette peinture, on observe des naufragés sur un radeau qui sont conduits, selon le critique d’art Jonathan Miles, « aux frontières de l’existence humaine ». Il ajoute : « Devenus fous, isolés et affaiblis, ils massacrèrent les plus rebelles, mangèrent les cadavres et tuèrent les plus faibles ». Alors que l’homme peut survivre plusieurs semaines sans s’alimenter, les naufragés se sont livrés à des actes anthropophagiques dès le septième jour. Par conséquent, dans cette situation, la motivation de survie peut, à certains égards, perdre en crédibilité. En effet, si la consommation de ses camarades n’est pas nécessaire pour rester en vie, elle représente donc un caprice cannibale, doublement barbare.
« L’anthropophagie affirme à la fois la bassesse de l’homme et le paroxysme de la cruauté »
Dans ses Essais, le philosophe français Michel de Montaigne critique la démarche sophistiquée qu’avaient les Européens lorsqu’il s’agissait d’aborder les peuples autochtones pratiquant l’anthropophagie. En effet, les Européens avaient tendance à faire une représentation caricaturale, erronée et finalement crédule des populations autochtones alors qu’ils reprochaient justement la naïveté de ce que Rousseau, puis ses contemporains, appelaient « bons sauvages ». Les occidentaux du 16e siècle estimaient que les mœurs étrangères étaient inférieures à celles auxquelles ils étaient habitués. Par conséquent, elles n’étaient perçues que sous le spectre de la sauvagerie. Montaigne met à mal l’utilisation du mot « barbare », utilisé abusivement pour décrire les peuples autochtones outrageusement diabolisés, et rappelle que son sens premier se réfère aux étrangers, soit tout simplement ceux qui ne sont pas grecs.
Par ailleurs, dans certaines tribus anthropophages, on croyait que boire le sang et manger les corps ennemis permettait de se nourrir de leur force vitale. Ce délire sanglant est une conviction psychotique ; il reposait sur la croyance que boire du sang rapprochait l’anthropophage du divin. Dans Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, Jean de Léry, voyageur et écrivain français, se rend compte du décalage entre la perception européenne de l’Amérique du Sud et la réalité sur place. Il écrit que « leur principale intention est, qu’en poursuivant et rongeant ainsi les morts jusqu’aux os, ils donnent par ce moyen crainte et épouvantement aux vivants ». On comprend ainsi que l’acte cannibal peut être réalisé non pas seulement par la volonté de consommer ses semblables pour se défouler, mais aussi pour des raisons religieuses. De plus, ces rituels n’avaient lieu que très rarement et n’étaient pas systématiques, suggérant à nouveau que l’acte anthropophagique peut être dénué de toute pulsion émanant d’une addiction.
La lecture de ces deux penseurs met en lumière la perception erronée de l’anthropophagie tenue par les sociétés occidentales à travers l’histoire, qui la voyaient uniquement comme une expression de déviance, de perversité et de démence.
Le projet Ouroboros Steak : une faim en soi ?
Dans son livre Du goût de l’autre : Fragments d’un discours cannibale, l’anthropologue Mondher Kilani écrit sur le projet Ouroboros Steak, qui propose de créer de la viande humaine à partir de cellules prélevées au niveau des joues et cultivées pendant trois mois. La logique de la mesure serait de résoudre à la fois des considérations environnementales et éthiques contemporaines, car elle permettrait de produire de la viande sans la pollution et la souffrance liées à l’élevage animal. Selon le penseur, la consommation d’un produit comme celui-ci « ne constituerait pas une rupture anthropologique majeure ». En effet, il faut rappeler que le rapport actuel que nous avons avec la viande repose métaphoriquement sur un modèle cannibal : nous gardons les animaux d’élevage proches de nous, les transformons en membres de notre communauté, seulement pour les envoyer à l’abattoir quelque temps plus tard. Lorsque l’on se rappelle qu’avant un steak, il y a un veau, l’idée de le consommer peut rendre plus mal à l’aise. C’est pour cela que les abattoirs sont cachés et hautement protégés, pour permettre un déni suffisant.
« Le rapport actuel que nous avons avec la viande repose métaphoriquement sur un modèle cannibal »
Le touche-à-tout Roland Topor écrit au 19e siècle dans La Cuisine cannibale que le mythe ancestral qui motive les expériences cannibales est la croyance que la viande humaine serait, au même titre que l’espèce humaine, supérieure. Cela rappelle l’expression « Nous sommes ce que nous mangeons », qui insinue que seuls les cannibales sont véritablement humains. Cet adage est d’ailleurs originellement rattaché à l’hindouisme avant d’être vulgarisé.
Somme toute, si l’on se fie à ce vieil adage hindou, un cannibale ne mange pas vraiment quelqu’un d’autre lorsqu’il mange quelqu’un qui lui ressemble ; il se l’approprie jusqu’à ce qu’il fasse partie de lui-même. Il l’ingère, le digère et l’incorpore. Le cannibale dans la conscience populaire est mystifié. Il est vu comme un « barbare », pour reprendre Montaigne, comme un étranger alors qu’il reste en fait le même que nous, avec les mêmes que nous, au même endroit que nous et en mangeant les siens. On peut interpréter les pratiques anthropophages comme des pulsions de fin, s’exprimant en réponse à une conception profondément pessimiste de son existence. Ce serait un aveu : le rapport avec autrui est et restera impossible. La crudité de cette réalisation est insupportable. Finalement, elle serait encore plus dure à digérer que l’un des siens…