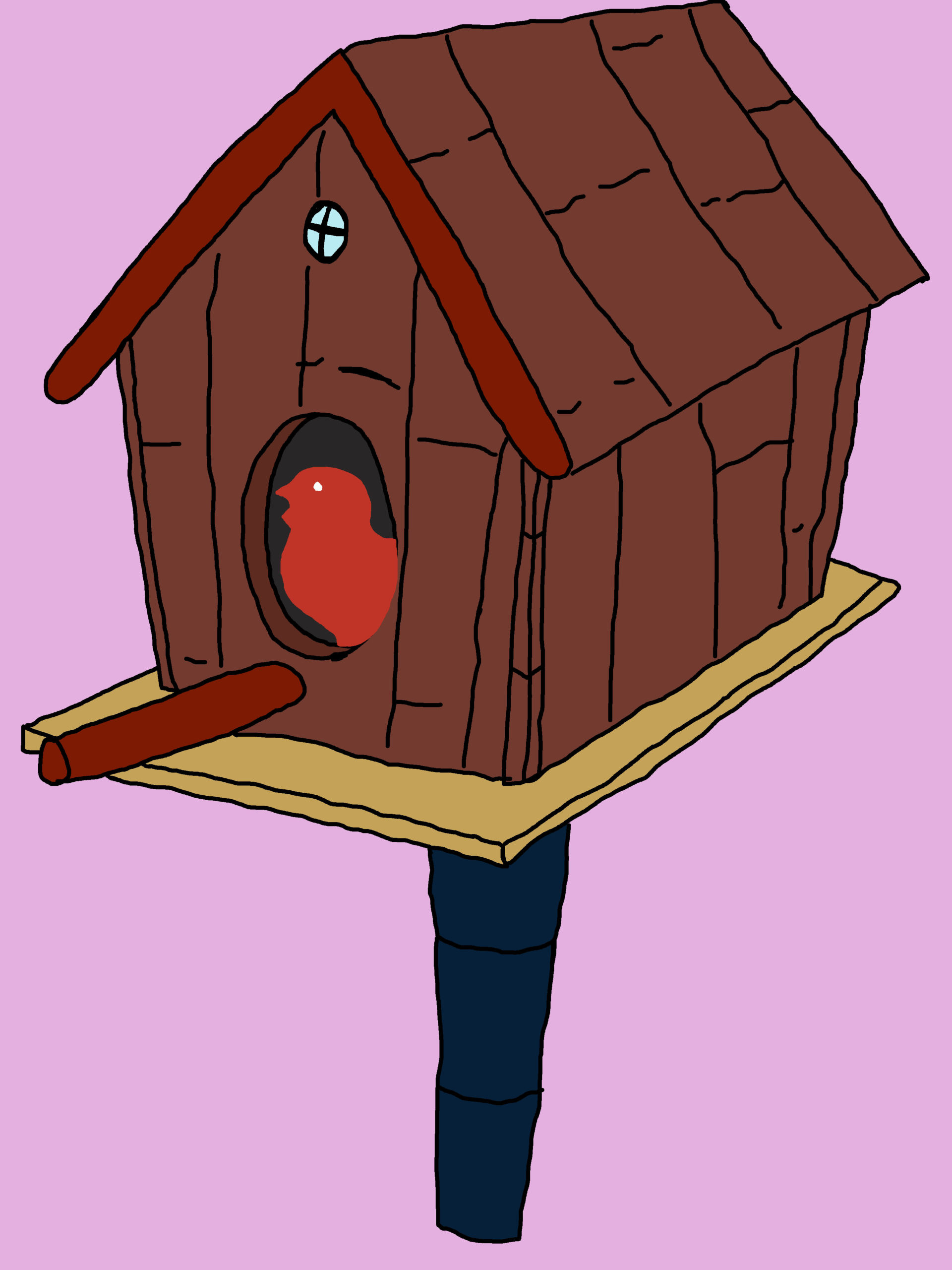Il aura suffi de quelques jours pour que tout bascule. Quelques jours pour voir le campus se vider, les résidences être désertées et un étrange silence, ponctué par les remous de l’actualité, s’installer. Le jeudi 12 mars, l’Université McGill annule les cours du lendemain et suspend jusqu’au dimanche « tous les événements prévus sur ses campus et susceptibles d’attirer plus de 250 personnes ». Le 13 mars, le premier ministre québécois, François Legault annonce la fermeture des écoles, cégeps, et universités pour deux semaines, prolongées finalement jusqu’au 1er mai. En réaction, le dimanche 15 mars McGill acte l’interruption de « tous les cours, cours en laboratoire, examens et autres évaluations pour une période de deux semaines, à l’exception de la soutenance de thèse ». L’Université se met alors au travail pour rendre les cours accessibles en ligne au bout des deux semaines et proposer des formes d’évaluations alternatives. En seulement quatre jours, alors que le nombre de cas du Covid-19 au Québec demeurait bien inférieur à d’autres régions du monde, le quotidien de la communauté mcgilloise a basculé face à une situation inédite. Tandis que le semestre reprend à distance, Le Délit a recueilli les témoignages d’étudiant·e·s et d’un professeur qui racontent ces deux semaines et partagent leurs ressentis.
Étudiants et étudiantes : temps difficiles
Pour beaucoup d’étudiant·e·s dont les proches ne résident pas au Québec, il a d’abord fallu décider, souvent dans la précipitation et l’incertitude, de demeurer à Montréal ou de faire ses valises en quelques heures, dans la crainte des fermetures de frontières et des suspensions de liaisons aériennes. À un étudiant qui le contactait le lundi 16 mars, le consulat de France répondait sans détours « si vous voulez rentrer, c’est maintenant ». Hayah, étudiante en première année en histoire et science politique n’a pas pu retrouver ses parents au Koweït. Elle a finalement rejoint des ami·e·s de sa famille à Vancouver. « Savoir qu’il est indéfiniment physiquement impossible de voir et d’être avec ma famille était quelque chose de très difficile à affronter » confie-t-elle. « C’était juste trop dur de rester dans la résidence toute seule » ajoute-t-elle, « en particulier parce que la plupart de mes ami·e·s sont parti·e·s, et la résidence est devenue une ville fantôme ». Le 18 mars, le Service de logement étudiant et d’hôtellerie (SHHS, Student Housing and Hospitality Services en anglais) adressait un courriel à tou·te·s les étudiant·e·s en résidence universitaire les exhortant à « retourner à la maison aussi tôt que possible dans la mesure du possible ».
Julien, étudiant en échange qui s’est résigné à revenir en France évoque quant à lui des raisons « logistiques ». « Dans un premier temps je n’envisageais pas du tout de rentrer en France car la situation d’un point de vue sanitaire me semblait plus sûre au Québec où les mesures ont été prises plus tôt et où les gens font beaucoup plus preuve de civisme qu’en France » explique-t-il. « Mais assez vite j’ai commencé à entrevoir les soucis qui pouvaient venir avec la fermeture des frontières. J’ai redouté un arrêt des liaisons aériennes. En fait, mon inquiétude était beaucoup plus d’ordre logistique : je voulais être en France pour pouvoir être à proximité des endroits où j’aurai des obligations à partir de mai, je pense notamment à un stage qui devait commencer mi-mai mais qui semble compromis ». En revanche, Gabrielle a elle opté pour l’option inverse : « Pour moi, ça ne faisait pas vraiment de sens de rentrer en France, dans la mesure où j’ai la chance d’avoir une bonne assurance santé ici, un logement où je suis tranquille, et que j’aime immensément la ville de Montréal et ne suis pas du tout prête à la quitter. Je redoute aussi un peu le confinement avec ma famille, et j’ai estimé qu’il valait sans doute mieux pour nous tous qu’on ne soit pas trop entassés les uns sur les autres ».
Une fois l’urgence de la décision et la stupeur des premiers jours traversées, un quotidien nouveau, souvent confiné, s’est installé. Et avec lui, des questionnements, des émotions inconnues et des effets sur la santé mentale. Julien éprouve « un sentiment de vide très fort. […] Une forme de vide émotionnel : je ne sais même pas quoi ressentir, je ne sais pas si je dois me sentir en sécurité, en danger, optimiste, pessimiste. C’est très déroutant comme situation ». Quant à Gabrielle, si la solitude ne lui « fait pas peur », elle reconnait que c’est « compliqué ». « Personnellement, j’ai en plus de ça une histoire médicale assez compliquée en termes de santé mentale — anxiété, TOC, TCA, bref, j’ai de quoi faire — et forcément, une telle pression globale et constante, ça ne peut que venir réveiller mes angoisses » avoue-t-elle. Citant The Guardian pour sa couverture à la fois « transparente » mais sans être « catastrophiste » de la situation, Gabrielle ajoute : « J’ai décidé il y a quelques jours de me couper autant que possible des réseaux sociaux et des sites d’informations que j’estimais trop « dans l’émotion », et privilégie des médias qui veillent à garder un ton aussi « scientifique » et factuel que possible ». De son côté, quand elle était encore à Montréal, Hayah « essayait de se lever à une heure normale, s’habiller comme habituellement et marcher chaque jour ». « Je cuisinais aussi avec un·e ami·e, ainsi j’avais quelque chose à attendre avec impatience chaque jour ». Une fois à Vancouver, elle a essayé de ne pas quitter cette discipline. « Je recommanderais vivement cela » affirme-t-elle, « avoir le sentiment d’un objectif m’aide vraiment en ce moment ». Bien sûr, tou·te·s sont en contact régulier avec leurs proches. « Je passe beaucoup de temps sur Messenger, WhatsApp, ça soulage toujours d’être en contact avec ses proches, et j’ai à vrai dire repris contact avec un certain nombre de connaissances que j’avais un peu perdu de vue » résume Gabrielle.
Profs et administration : entre prudence et hâte
Si le quotidien des étudiant·e·s est bouleversé, il n’en est pas moins de celui des professeur·e·s et de tous les autres membres de la communauté mcgilloise. Un professeur, en quarantaine car sujet à risque, enregistre des versions audio de ses cours et décrit au Délit une « expérience désincarnée ». « Un prof sans élèves ce n’est pas un prof » lâche-t-il. Son quotidien se résume à beaucoup « d’administration des aménagements, des inquiétudes ». « Il y a une forme d’excitation quand on sent que l’on fait face à un grand rendez-vous [historique] […] donc je vis ça d’un côté avec une forme de curiosité mais c’est très anxiogène aussi parce qu’on a peur d’être malade ».
Depuis le 27 janvier, McGill alimente régulièrement une page spéciale consacrée au COVID-19 sur son site internet et informe par courriel la communauté mcgilloise des dispositifs mis en place dans le cadre de la pandémie. À la suite des mesures restrictives adoptées par le gouvernement québécois, l’Université a dû réagir dans l’urgence et répondre aux interrogations de ses membres. Alors, que penser de la réaction de l’administration ? Hayah et Gabrielle s’accordent pour reconnaître la position délicate dans laquelle se trouvait McGill. « McGill était réellement dans une position difficile. S’ils agissaient trop tôt, ils se seraient faits critiquer mais s’ils ignoraient les régulations, ils auraient aussi été critiqués » souligne Hayah, tout en admettant qu’elle aurait souhaité que McGill « annonce cela plus tôt parce que j’aurais pu rester à la maison avec ma famille et éviter le stress que j’ai vécu durant les quelques semaines où j’étais à Montréal ». Elle regrette également que l’Université n’ait pas fermé plus vite les cours rassemblant de larges effectifs, comme en Leacock 132. « J’ai honnêtement trouvé McGill assez exemplaire par rapport à l’immense majorité des autres universités partout dans le monde, d’après tout ce qu’ont pu m’en dire mes amis, en France, aux Etats-Unis ou ailleurs. Difficile de savoir ce que McGill aurait fait d’elle-même sans les instructions du gouvernement québécois, mais dans tous les cas, les mesures adéquates ont été prises, et bien qu’avec un peu de délai, on a fini par avoir les informations essentielles » plaide Gabrielle. En revanche, pour Julien, « la réponse de McGill face au coronavirus est révélatrice de forts dysfonctionnements ». « Je trouve que McGill a mis du temps à réagir et ne s’est pas illustrée par son anticipation et sa prise au sérieux de la menace dès le début ». « D’autre part je trouve qu’il y a un dysfonctionnement qui est révélé par ces deux semaines de vacances sans cours. On voit que l’université n’est pas à la page en matière d’usage technologique et numérique. Autrement le relais sur les cours en ligne aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. Ces deux dysfonctionnements révèlent le caractère rétrograde de McGill. C’est une université qui est encore sur un fonctionnement très militaire, marche ou crève, qui dans un premier temps considérait que cette pétition des étudiants qui souhaitaient que les cours passent en ligne, c’étaient des gamins de 20 ans qui n’avaient pas envie de bosser ». Pour le professeur que Le Délit a interrogé, au contraire, « l’idée du deux semaines d’arrêt a été importante pour nous permettre de rebondir ». « Mais ce qui est difficile c’est que ce sont deux semaines d’arrêt où l’on n’est pas que des profs. J’ai des enfants, j’ai des parents âgés donc il y a tout ça qui fait que c’est très dur d’être complètement opérationnel le 30 au matin ». Même s’il admet qu’une suspension définitive du semestre « aurait été plus simple », il trouve que « ça se passe bien du point de vue de McGill ». « Les collègues sont assez solidaires. […] L’université nous donne des directives de souplesse, par exemple le fait qu’il va être possible de faire un withdrawal même en ayant ses notes ». Mais il reconnaît : « Il va y avoir un soupir de soulagement quand la session va être terminée ».