David Turgeon a été bédéiste avant d’être romancier, critique de BD et essayiste, compositeur de musique électronique à ses heures et informaticien. Son roman, Le continent de plastique était en lice pour le Prix littéraire des collégiens en 2016.
Le Délit (LD) : Ma première question est toute simple : qu’est-ce qui vous a poussé à faire le saut de la BD au roman ?
David Turgeon (DT) : C’est passé beaucoup par la critique, c’est-à-dire que, au moment où j’ai commencé à faire de la BD — et je n’en fais plus vraiment depuis quelques années — je m’intéressais beaucoup à ce qui se faisait, notamment en édition indépendante. Je me suis mis à écrire de la critique, ça faisait un peu partie du même milieu, ou disons du même mouvement. Les deux se faisaient un peu côte à côte : j’écrivais des critiques, je lisais, je faisais moi-même de la BD. Autant lire de la critique me faisait réfléchir à la bande dessinée, autant écrire me faisait réfléchir à l’écriture. Ça m’a donc amené vers des lectures plus critiques, et aussi plus fictives. Simplement, à un moment, je me suis laissé prendre au jeu. Je me suis dit : « tant qu’à aimer écrire, je vais essayer d’écrire un roman. » C’est parti comme cela. C’est une évolution qui peut sembler curieuse, mais pour moi elle était assez logique.
LD : Je me demandais quelles ont été vos lectures les plus influentes dans votre construction littéraire ? Dans votre vie ?
DT : C’est une question complexe. J’ai lu beaucoup de bandes dessinées pendant longtemps. Je ne suis pas vraiment un lecteur de romans à la base. Du côté de la littérature, j’ai eu plusieurs phases, dont une où je lisais beaucoup de critiques. Des auteurs comme Pierre Bayard, qui est critique littéraire, mais aussi psychanalyste. Aussi, quelqu’un comme Daniel Arasse, qui est historien de l’art : il s’est mis à faire sa vie en écrivant des textes plus personnels assez étonnants, qui finissent par être une forme hybride entre l’essai et la fiction.
Quand je suis tombé dans les romans, j’ai lu beaucoup d’auteurs des Éditions de Minuit, comme Eric Chevillard ou Jean Echenoz, surtout. D’ailleurs, là, je dirais que j’en suis un peu sorti. Disons que récemment, je me suis intéressé à diverses choses, dont un écrivain argentin, César Aira. Il a écrit une centaine de romans, qui sont souvent très courts et assez étonnants. C’est quelqu’un qui écrit sans se relire — du moins c’est ce qu’il prétend — et en fait on pourrait le croire, parce qu’effectivement, du point A au point B, c’est une imagination qui se déroule, un jeu d’associations, on pourrait dire.
Un autre écrivain que j’ai beaucoup aimé est André Dhôtel, un auteur français mort il y a quelques dizaines d’années, qui a écrit beaucoup de livres, des histoires toujours curieuses, qui se passaient dans les mêmes lieux, comme dans le nord de la France ou en Grèce, qui a toujours une espèce de même obsession, une sorte de vision du monde qui est curieuse, qui est à la fois très paisible et très idiosyncrasique. Bref, des écrivains qui construisent leur monde à eux. C’est la plupart du temps ce qui va m’intéresser, plus que les choses grandiloquentes qui vont souvent intéresser d’autres personnes.
LD : Pour votre roman Le continent de plastique, vous avez créé un monde, pas fantastique ni de science-fiction, mais suffisamment différent de la réalité, flou, afin de vous permettre certaines digressions. Vous avez déjà mentionné en entrevue que cela vous avait permis de justifier, par exemple, la présence d’une faculté de littérature écrite et dessinée. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela vous apporte dans votre démarche artistique d’avoir ce « monde fantasmé » ?
DT : Il est certain que je veux quand même m’inspirer de lieux géographiques qui existent. À un moment, j’ai pris le pari un peu casse-gueule de faire des histoires dans des lieux qui sont construits, imaginaires, mais dans lesquels on peut reconnaître quand même certains aspects du monde. C’est sûr que dans Le continent de plastique, on va reconnaître une sorte de Montréal, mais un peu différente.
Il y a deux choses qui font que de construire une ville qui n’est pas Montréal, qui fait penser à Montréal, est intéressant. D’une part, ça me permet de ne pas m’attarder sur une espèce de tourisme du lieu ; je ne suis pas obligé de coller à la ville telle qu’elle est, mais aussi, ça m’oblige à faire des descriptions plus précises, à ne pas prendre pour acquis que l’on connaît ce dont je parle. Donc, je ne peux pas, par exemple, simplement nommer la rue Saint-Denis. Je dois préciser les caractéristiques de la rue, le quartier par lequel elle passe, dans lequel tel genre de personne va habiter, etc. Donc ça oblige à faire un genre de jeu descriptif où on est obligé de reconstruire la ville. Et c’est sûr que dans certains autres cas, ça me permet en effet de créer des lieux plus fantasmés.
LD : Est-ce qu’il y a dans ce cas une volonté de laisser l’imagination des lecteur·rice·s combler les trous d’une ville que l’on ne connaît pas déjà, justement ?
DT : Oui, il est sûr que le lecteur doit faire son travail, le fait sûrement. Les lieux déjà connus, cela ouvre la porte à certains clichés. Le cliché c’est une matière aussi que j’aime bien employer, en essayant de connaître les clichés et de voir quelle vie ils ont. Pour moi, le cliché n’est pas quelque chose qu’il faut fuir nécessairement. C’est un matériel de construction comme les autres. Je pense que le vrai problème avec le cliché, c’est quand on ne sait pas qu’il en est un. C’est là que l’on se fait avoir. Moi j’essaie plutôt de travailler avec les clichés d’une manière bricolée, c’est-à-dire en me disant que les gens ne vont pas nécessairement s’attendre à ce qu’ils soient là, qu’ils aient cette forme-là, et évidemment qu’ils soient mélangés avec des choses qui, elles, ne sont pas clichées.
Pour moi, le cliché n’est pas quelque chose qu’il faut fuir nécessairement. C’est un matériel de construction comme les autres
LD : Je me demandais si l’idée du continent de plastique avait occupé votre esprit longtemps avant l’envie d’en faire un livre ?
DT : Au départ, j’avais une obsession pour le titre. Je cherchais donc à coller une histoire sur le titre, qui est assez explicite, mais qui est aussi bizarrement poétique. Quand on le voit tout seul, on a l’impression qu’il y a quelque chose qui vit dans cette conjonction des mots, dans ce que cela signifie. J’ai eu envie de jouer avec ça.
J’avais déjà eu une idée pour laquelle j’avais ensuite réalisé que je n’avais pas envie de développer un roman durant. Je me suis donc rendu compte que j’avais d’autres canevas comme ça, des morceaux de romans que je collectionnais, mais que je n’avais pas envie de transformer en livre. Et donc, je me suis dit que je pouvais utiliser cela pour bâtir quelque chose, avec un personnage qui écrirait. Parallèlement, je voulais une certaine distance avec cela, je ne voulais pas que le « je » soit la personne qui écrit, je trouvais ça pour le coup trop cliché. Alors, j’ai eu l’idée de l’assistant de l’écrivain, qui suit de loin ces histoires-là, qui ne les comprend pas totalement. C’était amusant, car cela m’a permis de raconter des histoires que je n’aurais probablement pas été capable d’écrire. La multiplication des filtres faisait que je finissais par avoir des sujets qui me dépassaient complètement, mais que je pouvais aborder, effleurer, de diverses manières. C’est comme ça que ça s’est construit. On dirait de la plomberie, mais voilà (rires, ndlr).
LD : Dans Le continent de plastique, à un certain moment, le maître (l’écrivain) a des problèmes avec la transition de ses chapitres. En tant qu’écrivain, vous aimez aller dans toutes les directions dans un roman. Vous maîtrisez toutefois assez bien cet art de transition, car les passages d’un chapitre à un autre se font sans déranger. Comment réussissez-vous une telle chose ?
DT : Souvent, c’est le moment où l’on voit que la transition sera difficile que l’on bloque. Enfin, pour moi, c’est le blocage numéro un. Dans Le continent de plastique, j’avais développé une stratégie où, de temps en temps, je me permettais de sauter d’un paragraphe à l’autre, parfois de plusieurs semaines, ou par un passage de temps. De passer du passé simple à l’imparfait, cela permet de faire un saut temporel rapide qui n’est pas trop perçu sur le coup. J’essaie donc de travailler avec des ellipses entre les épisodes. Je pense que c’est quelque chose qui me vient probablement de la bande dessinée, parce qu’en BD, fondamentalement, on travaille sur l’ellipse. Il y a une discontinuité d’une case à l’autre, on est constamment en train de découper le temps de façon complètement arbitraire. Pour qu’il y ait du rythme, évidemment, il faut avoir une espèce de découpage qui donne l’impression qu’il n’y a en fait pas de discontinuités. Donc, je pense que j’essayais de faire un peu la même chose en écriture, de me dire des fois « bon, je coupe », et d’aviser cette coupure.
LD : Toujours à propos du Continent de plastique, le personnage de l’auteur à succès, appelé le maître, obtient son inspiration pour un livre alors qu’un événement en toutes apparences anodin commence à l’obséder. Denise Bruck, la femme du narrateur, elle, commence à écrire en couchant sur papier des événements de sa propre vie. Comment décririez-vous votre processus d’écriture à vous ?
DT : Disons que c’est plusieurs choses. C’est sûr que, quand je parle de plusieurs processus d’écriture comme ceux du maître, de Denise Bruck, c’est un peu pour caricaturer, pour simplifier, pour que ça fasse une bonne histoire.
Pour tout le monde, ça reste souvent assez complexe, ce qui nous mène à écrire quelque chose, et comment on fait pour arriver jusqu’au bout du truc. Moi, ce dont je me rends compte, c’est qu’il y a souvent la rencontre d’idées qui, a priori, ne sont pas compatibles, mais qui sont dans ma tête, et qui ne me viennent pas au même moment. Je les collectionne. Des fois, ce sont effectivement des images, des trucs assez anodins. D’autres fois, ça peut être des lectures, des choses qui m’ont marqué, des détails. Évidemment, ce n’est jamais suffisant pour écrire un livre. Et à un autre moment, je vais penser à une toute autre chose, et je vais faire le jeu de la combinaison. Donc, je me dis : « est-ce que ces deux trucs-là vont ensemble ? » Et parfois, je finis par trouver une espèce de façon d’accorder ces idées-là, qui ne sont initialement pas venues ensemble.
Par la suite, il y a plusieurs choses. D’une part, il faut beaucoup de discipline pour écrire souvent, et ce n’est pas une question d’être tout le temps forcé, mais je pense qu’il faut s’y mettre souvent. Si on peut le faire tous les jours, c’est bien, et sinon au moins quelques fois par semaine. J’essaie de me prendre du temps de côté pour cela, justement. Après, ça avance. Je me laisse écrire librement, en me donnant parfois des balises futures, en me disant « il faut que j’avance par-là », mais sinon j’aime me laisser surprendre par des choses qui surviennent quand j’écris. Simplement écrire, et voir qu’il y a un lien avec un truc que l’on vient de voir, d’entendre, et l’intégrer. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Je pense que quand ça fonctionne au mieux, je me rends compte que j’ai construit un genre de machine qui permet de faire entrer toutes sortes d’idées.
J’aime me laisser surprendre par des choses qui surviennent quand j’écris
Je pense que Le continent de plastique est un exemple de machine qui a bien fonctionné, parce que l’écriture avançait bien, c’était plaisant à écrire, c’était un espèce de feuilleton dans lequel je pouvais mettre tout ce que je voulais. Parfois, je me disais que j’avais envie que les personnages parlent d’un tel sujet, de tel truc, parce que j’en avais envie. D’autre fois, la machine peut être plus difficile à faire fonctionner, parce qu’elle peut avoir une autre volonté, disons. Incontestablement, il y a des romans qui sont plus difficiles que d’autres. Ce n’est pas forcément une question de sujet, mais plutôt de procédé, de ce que je me suis donné comme morceaux, comme petite machine.

LD : Et la fin, en avez-vous une idée au préalable, ou bien arrivez-vous à un moment où vous vous dites : « Bon, ça y est, c’est comme cela que ça se termine » ? Par exemple, dans Le continent de plastique, après la première lecture, l’on se dit que ça coupe sèchement.
DT : Je pense qu’il y a un moment dans l’écriture où je vois, j’envisage la fin, où je me dis que telle chose sera une bonne scène pour terminer. Pour Le continent de plastique, il y a un moment, je ne me souviens plus duquel, où cette fin-là m’a semblée évidente, en sachant même que cela allait probablement être abrupt. Je pense que, là où ça s’est arrêté, c’est un peu le moment où ce serait devenu une autre histoire, probablement plus une histoire de science-fiction. Les enjeux auraient été complètement différents. Donc c’était de toute façon le moment d’arrêter.
La scène en elle-même, c’est en fait quelque chose que j’ai vécu presque comme ça. C’est complètement ridicule, mais j’étais à Québec pour un Salon du livre, et ma conjointe et moi étions dans la piscine de notre hôtel, et il y avait une manifestation à l’extérieur. C’était une manifestation pacifique, contrairement à mon roman, mais ça nous a fait sentir quand même un peu cons ; on se demandait ce que l’on faisait là (rires, ndlr). Il y avait comme cette déconnexion forcée.
LD : Parlant de cette fin, justement, il y a un contraste assez vif entre l’espère de vigueur du narrateur au début, alors qu’il est encore à la fin de son doctorat, qu’il a ses ambitions, et le decrescendo jusqu’à la fin où — et il ne s’en frustre jamais, c’est plus un genre d’acceptation, de complaisance — il assume le second rôle qu’il finit par avoir en écriture. Est-ce que c’était une ligne directrice que vous aviez en tête dès le début ? Est-ce que vous essayiez de représenter quelque chose dans cet effacement de la vigueur que plusieurs personnes peuvent rencontrer dans leur vie ?
DT : Oui. Pour moi, la ligne directrice était effectivement l’apprentissage de l’effacement, pour le dire ainsi, dans cette acceptation de ce deuxième rôle qu’il tient. À la fin, on peut sentir qu’il est heureux dans ce qu’il est devenu. Il a accepté sa vie, il se rend compte en regardant autour de lui que ce n’est peut-être pas plus mal finalement. Je pense que je voulais un peu deux choses. D’une part, il y avait cet aspect comique, où j’ai cherché à faire un peu le contraire de À la recherche du temps perdu (de Marcel Proust, ndlr), où à la fin, le narrateur commence à écrire son roman. Dans mon livre, à la fin, on voit que non, il n’écrira rien.
D’autre part, je voulais faire d’une manière l’opposé que ce que d’autres ont déjà écrit : des narrateurs frustrés, fâchés de leur vie, qui trouvent qu’ils pourraient être mieux, qui ont une crise d’ambition, au point où l’on en vient à un cliché malheureux. Moi, ça me gonfle complètement comme genre d’histoire, donc je me suis dit que c’était peut-être le moment d’avoir un personnage qui aurait toutes les raisons d’être aigri, mais qui ne l’est pas. Bien qu’il le soit un peu au début, il apprend à lâcher prise, parce qu’au final il est bien entouré, alors ce n’est pas très grave. C’est un peu de la décroissance personnelle, un refus de l’ambition (rires, ndlr). C’est ce qui donne effectivement la trame du livre.
LD : Et cette acceptation de décroissance personnelle, y voyez-vous quelque chose de bien, ou plutôt une certaine médiocrité ?
DT : Non, je ne pense pas que ce soit de la médiocrité. C’est vrai que ça peut être interprété de plein de manières, mais je ne le voyais pas comme ça. Je ne pense pas que c’est ça, la médiocrité. La médiocrité, ce serait de faire quelque chose sans être particulièrement bon ou mauvais, et dans les faits, l’aide que le narrateur apporte, je pense qu’elle est bien. Le maître l’a quand même gardé avec lui, et sa femme n’a pas trop à se plaindre de ce qu’il fait. Alors non, je ne vois pas ça comme une entrée dans la médiocrité.
LD : Dans une entrevue avec Les librairies, vous aviez mentionné certaines intentions féministes dans votre roman Le continent de plastique et l’on peut en penser la même chose pour Simone au travail. D’où vous vient l’envie d’écrire précisément sur la place des femmes en écriture ?
DT : Pour dire les choses clairement, moi je ne revendique rien en particulier. Je pense que le féminisme est un mouvement qui doit être mené par des femmes. C’est-à-dire, ce que j’essaie d’être, c’est quelqu’un qui ne nuit pas. J’essaie juste de ne pas tirer la couverture du féminisme en disant « Bonjour, regardez-moi », parce que je pense que ça fait aussi parti du problème. Donc, disons que j’y pense autrement. Je cherche des histoires qui vont m’intéresser.
Je pense que le féminisme est un mouvement qui doit être mené par des femmes. C’est-à-dire, ce que j’essaie d’être, c’est quelqu’un qui ne nuit pas.
Je parlais de clichés tout à l’heure… Il y a une partie de moi qui aime tester des clichés. Il y a des histoires qui sont très faciles et elles sont faciles parce qu’elles viennent avec un bagage de présupposés, de personnages déjà tout faits, et notamment avec cette préconception sur la place des femmes et des hommes dans la fiction. C’est sûr qu’un personnage comme Denise Bruck, quand je commence à y réfléchir, c’est un personnage, je trouve, qui a beaucoup d’intérêts, c’est-à-dire que c’est un personnage qui a énormément de potentiel dans la fiction.
Et pour Simone, c’est un peu poussé au cran supérieur parce que c’est un peu fantaisiste comme histoire. Ça reste un personnage ouvert à toutes les aventures, qui accepte tout, qui dit oui d’emblée à ce que l’on lui présente, et donc cela l’amène dans des situations loufoques. Pour moi, ça fait une sorte d’étrangeté, ça me permet de sortir de ce que moi je connais et ce que je pourrais raconter trop aisément. Ça me permet aussi de raconter des trucs terre à terre, de faire réfléchir mes personnages, pour que cela devienne un peu matière à discussion, à réflexion.
Et bon, sans en faire un truc militant ou quoi que ce soit, je trouve que c’est plus intéressant, simplement. Un roman où il n’y a que des personnages de mecs qui discutent, ou quand il y a une femme elle sert à être regardée, baisée, et Dieu seul sait quoi, à un moment, je me rendais compte que ça me sortait par les oreilles, que c’était problématique. Je me suis dit qu’il y avait moyen de faire mieux, car la barre n’était pas très haute. Donc je ne me considère pas comme un grand révolutionnaire féministe, certainement pas, mais je pense que j’essaie de faire ma part un petit peu.
LD : Avez-vous une position face à l’appropriation-distanciation, courant littéraire fictif que vous avez bricolé, du moins de nom, dans votre roman ? Cherchez-vous à dénoncer ou à appuyer un tel courant ?
DT : Pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas ce que c’est, l’appropriation-distanciation. C’est un peu un gag. Je lis de la théorie littéraire, j’aime ça, et donc c’était un peu pour faire une sorte de parodie, qui m’est un peu dirigée au final. J’ai fait exprès de faire un truc qui ressemblait à un vrai concept théorique, mais qui est en fait inexistant. On a des personnages qui se sentent investis d’une mission révolutionnaire dans la littérature, et tout ce qu’ils font est conforme à l’appropriation-distanciation, et ce que leurs adversaires font ne l’est pas. Ce courant ne me faisait penser à personne en particulier. C’était plutôt un jeu. Ça revient aux mots d’ordre que l’on peut se donner quand on est jeune et qu’on a l’impression d’avoir inventé la roue. C’était drôle, mais c’est sans méchanceté ; ce sont des universitaires qui finissent par délaisser cette idéologie.
Quand on a un personnage comme Stéphanie, qui n’est pas capable de passer à autre chose et qui laisse les confrontations médiatiques la gruger, là ça devient tragique. C’est sûr que j’ai mélangé autre chose, qui n’a en fait rien à voir : la fin de la vie de Nelly Arcan, notamment.
Quand elle est passée à Tout le monde en parle, ça m’a beaucoup choqué et c’est quelque chose qui me trouble énormément, et comment on l’a traitée. Je trouvais que la violence médiatique avait été forte. Et ça en fait, j’avais besoin d’en parler, de mettre cela en scène, d’avoir un épisode extrêmement violent. Pour moi, c’était l’archétype de ce genre de violences médiatiques. C’était la manière peut-être de la présenter. Stéphanie était le personnage pour en parler, mais il est certain que ça la dépasse, que c’est au-delà de tout cela. Le parallèle est vraiment sur un épisode médiatique précis, pas tellement sur les figures qu’elle et Nelly incarnent comme écrivaines. Et c’était peut-être ma manière de dire que je trouvais cela répugnant que ces gens-là soient encore à la télé.
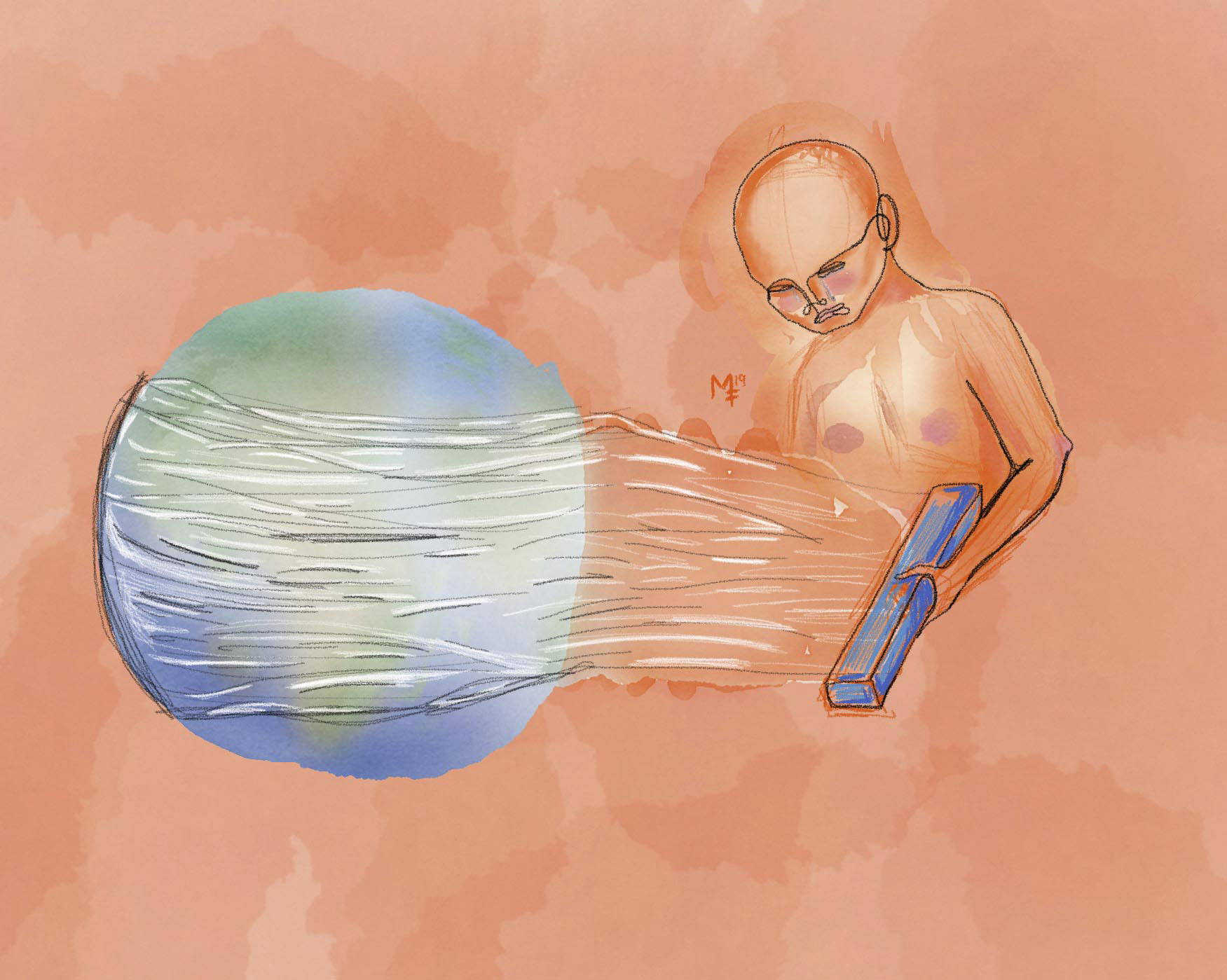
LD : J’aimerais revenir sur un évènement qui s’est produit l’an dernier. Quelle était votre position lorsque Amazon a été annoncé comme commanditaire principal de l’édition 2018 du Prix littéraire des collégiens ?
DT : J’ai pris position à ce sujet-là. J’ai dit publiquement qu’à mon avis c’était une grave erreur de s’allier avec Amazon, et pour des raisons peut-être un peu différentes de ce que certaines personnes ont amené (voir « La culture à quel prix ? », article paru dans l’édition du Délit du 5 février 2019, ndlr). Beaucoup de gens ont dit que c’était une question par rapport à la librairie indépendante. Effectivement, c’est vrai que par rapport à la librairie indépendante, c’est désastreux (voir « La diversité littéraire est-elle en danger ? », article paru dans l’édition du Délit du 2 octobre 2018, ndlr). Mais, pour moi, il y a une énorme marge par rapport à Amazon et par exemple Renaud-Bray et Archambault. Ce n’est pas du tout la même bestiole. C’est-à-dire que là, la position de Amazon dans la société actuelle, ce n’est pas du tout celle d’une entreprise comme les autres ; c’est une sorte de pseudo-état, qui met ses pattes absolument partout, et qui va profiter des investissements de l’État dans n’importe quelle situation, pour dire « moi, je vais venir prendre la place de l’État ». C’est littéralement une invasion d’une structure qui est une sorte d’État à part. C’est sûr que ce n’est pas reconnu comme tel, parce qu’Amazon n’a pas un territoire, mais dans les faits, il agit comme tel, c’est-à-dire ne paie pas de taxes, ne paie pas d’impôts. Finalement, il agit selon ses propres lois partout dans le monde et rien ne va l’arrêter.
Là, ça devient politiquement intenable d’accepter le moindre sou d’Amazon dans le cadre d’un prix littéraire. Ça dépasse la question des librairies indépendantes. J’aurais été un peu choqué admettons que ça aurait été Pierre Karl Péladeau (Québécor, ndlr) qui avait dit « Bonjour, je vais donner de l’argent », mais ça n’a pas rapport, il ne joue pas la même game que Jeff Bezos (propriétaire de Amazon, ndlr). Pour moi, c’était ça le problème. C’était beaucoup trop. C’était une abdication fondamentale. Il fallait dire non, il fallait que les gens se mobilisent, dans les écoles, les écrivains, les éditeurs aussi. Et effectivement, c’est ce qui est arrivé.
Ça devient politiquement intenable d’accepter le moindre sou d’Amazon dans le cadre d’un prix littéraire. Ça dépasse la question des librairies indépendantes
LD : Pensez-vous à ce moment-là qu’il y a un autre problème, outre Amazon ? C’est-à-dire, le Prix littéraire des collégiens n’est pas allé vers cette source de financement tellement par premier choix plutôt que par dernier recours, par que l’on ne voulait pas financer ailleurs un tel prix pour les étudiant·e·s du niveau collégial. Cela dévoile-t-il un problème plus creux au sein de l’industrie littéraire québécoise ?
DT : Oui, évidemment, ça déterre un problème de structure. Ça déterre un problème politique. C’est évident que ce sont des organismes qui devraient être financés de façon publique, comme ils l’ont déjà été. Ce sont donc des subventions qui devraient revenir, tout simplement.
Le Prix littéraire des collégiens, ça ne coûte pas grand-chose, relativement, de faire fonctionner ça. Ce n’est pas pour rien que Amazon est arrivé comme ça. C’est un prix littéraire qui ne coûte presque rien, et c’est celui qui fait le mieux rayonner les livres, en fait. Pas seulement le lauréat, mais aussi les autres finalistes. C’est une distinction qui est bien intéressante, qui fait parler d’elle, qui a beaucoup de retentissements. C’est assez grave qu’il soit délaissé. Je pense aussi que ce n’est pas le Prix le mieux organisé. Je trouve ça quand même bizarre que les organisateurs en soient arrivés là, même. Je les ai trouvés aussi naïfs. En fait, je n’ai pas compris qu’ils en soient arrivés à ce niveau de complaisance.


