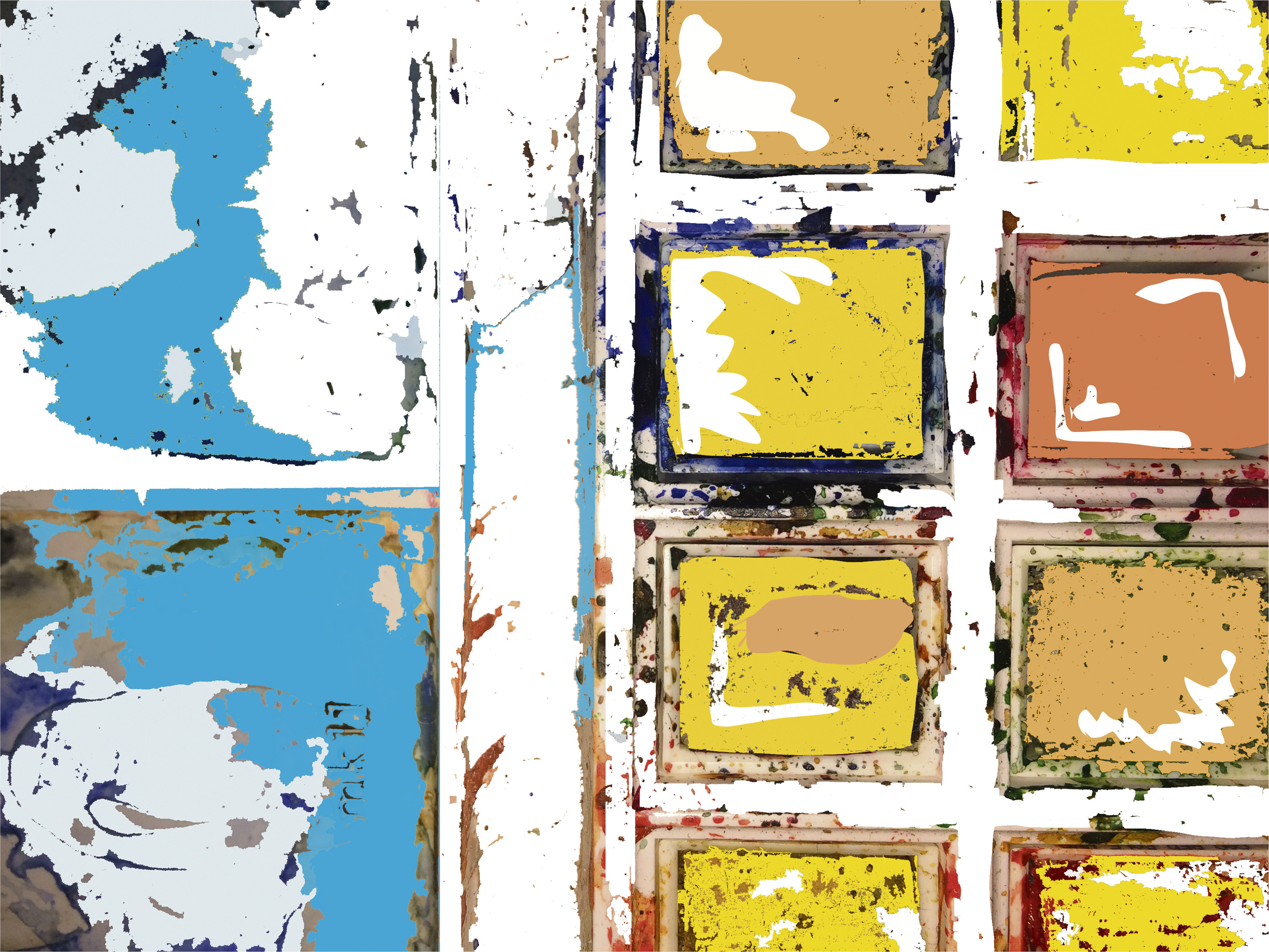Le goût pour le bien-être matériel, voire de l’opulence, est partout aujourd’hui : nous en faisons grand cas sur les bancs d’école, nous l’apprécions considérablement à l’épicerie, nous le voyons sur grand écran, nous l’admirons chez nos héros : ou plutôt, ce goût les remplace ; nous le rencontrons dans tous ses états. Tocqueville disait : « En Amérique, la passion du bien-être matériel n’est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; si tous ne l’éprouvent point de la même manière, tous la ressentent. »
L’ambition d’autrefois, celle de la gloire et du pouvoir, est effacée aujourd’hui par celle du bien-être matériel et individuel ; les vertus intellectuelles, morales ou guerrières sont remplacées par de nouvelles vertus : le travail, l’efficacité et l’industrie. C’est que ce système de valeurs, la richesse, est ce qui détermine aujourd’hui le mérite et qui fait l’excellence d’un individu. Cet idéal libéral met de l’avant l’homme qui travaille et qui s’enrichit de son travail — l’entrepreneur de notre époque — et exacerbe notre désir d’en avoir toujours plus. Nous jugeons non pas en fonction du caractère, mais en fonction du salaire ; non pas en fonction de ce qu’autrui est, mais en fonction de ce qu’il fait.
L’argent ne fait pas le bonheur
Peut-être vivons-nous à l’époque où le bien-être matériel est le plus communément accepté comme légitime objet de nos ambitions, de notre bonheur, et curieusement, c’est tout aussi également l’époque où il est le plus inopportun et le plus fâcheux de le reconnaître comme tel, où la grande aisance est la plus méprisée. Combien de fois n’avons-nous pas entendu quelques critiques adressées aux salaires des médecins, au même moment où nous désirons le plus voir nos enfants et nos amis devenir médecins. Voilà notre grande contradiction : nous sommes tous épris de cette passion du bien-être matériel, mais aucun ne veut lui reconnaître quelque importance ou quelque emprise. De là vient un proverbe bien de chez nous : « L’argent ne fait pas le bonheur. » Mais d’où peut bien venir que les uns s’en réclament par vanité et que les autres se le répètent par dépit ? D’où vient que nous ajoutions parfois avec une touche d’ironie « mais il y contribue » ou « seul » à sa suite ?
D’où peut bien venir que nous associons toujours le temps à l’argent et l’argent au bonheur, à une condition du bonheur ? Comme si le bonheur n’était pas une disposition de notre être, mais une affectation temporaire du corps, à une absence temporaire de maux plutôt qu’à une présence continuelle de bien ?
D’où peut bien venir que nous associons toujours le temps à l’argent et l’argent au bonheur, à une condition du bonheur ?
D’où peut bien venir que nous sommes accoutumés à croire que le bien-être matériel est l’antidote à tous nos maux ? Sans doute est-ce à cause de notre croyance matérialiste que l’argent, qui permet de tout acheter, nous amène à penser que l’on peut aussi acheter le bonheur. De fait, c’est que nous croyons qu’avoir une plus grande maison, avoir une plus belle voiture, voyager plus souvent « dans le sud », se payer des loisirs plus dispendieux ou simplement payer pour se sauver du temps, contribuent à notre bonheur, bref, que l’argent élimine nos soucis. Et qui suis-je pour juger que ce n’est pas le cas ?
Acheter le bonheur
Pourtant, Montaigne, qui était loin d’être pauvre, était d’un tout autre avis : il pensait que la richesse lui apportait bien plus de soucis que de commodités, bien qu’elle lui permît d’avoir les moyens de ses désirs les plus démesurés : « Tout compté, il y a plus de peine à garder l’argent qu’à l’acquérir. […] De commodité, j’en tirais peu ou rien : pour avoir plus de moyens de dépense, elle ne m’en pesait pas moins. » De fait, dans son essai Des inégalités entre les hommes, il raconte comment alors qu’il quittait la France pour gagner l’Italie, avec des sacs remplis de pièces d’or pour assurer ses dépenses, il avait grand-peine à rester calme face à l’idée de se les faire dérober : il était complètement absorbé par cette préoccupation. De même, Sénèque, qui était très loin d’avoir une fortune médiocre, disait à cet égard : « Qui dépend des richesses craint pour elles ; or personne ne jouit d’un bien qui l’inquiète. » En vérité, trop souvent vient avec la richesse la crainte de ne pas la conserver ainsi que la préoccupation de l’agrandir. Tocqueville, cet aristocrate d’une opulence éminente, doté d’une grande lucidité face aux enjeux de notre démocratie et de notre être, expliquait le phénomène de la sorte : « Ce qui attache le plus vivement le cœur humain, ce n’est point la possession paisible d’un objet précieux, c’est le désir imparfaitement satisfait de le posséder et la crainte incessante de le perdre. »
Par opposition à nos passions modernes, il me semble que le cas d’Alexandre le Grand, l’homme ancien par excellence, soit intéressant à examiner : il dispensait de ses biens matériels à ses amis, suite à ses conquêtes en Perse, dans une abondance inimaginable. C’est que, dans sa grande vertu, il voyait la richesse non pas comme un instrument pour mesurer son succès, mais plutôt comme un bien qui le gardait lié aux désirs de son bas-ventre : il ne cherchait ni « le plaisir et la richesse, mais la valeur et la gloire » ; des biens immatériels. Plutarque disait : « [Le goût du bien-être matériel est] comme un despote exigeant et impitoyable. Il force d’acquérir, et il défend d’user. Il excite le désir, et il interdit la jouissance. »
Mépriser le bien-être matériel
Je ne pense pas qu’il faille, comme Alexandre, mépriser les biens matériels, et s’en débarrasser complètement, d’autant plus que nos nécessités sont différentes des siennes. De fait, je préfère la posture de Montaigne et de Sénèque, qui nous mettent en garde quant aux biens matériels : ils ne veulent pas que nous soyons si occupés par la gestion de nos biens que nous oublions notre liberté ; si préoccupés par notre réussite matérielle et sociale que nous oublions de méditer. De même, à cet homme qui n’avait plus de temps à consacrer à ses études et à ses réflexions depuis qu’il avait hérité de son père, Plutarque répond : « Eh ! Malheureux ! T’a‑t-il rien laissé qui vaille ce qu’il ta ravi, à savoir le loisir et la liberté ? » C’est pourquoi, je crois, Sénèque exhortait Lucilius à se retirer de ses visées politiques, et pourquoi Montaigne nous exhorte à exercer notre jugement en ce qui a trait au goût du bien-être matériel : il ne faut pas être si épris de cette passion que nous oublions tout le reste. « Je n’estime point Arcesilaus le Philosophe moins réformé, pour le savoir usé d’ustensiles d’or et d’argent, selon que la condition de sa fortune le lui permettait : et l’estime mieux, que s’il s’en fût démis, de ce qu’il en usait modérément et libéralement. », nous disait-il dans ses Essais. Or, nous connaissons tous un Cratès en puissance, ce cynique qui avait jeté toutes ses richesses dans une rivière, et qui, en voulant complètement se débarrasser du bien-être matériel, en était autant préoccupé qu’un autre. Or, il faut reconnaître puis assommer le désir plutôt que le nier. Car si les biens du corps ne sont pas ceux que nous visons, encore faut-il accepter que nous ne vivons pas sans eux. Mais c’est que le bonheur lié au bien-être matériel, le bonheur de la richesse, comme l’appelle Plutarque, est vain : « En quoi consiste le bonheur de la richesse ? C’est qu’il en soit fait montre devant des témoins et des admirateurs : sans quoi elle n’est rien du tout. »
« En quoi consiste le bonheur de la richesse ? C’est qu’il en soit fait montre devant des témoins et des admirateurs : sans quoi elle n’est rien du tout. »
En effet, ce qui me préoccupe véritablement, c’est de savoir ce pour quoi ce proverbe n’est jamais articulé, selon ce que j’en juge, pour les bonnes raisons. Le bien-être matériel ne nous rend pas plus heureux, mais plus confortables, et même excite en nous des désirs qui outrepassent nos besoins. Antiphon, qui reprochait à Socrate de ne pas faire payer ses leçons et de mener une vie misérable, avait d’ailleurs mérité une réponse tout à fait fascinante : « Tu sembles croire, Antiphon, que le bonheur consiste dans le luxe et la magnificence ; moi, je pense que c’est le propre de la divinité de n’avoir aucun besoin, que, moins on a de besoins, plus on se rapproche d’elle. »
Un appel à la frugalité ?
Alors que plusieurs voient dans ce proverbe bien de chez nous un certain appel à la frugalité, ou encore à une certaine modération de l’avarice – comme si tout se rapportait et devait se rapporter à cette idée du bien-être matériel –, à moi il m’évoque immédiatement ces sages paroles de Sénèque : « Qu’une âme malade soit placée dans la richesse ou dans la pauvreté n’a aucune importance : son mal la suit. »
Cela, vraisemblablement, nous mène à une question des plus importantes : où faut-il chercher le bonheur, si le bien-être matériel semble insuffisant pour nous y mener, et si le mal suit même le riche ? En tout cas, Plutarque, me semble-t-il, offre une réponse des plus éloquentes à cette question : « Ce serait au mieux, s’il fallait que le bonheur s’achetât comme marchandise à vendre. Et toutefois vous en verrez plusieurs qui aiment mieux vivre au sein de la richesse en étant malheureux, que s’assurer la félicité en donnant de leur argent. Ce n’est pas quelque chose qui s’achète, que le calme de l’esprit, la générosité des sentiments, la constance, la fermeté, le secret de se suffire à soi-même. »
Voilà une idée qui semble disparue aujourd’hui : le bonheur, ce n’est pas quelque chose qui s’achète, mais c’est quelque chose propre à l’âme et qui vient avec le « calme de l’esprit, la générosité des sentiments, la constance, la fermeté, le secret de suffire à soi-même. » Qui peut prétendre aujourd’hui pouvoir se suffire soi-même ? À l’époque du self-made-(wo)man, il semble que la réponse attendue soit : tout un chacun. Et pourtant, il me semble que ce n’est pas la bonne réponse, parce qu’elle fait abstraction de ce savoir dont nous avons besoin lorsque nous dînons seuls : le contentement de soi. À cet égard, Montaigne, dans son essai De la solitude, rejoint tout à fait Plutarque : « La plus grande chose du monde c’est de savoir être à soi. »
Ce savoir, « savoir être à soi-même », il ne nécessite pas un détachement complet de la vie active, mais plutôt à ne pas être si attaché aux biens matériels et sociaux que nous oublions tout le reste ; ce n’est pas une vie solitaire à proprement parler à laquelle il nous incite, mais à une vie plus détachée des préoccupations domestiques, professionnelles, citoyennes, et des préoccupations liées à « l’ambition, l’avarice, l’irrésolution, la peur et la concupiscence », ces maux qui tiennent notre âme. C’est la vie qui nous mène à être capable de bien vivre avec nous-mêmes, de se plaire en notre propre compagnie, c’est celle qui nous apprend à nous parler à nous-mêmes, ou encore celle qui nous permet d’apprécier les biens les plus grands, c’est celle qui nous libère de la coutume et nous contente partout où nous sommes. C’est celle qui cherche non pas la gloire ou la richesse par le travail, comme la vertu politique d’une part et la vertu libérale d’autre part nous enseignent à le faire, mais la vertu suprême, et le bonheur, par le contentement de l’âme. Mais ce savoir présuppose une activité qui est différente de celle à laquelle nous sommes habitués, ou du moins, une certaine oisiveté : « Cettui-ci tout pituiteux, chassieux et crasseux, que tu vois sortir après minuit d’une étude, penses-tu qu’il cherche, parmi les livres, comme il se rendra plus homme de bien, plus content et plus sage ? nulles nouvelle. […] Qui ne contrechange volontiers la santé, le repos, et la vie, à la réputation et à la gloire ? La plus inutile, vaine et fausse monnaie, qui soit en notre usage. »
Cultiver notre arrière-boutique
Voilà ce pour quoi Montaigne critique aussi fortement Cicéron, Pline, mais aussi ces hommes qui perdent la santé par leur labeur ; ils mettent tout leur effort à être riches ou reconnus, plutôt qu’à chercher ce bien de l’âme, qui les rendrait véritablement heureux. C’est là où réside mon problème avec l’entrepreneur moderne : il lui faut quelques fois, parfois, souvent, sacrifier son loisir et sa santé en vue de ses biens matériels, et il néglige cette « arrière-boutique » dont nous parle Montaigne : « Il se faut réserver une arrière-boutique, toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite et solitude. »
Car c’est dans cette arrière-boutique, me semble-t-il, que nous trouvons le véritable bonheur, le seul qui ne dépend pas de ce qui nous est extérieur, et qui permet à tous, le pauvre comme le riche, de bien vivre. C’est ce savoir, cette connaissance de soi, et cette discussion avec soi dont Socrate nous fait montre, alors qu’il est en route pour le Banquet : « Chemin faisant, Socrate, l’esprit en quelque sorte concentré en lui-même, avançait en se laissant distancer. »
L’habitude de Socrate de se retirer en lui-même pour réfléchir en laissant ses convives paître parce qu’ils sont moins intéressants que le dialogue qu’il a avec lui-même, voilà l’arrière-boutique que tous devraient aspirer à avoir. Or, il me semble qu’une seule phrase du Banquet de Platon nous en dit plus sur la façon de bien vivre avec nous-mêmes, de bien vivre point, qu’une myriade de nos préoccupations modernes ; qu’un amalgame de textos insignifiants et de séries Netflix. Ce sont certes des divertissements agréables, mais notre grand mal aujourd’hui ne serait-il pas de n’avoir pour loisir que du divertissement, qui ne nous laisse rien à nous offrir ? Voilà l’intérêt de la réflexion sur soi, sur notre être. Et comment mieux l’alimenter qu’en trouvant en la lecture un miroir où se regarder ?
C’est pourquoi il n’est pas surprenant de lire, dans Les Mémorables de Xénophon, le commentaire qu’il fait quant au bonheur de Socrate : lui se plaisait à partager avec ses amis la sagesse des livres des présocratiques, de discuter sur soi avec des amis vertueux et intéressés, et cela faisait son bonheur : « Pour moi, quand je l’entendais parler ainsi, je pensais qu’il était réellement heureux. » En vérité, le contentement de soi et la connaissance de soi, ces biens qui présupposent une arrière-boutique bien garnie, ils ont l’avantage, sur le bonheur de la richesse, de construire en nous-mêmes plutôt qu’à l’extérieur de nous, là où ils sont soumis aux aléas de la fortune et aux hommes divers et ondoyants. Aujourd’hui plus que jamais, nous aurions intérêt à prendre soin de notre arrière-boutique. Voilà pourquoi ce proverbe bien de chez nous, « L’argent ne fait pas le bonheur », est si puissant et si vrai, et non pas pour les raisons que nous aurions pu initialement soupçonner. S’en suit pourtant un constat bien déprimant, constat qu’Allan Bloom nous partage avec désolation dans L’amour et l’amitié : « Nous vivons dans un pays où la lecture solitaire, avec le loisir et le calme qu’elle exige, a presque disparu. »
… Aujourd’hui plus que jamais, nous aurions intérêt à prendre soin de notre arrière-boutique.