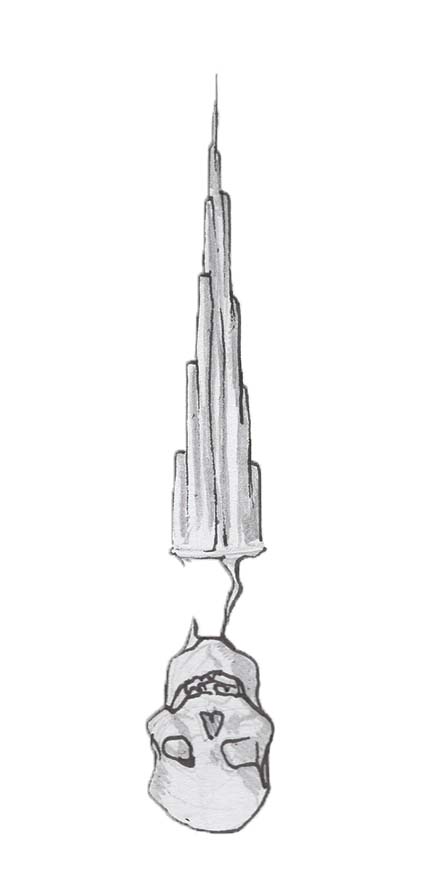Selon un rapport des Nations Unies, près des deux tiers de la population mondiale vivront en milieu urbain d’ici 2050. Quel sera donc le visage de la ville de demain ?
Autour du globe, de nombreux projets de villes nouvelles sont en chantier : Neom en Arabie Saoudite, Masdar aux Émirats Arabes Unis, Songdo en Corée du Sud, pour ne nommer que celles-là. Ces villes futuristes se positionnent comme les pionnières d’une révolution urbaine et sociétale, cherchant à incarner le futur et faisant compétition entre elles afin de devenir les épicentres d’une ère nouvelle en matière de progrès humain. Que penser de ces grandioses projets techno-utopiques ?
Il faut élargir nos horizons et oser affirmer que dans un monde fini, la recherche d’une croissance infinie n’est ni possible ni souhaitable
Le projet social avant la ville
Reprenant les propos de Serge Latouche, professeur émérite d’économie à l’Université Paris-Sud, ce type de ville représente une « utopie urbaine », c’est-à-dire un projet prétendant remédier aux problèmes environnementaux et sociaux grâce à l’organisation urbaine. Ceci rappelle grandement le type de ville envisagée par l’urbaniste Ebenezer Howard avec sa cité-jardin, autrement dit, une ville plus humaine. Pourtant, il est naïf de croire qu’un quelconque urbanisme puisse à lui seul enrayer des problèmes socialement enracinés. La planification urbaine joue certes un important rôle, mais ce n’est pas un remède miracle à toutes les sauces. Construire l’espace, bâtir l’habitat, planifier la mobilité ; toutes ces actions sont hautement politiques. L’architecture et l’urbanisme d’une ville ont des visées : répondre à certains besoins, créer des envies, encourager la pratique de certaines activités, etc. Serge Latouche a saisi la dimension sociale et politique de la ville en écrivant que le projet urbain est « nécessairement second au projet sociétal ».
Il faut donc considérer la crise urbaine (surpopulation, pollution, infrastructures désuètes, étalement urbain, etc.) à la lumière d’une analyse sociétale et non exclusivement en fonction de la manière dont nous construisons nos villes. Force est de constater que la gauche et la droite sont toutes deux obsédées par le partage du gâteau, jamais par le changement de sa recette, soit la société « croissantiste ». Il faut élargir nos horizons et oser affirmer que dans un monde fini, la recherche d’une croissance infinie n’est ni possible, ni souhaitable. Continuer à faire l’autruche en entretenant la croyance que plus équivaut à mieux est absurde.
Il faut en finir avec ces villes faussement durables, dites intelligentes, bâties avant tout pour en mettre plein la vue et destinées au « cyberman » (humain virtuel, ndlr). Ces projets urbains sont la glorification d’une croissance impossible à démocratiser. Séduisantes à l’unité, ces villes se révèlent fondamentalement inaptes à proposer une solution aux désastres écologiques qui ravagent la Terre. Leur solution, une forme de capitalisme vert, n’est simplement pas à la hauteur du défi. Le capitalisme vert et la Green Economy (Économie verte, ndlr) sont des tentatives de remédier aux problèmes environnementaux issus du capitalisme et de la croissance avec encore plus de capitalisme et de croissance. Ashley Dawson, professeur à l’Université de la ville de New York explique que « le capitalisme vert cherche à tirer profit de la crise, ne pouvant et ne cherchant pas à concilier son appétit insatiable d’expansion avec un environnement fini ».
La ‘‘perte collective du sens des limites’’, pour reprendre les propos du politologue Paul Ariès, aura notre peau si nous persévérons de la sorte
Pensons à la résilience
Au regard de cela, il apparaît que notre manière d’envisager les prochaines grandes villes est assez problématique. L’artificialisation des villes se fait au détriment de la durabilité de celles-ci, nonobstant leur branding de villes vertes et durables. Les villes intelligentes dépendent hautement de la technologie de pointe, celle-ci étant à la fois vitale à leur fonctionnement quotidien et à leur raison d’être. Certes, la spécialisation accroît la performance, mais elle réduit la résilience. Or, nous pouvons comprendre la résilience d’un écosystème urbain en tant que capacité d’adaptation aux changements ; si l’on y va de quelques exemples, il semble clair que la plupart des villes de la côte Est américaine ne sont pas vraiment résilientes à la montée des eaux, alors qu’une ville (si l’on présuppose une ville plus artificielle) telle que Neom ne sera pas en mesure —telle que planifiée— d’être autosuffisante et sera à ne point en douter hautement dépendante d’une série de technologies coûteuses. En ce sens, il ne peut y avoir de durabilité sans résilience, voilà pourquoi il est illogique de percevoir la ville techno-utopique comme étant un modèle à suivre.
La détermination de ces villes qui cherchent à se définir comme vertes relève d’une grande hypocrisie. Reprenons par exemple Neom, cette ville du devenir en Arabie Saoudite qui a comme objectif d’être totalement dénuée de pollution. Ce souhait d’un air immaculé semble assez ironique sachant que l’Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole au monde ; alors que cette ville aspire à devenir verte, elle le deviendra puisqu’elle aura développé les procédés pour évacuer ses multiples déchets de différentes natures vers des horizons invisibles. Pourtant, ces fameuses destinations qui recevront pétrole et déchets existeront bel et bien. De plus, mentionnons que Neom a l’aspiration de devenir une ville internationale, à l’instar de Paris, Londres et Hong-Kong, son objectif étant d’attirer le monde des affaires, sans oublier les touristes venus des quatre coins du globe. Comment concilier ces aspirations avec une préoccupation écologique ? En effet, selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le transport aérien est responsable d’une importante part de la pollution atmosphérique, « un simple vol transatlantique compte pour presque la moitié de toutes les émissions annuelles de CO2 (incluant chauffage, électricité, transport automobile, etc.) d’une personne moyenne ». Ne devient-il pas possible d’assimiler cette supposée considération à une entreprise hypocrite ?
Neom, entourée presque exclusivement de désert, aspire à être 33 fois la taille de New York. Au même titre, que dire de Songdo, là où il a fallu émerger des terres pour bâtir le complexe urbain ? Est-il raisonnable de bâtir de nouvelles villes immenses à partir de rien, alors que tant de villes actuelles font face au défi d’une adaptation éclair aux changements climatiques ? Le milieu artificiel, produit par et pour ces villes techno-utopiques, est représentatif du mythe de l’humain tout-puissant. La « perte collective du sens des limites », pour reprendre les propos du politologue Paul Ariès, aura notre peau si nous persévérons de la sorte. Il est absurde d’espérer que la mentalité croissantiste soit en mesure de résoudre les problèmes qu’elle engendre et c’est donc pourquoi il faut dépasser le développement durable et le capitalisme vert.
Pour une ville résiliente, dans la perspective d’une utopie urbaine éloignée des modèles remâchés, il faut repenser de haut en bas le système de production et de distribution des ressources naturelles, favoriser et reconstruire les systèmes locaux. Voilà à quoi devrait ressembler la ville de demain.