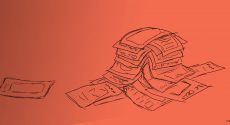L’étudiant-apprenti et le journaliste professionnel
Selon Jean-Francois Nadeau, directeur des pages culturelles du Devoir, le journalisme étudiant se caractérise d’abord par ses sujets qui perdurent dans le temps. Il y a des « invariants, comme la santé du système scolaire et l’éducation en général. » Si ces thèmes sont récurrents, les luttes les concernant sont toutefois extrêmement changeantes. « On mène les combats de nos époques, les luttes de société changent, et c’est tout à fait normal que les idées soient différentes de temps à autre. »
C’est notamment autour de ce sujet que Bernard Landry, ancien Premier Ministre du Québec, articulait ses propos lors de sa présentation au cocktail à l’honneur des quatre-vingt-dix ans de journalisme étudiant à l’Université de Montréal (UdeM) mardi dernier. En effet, M. Landry a exercé sa plume au Quartier Libre, l’actuel bimensuel étudiant de l’UdeM, et se remémorait pour l’occasion les luttes qu’il a mené du bout de sa mine. « Nous étions en pleine révolution tranquille », mais cette conjoncture politique n’explique pas à elle seule « la colère » et l’esprit revendicateur du Quartier Libre de l’époque. Il rappelle qu’alors, « il n’y avait toujours pas de régimes d’assurance-maladie pour les étudiants, pas plus, en fait, qu’il n’y avait de régime de prêts et bourses. Nos luttes étaient d’importance extrême. »
La rédactrice en chef du Quartier Libre depuis août 2009, Constance Tabary, s’accorderait sûrement avec M. Nadeau sur le fait que les luttes changent, mais que les sujets demeurent : « Nous avons nos combats à mener. » S’ils peuvent parfois sembler « moins flamboyants », il n’en reste pas moins qu’ils sont tout aussi significatifs pour les étudiants. « Notre ton est plus neutre, car le journal suit la tendance mondiale du journalisme anglo-saxon et privilégie les faits plutôt que l’opinion, ce qui peut aussi donner l’impression que notre contenu est moins dérangeant. »
L’éditorial du Quartier Libre de l’édition spéciale du 90e laissait présager un brin de nostalgie envers les grandes luttes sus-mentionnées du XXe siècle. « Les débats d’idées et l’esprit d’émancipation qui s’épanouissent à d’autres époques ont de quoi faire soupirer d’envie », y relève-t-on. Mais Constance Tabary n’en pense pas moins qu’il « ne faut pas se laisser intimider par les combats qui ont été couronnés de succès par le passé. Personne n’a encore le recul nécessaire pour juger de l’importance de ceux qu’on mène aujourd’hui. »
Enfin, pour Jean-Francois Nadeau, le journalisme étudiant, c’est aussi « passer des dizaines d’heures à travailler par semaine, à coordonner ses efforts avec ceux de ses collègues. C’est la volonté d’être ensemble, de changer les choses ». Questionné par Le Délit sur ce en quoi le journalisme étudiant se distingue du professionnel, M. Nadeau répond que le premier ne représente en rien « une école professionnelle ‑quoiqu’on y ait beaucoup à apprendre. En fait, ce n’est pas la place de ceux qui ont des perspectives exclusivement carriéristes. » Il s’explique : « ceux que j’ai fréquenté au Quartier Libre, ce sont des étudiants qui étaient intéressés par le contenu des articles, qu’ils étudient l’histoire, le droit ou la science politique. Ceux qui étudiaient en journalisme, ils n’écrivaient pas pour Quartier Libre. Ils n’étaient intéressés que par le contenant. »
Le journalisme étudiant et professionnel sont pourtant une seule et même chose pour Pierre Jury, éditorialiste au Droit, quotidien de langue française établi à Ottawa. Il faut pourtant noter qu’il a bâti son expérience de journaliste étudiant au McGill Daily, au moment où la publication était effectivement quotidienne, comme l’indique son nom. Il se souvient : « Je vivais à cette époque la même pression pour les heures de remise, sensiblement le même stress que je subis maintenant. La longueur des articles était la même que celle de nos articles au Droit. J’avais exactement les mêmes soucis par rapport à la qualité du produit fini. »
La vision de M. Nadeau diverge de celle de M. Jury, notamment en ce qui concerne la latitude qu’offre le journalisme étudiant. Si à l’époque « en tant que journaliste étudiant, tu p[ouvais] te foutre des annonceurs, parce qu’ils annon[çaient] de toute façon. » Tu ne peux pas te permettre de le faire en tant que professionnel, parce que la survie du journal en dépend. Il qualifie d’ailleurs l’industrie médiatique corporative de « milieu captif ». À ce sujet, il mentionne que « le journalisme tend à être une entreprise, l’art de remplir l’espace blanc autour des annonces publicitaires ». Il achève le portrait en additionnant aux contraintes imposées par l’industrie celle de la vitesse : il faut avoir la « capacité de travailler très vite » et, ainsi, les journalistes perdent la latitude de regarder autour d’eux. « On n’a plus le temps d’être sensibles, de lire autre chose que ce que ton travail nécessite ; ce qu’un journaliste père de quatre enfants n’a absolument pas le temps de faire. »
Bien qu’il y en ait toute une diversité, certaines qualités de ces praticiens demeurent toujours les mêmes. Selon la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, plus que jamais, « la polyvalence chez un journaliste est un atout certain. En télévision, les tendances actuelles décloisonnent les divers métiers (recherchiste, journaliste, réalisateur, monteur, caméraman) et il n’est pas rare qu’un journaliste radio se retrouve à la télévision, qu’un journaliste de la presse écrite se retrouve en presse électronique ou vice-versa. »
Non seulement faut-il jongler sur plusieurs plateformes, il faut également avoir des connaissances générales sur une foule de sujets. « Il faut être prêt à tout couvrir, spécialement en début de carrière », mentionnait cette fin de semaine à la Conférence régionale de la Presse Universitaire Canadienne, Philippe Orfali, jeune journaliste au Droit depuis mars 2009. « En ce moment, je couvre parfois les arts et les sports, alors que je déteste les arts, et… surtout le sport », concluait-il en souriant.
D’autres délits
En ce qui a trait aux différents journaux étudiants sur le territoire universitaire canadien, on en a pour tous les appétits. Chaque université a quasi-systématiquement son ou ses hebdomadaires étudiants, auxquels s’ajoute quelques publications périodiques, facultaires ou départementales, de même que des revues thématiques, certaines très académiques. Le tout, écrit par, pour, à travers et dans l’intérêt des étudiants.
Les caractéristiques de la communauté étudiante d’une université modèlent forcément la nature des publications qu’elle pond. Et le statut de l’Université McGill est particulier au Canada : près d’un cinquième de son effectif étudiant est francophone parmi une majorité unilingue anglophone. Résultat : vous avez chaque semaine sur les présentoirs une publication de langue française, et deux de langue anglaise.
À Concordia
Quoique, selon l’administration de l’Université Concordia, « approximativement 17% des étudiants considèrent le français comme étant leur langue maternelle » (17.5 % à l’Université McGill), il n’y a aucune publication étudiante hebdomadaire dans la langue de Molière sur le campus de l’Université. On y trouve pourtant deux publications indépendantes de langue anglaise, soit The Link et The Concordian. Le chef de la section Nouvelles du premier, Justin Giovannetti, assure pourtant qu’il pourrait publier des articles en français. « Si les étudiants le souhaitent, ils peuvent nous soumettre des articles [en français].» Il indique en outre que The Link a d’ailleurs déjà eu un responsable aux publications francophones. « Pourtant, au cours des deux dernières années, je n’ai jamais eu de soumission. » Giovannetti ajoute qu’il s’était déjà personnellement demandé pourquoi il n’existait rien outre le magazine thématique L’Organe, publié mensuellement en français, mais que cette absence ne semblait pas susciter de débat dans la population étudiante.
À York
Les caractéristiques linguistiques des étudiants du campus bilingue de Glendon de l’Université York, établi à Toronto, s’apparentent aussi à celles de McGill. Sur le campus, Pro Tem publie à toutes les trois semaines. Andrée Poulin, rédactrice adjointe française explique au Délit qu’à l’intérieur de chacune des sections, les éditeurs tentent de parvenir à parité entre les articles français et anglais, pour finalement publier un journal véritablement bilingue. « On doit affronter la difficulté de trouver autant de collaborateurs confortables dans une langue, ou dans l’autre. Ceux dont la langue maternelle est le français souhaitent d’abord améliorer leur deuxième langue, d’où la difficulté de les amener à écrire en français. » Tout de même, semble-t-il, le comité éditorial tient à garder son statut de publication bilingue.
À Ottawa
Les francophones représentent un tiers des étudiants sur le campus de l’Université d’Ottawa, pourcentage en régression depuis plusieurs années. Il s’agit essentiellement de Franco-ontariens et de Québécois. La Rotonde, journal indépendant de langue française du campus principal, est « une institution au coeur de leur vie communautaire, qui couvre les sujets qui concernent les francophones et qui défend leurs droits. C’est entre autres pour ça que plusieurs éditoriaux portent sur le bilinguisme ou les droits des francophones chaque année », explique Philippe Teisceira-Lessard, chef de pupitre web de la publication. Ce qui ne manque pas de nous rappeler notre cher Délit.
Le parapluie des journalistes étudiants
En arrière-scène se trouve la Presse Universitaire Canadienne (PUC) qui, selon son président, Rob Fishbook, « s’est développée depuis ces soixante-douze années d’existence pour offrir plusieurs services à ses membres. En ce moment, nous avons notamment un fil de presse national auquel tous nos membres ont accès, plusieurs conférences pour les journalistes étudiants, des services législatifs, des prix et concours, des guides de ressources, et ce, gratuitement pour les journaux étudiants de langue française. »
Presses, pressés
Les médias sont en mutation. De plus en plus, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, les blogues, les vidéos sur YouTube servent de sources d’information rapide. Lors de la conférence régionale de la PUC, la journaliste Malorie Beauchemin parle des changements qu’a connu son journal. « Si La Presse a rapidement pris le virage web, certains autres quotidiens accusent un retard », affirme-t-elle. Le journal a lancé son site Internet, cyberpresse.ca, en 2005. Deux ans plus tard, après de nombreuses demandes, des nouvelles sont mises en primeur sur le web. En 2008, le site se pourvoit de blogues et en 2009, d’insertions audio et vidéo. Toutes ces démarches, explique-t-elle, résultent « de la volonté de nos administrateurs que tout le monde ait cyberpresse.ca comme page d’accueil ». Mais la compétition est féroce, la conférencière souligne la qualité audio-visuelle du site de Radio-Canada, et les nouveaux médias sont loin d’être domptés.
Tout ce Web 2.0 fait appel à de nouvelles exigences et le journaliste est parfois à cours de mains. Malorie Beauchemin raconte à peine à la rigolade qu’il faut maintenant tenir simultanément le calepin, le micro, l’appareil photo et la caméra vidéo. La qualité du produit fini en subit inévitablement les contrecoups puisqu’il faut la résistance et la rapidité d’un super-héros pour accomplir toutes ces tâches dans des délais toujours plus courts. Le journaliste n’a souvent pas le temps de prendre de distance par rapport à son texte ni de se lancer dans une réflexion plus approfondie. « Ça c’est sans parler des erreurs de frappe parce qu’il faut une dextérité légendaire pour manipuler les accents sur un Blackberry ! », ajoute-t-elle. Mme Beauchemin rappelle que la priorité d’un journal devrait être la qualité, mais l’ajout permanent de tâches supplémentaires, liées à l’arrivée des nouveaux médias rend la chose de plus en plus ardue.
Il faut aussi s’adapter à de nouveaux outils comme les réseaux sociaux tels Twitter et Facebook. On peut créer un réseau de contacts infini, les sources d’information se multiplient, les recherches peuvent se faire plus aisément. Encore faut-il savoir filtrer tout cet afflux d’informations. Il faudra aussi légiférer sur toutes ces transformations. Des questions épineuses en découlent : est-ce que les commentaires sur un blogue font partie de la ligne éditoriale du journal ? Il faudrait alors créer un poste de modérateur explique Mme Beauchemin. « Le monde du web est hyper-partisan », insiste Daniel Leblanc, journaliste du Globe and Mail. Ce dernier renchérit sur la dégringolade de la qualité : « Parce qu’il n’y a pas de limite d’espace [sur le web], on se permet de publier des textes de qualité moindre. » L’écriture journalistique sur le web ne devrait pas se différencier de celle sur papier, souligne-t-il.
S’ajoutant à ce mélange déjà prêt à exploser, les critères de crédibilité et de validité sont mis à mal. Est-ce que la signature seule engage la responsabilité de l’auteur ? Mme Beauchemin affirme qu’«il va falloir que le droit s’adapte ». On ne peut pas dire n’importe quoi parce que c’est sur Facebook ou Twitter. « Dès qu’on écrit quelque chose, on a un devoir public. On doit savoir assumer les responsabilités de ce que l’on écrit. » Elle ajoute que le New York Times, entre autres, a développé des directives claires en ce qui a trait à l’utilisation des réseaux sociaux par ses employés. Le journaliste doit tracer une ligne claire entre sa vie publique et sa vie privée. Sourire au coin, elle dit : « Je suis un être humain et j’ai des photos », mais elle explique qu’elle ne peut tout laisser paraître sur Facebook.
Enfin, selon Mme Beauchemin, il y a nettement une possibilité de nivellement vers le bas. Ce n’est pas seulement la fin de la presse écrite dont il est question, mais la fin du journalisme. La presse écrite coûte de plus en plus cher et est de moins en moins rentable. On oublie souvent que derrière l’écriture, il y a aussi tous ceux qui plient les journaux, qui les distribuent. Maintenant, « Twitter est au web, ce que le journal gratuit est aux quotidiens payants. » Le journaliste n’a plus le statut qu’il avait. Et en voulant faire compétition à ces nouveaux médias, le risque de perdre en qualité se fait de plus en plus menaçant. « La vie n’attend pas » dit Malorie Beauchemin. Il faudra s’armer aux plus vite de ces bras bioniques !