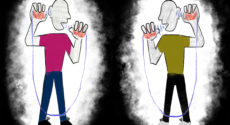Il y a deux semaines, Cynthia Cloutier Marenger, l’inestimable correctrice du Délit, me faisait remarquer ma tendance à ressasser les mêmes propos d’une contribution à l’autre. Peut-être exaspérée de lire et relire mon interprétation de l’art en jeu langagier et institutionnel, elle s’interrogeait : est-il possible de parler d’art contemporain doté d’une certaine vertu esthétique ?
Je me lançai donc dans la quête d’artistes qui, tout en développant des propos provocateurs vis-à-vis les institutions artistiques, maintenaient une idée d’attrait, d’harmonie, de beauté. Entouré d’anthologies, de livres commémorant des expositions mémorables et autres bouquins offerts en cadeau, j’entamai ma recherche.
Force m’est d’admettre que les choix finaux reflètent davantage un palmarès de mes peintres favoris qu’une définition objective de l’esthétique dans l’art actuel. Entre autres, cette liste devrait contenir Anselm Kiefer, Franz Ackermann, Matthew Ritchie, Julie Mehretu et Massimo Guerrera.
À ma connaissance, seul le premier (ayant eu une exposition rétrospective en 2006) et le dernier (dont on retrouve quelques œuvres au Musée des beaux-arts) ont eu une présence montréalaise. Les toiles de Kiefer se distinguent par la richesse de leur matérialité et par l’intégration d’objets qui les font émerger du simple cadre. Plus éthérées, les créations de Guerrera attirent l’attention avec un dessin à la fois fin et complexe.
Tous ces artistes peuvent être rassemblés par leur façon de réinventer la peinture et la complexité de leurs propositions. On réunit aussi parfois certains d’entre eux sous la bannière du « néo-baroque », ce qui me laisse une impression de plaisir coupable. Une historienne de l’art que j’ai le privilège de connaître a déjà résumé avec esprit le baroque en l’appelant « le kitsch avec une couche de poussière ». Qu’en est-il de ses expressions contemporaines, telles que le Cycle Cremaster de Matthew Barney ? Il s’agit d’un courant de virtuosité, de nouvelles narrations, de couleurs explosives et sensuelles, de matériaux inédits et de « cartes mentales » pour naviguer dans un environnement de plus en plus surchargé d’information.
C’est ainsi que nous nous retrouvons à la croisée des chemins entre l’université, l’art et le journalisme. Les études supérieures ne sont pas tant une acquisition de savoir qu’une acquisition d’habiletés et de techniques permettant de naviguer à travers ce savoir. L’art, conscient de cette surcharge, vient amplifier les sens. Il prend d’assaut les perceptions, interroge la signification du savoir, réoriente certains projets pour les remettre en question. Et le rôle du journalisme, dans tout ce branle-bas de combat, est de filtrer cette information.
Ces dernières semaines, dans les pages du Délit, Pierre-Olivier Brodeur mettait l’accent sur l’importance des tribunes favorisant la liberté d’expression, à l’image des blogues et des journaux étudiants. Dans un même ordre d’idées, Julie Rousseau rappelait l’influence et le mandat du métier de journaliste. On ne s’attend plus seulement à ce qu’il décrive ce qui affecte notre existence –on exige de surcroît qu’il appréhende et filtre l’énorme quantité d’information créant notre quotidien.
Or, pour cela, le journaliste doit bien commencer quelque part. Sur votre campus, Le Délit et le McGill Daily s’avèrent en quelque sorte des écoles de journalisme. Votre interaction, que vous soyez lecteur ou contributeur, assure son existence. Le Délit est votre journal : vous avez affirmé son indépendance et sa survie en 1981, en 2000 et en 2004. Une fois de plus, nous avons besoin de votre soutien. Votez, afin que nous puissions continuer à narrer et à repenser la réalité.